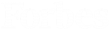Donnant une visibilité nouvelle à la parole des femmes, les campagnes #MeToo et #BalanceTonPorc pourraient bousculer les hiérarchies et faciliter la prise de conscience autour des bienfaits que l’entreprise peut tirer de plus de respect en son sein. Mais cela ne suffira pas, argue Réjane Sénac directrice de recherche CNRS associé au Cevipof. Elle est également présidente de la commission Parité du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCEFH). Pour elle, le combat pour l’égalité doit rester avant tout politique.
Qu’avez-vous pensé des débats autour de l’affaire Harvey Weinstein, nom de ce producteur américain accusé de harcèlement et de viol par de nombreuses actrices, et des deux campagnes Twitter #BalanceTonPorc et #MeToo qui ont suivi ?
Les témoignages et les débats ouverts suite à l’affaire Weinstein marque la fin d’une société française où l’égalité entre les femmes et les hommes est un mythe entre totem et tabou. La levée de l’impunité sur les violences envers les femmes marque en effet la fin d’une omerta. Les nombreux témoignages sur les réseaux sociaux (twitter et Facebook) expriment à la fois la spécificité des vécus individuels sur le registre du « je » et leur dimension collective et politique. Le contrôle du corps des femmes et leur sexualisation y sont révélés comme un système de domination concernant toutes les sphères de la société et tous les milieux. Le fait que ce débat ait eu pour point de départ des dénonciations de harcèlements, d’agressions sexuelles et de viols par des stars d’Hollywood, met en lumière la dimension systémique et systématique de ces violences : si des femmes de pouvoir, avec des capitaux de tout ordre, n’ont pas eu les moyens de parler et de faire valoir leurs droits, qu’en est-il des femmes moins armées ?
Alors qu’aux Etats-Unis, la fondation Time’s up, destinée en particulier à apporter un soutien aux victimes de harcèlement au travail, est lancée le 1er janvier 2018, en France, 100 femmes publient une tribune dans Le Monde du 8 janvier 2018 pour défendre « la liberté d’importuner ». Les nombreuses réactions provoquées par cette tribune soulignent qu’il n’est plus possible de se draper dans la trop fameuse spécificité française de la galanterie et de la séduction pour dépolitiser le débat. Le 27 février, 130 personnalités ont lancé un Time’s Up à la française. Maintenant on agit. Comme le mouvement créé par les femmes d’Hollywood, Maintenant on agit compte lever des fonds (1 million d’euros), via la Fondation pour les femmes, pour soutenir plusieurs associations luttant contre les violences faites aux femmes.
Quelle peut être la suite de ce mouvement ?
Les controverses participent de l’explicitation des enjeux, de la levée des tabous.
Les campagnes #Metoo et #BalanceTonPorc rendent visibles à la fois l’ampleur des violences et leur impunité sociale, mais aussi juridique, les dépôts de plainte ayant augmenté de 30% les mois suivants ces campagnes. Les condamnations juridiques sont essentielles car en sanctionnant les comportements et actes violents, elles ont à la fois un rôle réparateur pour les victimes et pédagogique pour tou.te.s. Or, comme le soulignent en particulier les travaux du HCEfh, en France, parmi les dizaines de milliers de femmes victimes de viol tous les ans, environ une sur 10 porte plainte et seule une plainte sur dix aboutit à une condamnation.
Les deux démarches sont liées et complémentaires. Si j’ai choisi de m’exprimer avec #MeToo, c’est parce qu’il me semble dire plus explicitement la dimension politique du vécu à la fois intime et partagé des violences sexuelles. S’inscrire dans le collectif de celles qui subissent ces violences, ce n’est pas se “victimiser”, mais c’est dénoncer un système de domination et ses conséquences. Au-delà des auteurs de ces violences, il s’agit de « balancer » une société de domination et d’interroger les conditions à mettre en place pour créer une société d’éga.ux.les. Ce partage de témoignages crée, au-delà de leurs particularités, une sororité dans l’adversité, une dénonciation collective d’une biopolitique de la domination.
Conscients des enjeux politiques de ce moment, certains hommes ont exprimé leur solidarité en rédigeant des tribunes et en participant à des rassemblements. Le dépassement de la normalisation des violences envers les femmes ne pourra se faire qu’avec eux, mais à condition qu’ils ne tombent pas dans le piège de la confiscation de la parole légitime en reproduisant une posture paternaliste même bienveillante. Les hommes sont donc plus que bienvenue dans ce mouvement, avec la vigilance et l’humilité nécessaires pour ne pas tomber dans le mansplaining souvent plus inconscient que conscient. Quant aux réactions telles que celles proposant de lancer un hastag des #mecssupercool, ou établissant une analogie avec la délation (#balancetonjuif) soulignent que la tentation du déni, du discrédit et du renversement de responsabilité est encore forte.
Vous parlez souvent d’un dilemme à demander l’égalité tout en ayant une démarche singulière, pouvez-vous expliquer ?
Le défi, sous forme de dilemme analysé en particulier par Jacques Derrida dans Politiques de l’amitié, est que pour tendre vers une société où nous serons toutes et tous considérés comme des égaux, nous devons utiliser les catégories sources de discrimination (par exemple lors de la mise en place de quotas sexués). L’enjeu est de le faire de manière à ce que les assignations et les stéréotypes inclus dans ces catégories soient ainsi déconstruits et non respectabilisés et modernisés. C’est à cette condition que la mise en place de mesures d’action positive, quel que soit le secteur de politique publique (des « réseaux d’éducation prioritaires plus » dans l’éducation aux lois instaurant un quota pour partager les postes à responsabilité), participera à la déconstruction de l’ordre inégalitaire. Les principes de justification de ces mesures sont déterminants car si ces mesures sont appliquées au nom de la performance de la mixité, et non de la remise en cause des différenciations jugées illégitimes, elles contribueront à renaturaliser les hiérarchies sociales et politiques dans une inclusion sous conditions.
Vous voulez dire que l’on utilise les mêmes arguments pour inclure que ceux qui ont été utilisé pour exclure ?
Il est difficile de ne pas tomber dans le piège qui consiste à inclure les personnes potentiellement discriminées – en particulier les femmes et les personnes racisées – pour les mêmes raisons qu’elles ont été exclues de l’application des principes d’égalité et de liberté, à savoir leur identification comme différent.e et non comme égal.e, au sens de semblable politiquement. Faire de leur inclusion une « plus-value », c’est rester sur le registre de la complémentarité et non de l’égalité. Ainsi, les femmes exclues de l’espace public au motif qu’elles étaient incapables, au sens de n’ayant pas la puissance, d’avoir les qualités nécessaires pour être un citoyen rationnel à distance de leurs vocations naturelles de mère, sont aujourd’hui inclues dans l’espace public avec l’argument, certes culturalisé, de leur complémentarité.
Les femmes manager, politiques apporteraient autre chose, justement du fait de leurs qualités maternantes (plus dans l’écoute, l’empathie, la pacification, l’intérêt pour le collectif…). Or, l’injonction des femmes à ces qualités est incompatible avec le dépassement du plafond de verre et leur accès à des postes de numéro 1. Le numéro 1 doit en effet trancher en ayant la légitimité de ne pas se poser la question du compromis. Les femmes qui veulent vraiment être décisionnaires, c’est-à-dire être autonomes face à la prise de décision, sont donc tiraillées par des injonctions contradictoires. Elles doivent respecter les codes et les qualités dites féminines ou maternantes, or ces codes, comme la médiation, sont des qualités d’un bon numéro 2 et non d’un numéro 1 dont l’autorité réside justement dans sa liberté à ne pas se justifier et à assumer l’impopularité.
Citons deux exemples. Lorsqu’en 2013, pour la première fois dans l’histoire du journal, une femme, Natalie Nougayrède, est élue à la direction de la rédaction du Monde, c’est en tandem avec Louis Dreyfus, président du directoire depuis 2010. Dans la même logique, à l’issue de l’assemblée générale d’Engie du 4 mai 2016, Isabelle Kocher devient la seule femme à diriger un groupe du CAC 40, mais le PDG sortant, Gérard Mestrallet, est nommé président non exécutif. Alors que leur exclusion était auparavant justifiée au nom de leur irrémédiable imperfection, leur inclusion continue à se faire sur le registre de l’incomplétude.
Comment inclure aujourd’hui les femmes ?
Mes recherches portent sur l’analyse des justifications publiques des politiques d’inclusion au 21e siècle pour celles et ceux que je qualifie de « non-frères » dans la mesure où elles/ils ont été exclu.e.s historiquement et théoriquement de la fraternité républicaine.
Ce que j’observe à travers l’analyse de rapports, de déclarations, mais aussi d’enquêtes qualitatives auprès de dirigeant.e.s politiques, institutionnels, économiques, syndicaux, associatifs et religieux, c’est qu’après avoir été construite comme une moins-value incompatible avec leur reconnaissance comme acteur.trice.s politiques à part entière, leur singularisation est théâtralisée comme une plus-value justifiant leur inclusion. C’est certes une avancée par rapport à la justification de leur exclusion en raison de leur prétendue incapacité à se détacher de leurs vocations naturelles, mais cela ne permet pas de dépasser le mythe fondateur de la complémentarité.
Qualifier de mythe fondateur la division du travail dans la sphère privée et publique sur le registre du papa/maman, c’est dénoncer la justification de hiérarchisations sociales par la sacralisation d’une prétendue nature harmonieuse et juste. Il ne s’agit pas de nier la complémentarité des sexes dans la procréation, mais d’analyser le rôle fondamental qui lui est donné dans une cosmogonie binaire et inégalitaire où le deuxième sexe complète un masculin défini comme norme et autorité.
La distinction stéréotypée entre les jouets pour les filles et pour les garçons témoigne de la persistance d’une éducation où les filles sont élevées pour devenir de bonnes mères et de bonnes épouses et les garçons de futurs constructeurs et décideurs. Accompagnés par des jouets contribuant à l’acquisition de compétences reconnues d’un point de vue scolaire et professionnel, les garçons n’apprennent pas à devenir de bons pères et de bons maris, mais à prendre du temps pour vivre leurs passions. Le caractère encore très sexué de l’orientation scolaire et professionnelle incarne les répercussions concrètes de cette éducation à la complémentarité. C’est ainsi par exemple que les filles représentent 79,5 % des élèves dans la filière baccalauréat littéraire et moins de 7 % parmi les élèves de la filière sciences et technologies de l’industrie et du développement durable[1].
Une femme doit donc prendre une posture masculine pour réussir ?
L’enjeu pour tendre vers l’égalité est au contraire d’égaliser les « capabilités »[2], au sens où chaque individu en société doit pouvoir se projeter, être reconnu.e et vivre sans que son positionnement (volontaire ou assigné) par rapport aux catégories sociodémographiques (âge, sexe, origine sociale, origine ethno-raciale, orientation sexuelle, apparence physique, etc.) n’interfère. Le recours à la prétendue plus-value des femmes est alors un piège à éviter pour ne pas les enfermer dans un rôle de complémentaire qui doit être conforme à ce que l’on attend d’elles en tant que femmes et non pas en tant qu’individu différent car unique. Les hommes sont certes eux aussi jugés par rapport aux normes de la masculinité, mais ces attentes étant très proches des qualités d’un décideur, ils n’ont pas à dénouer des injonctions contradictoires. En position de responsabilité, ils n’ont en effet pas à se justifier d’être clivant, de trancher. Au contraire, ils vont avoir à se justifier s’ils ont des pratiques plus douces. Quoique… ils seront alors perçus comme innovants, généreux, ouverts, voire courageux.
Selon vous, pourquoi inclure les femmes en tant que femmes est dangereux ?
Pourquoi justifier les politiques d’égalité au nom de la performance de la mixité revient à inoculer un poison sans antidote au principe d’égalité ? Premièrement, cette justification est fondé, en particulier pour les politiques d’égalité femmes-hommes, sur des travaux scientifiquement discutables et discutés. L’économiste Julie Nelson remet en particulier en cause la validité des travaux d’économie comportementale, qui associent la présence des femmes dans les instances décisionnelles d’une entreprise à une réduction de sa prise de risque[3]. Elle appelle ainsi à la vigilance face aux affirmations telles que celles de l’économiste Anne Sibert[4] qui, dès les lendemains de la crise financière de 2008, émettait l’hypothèse que le krach aurait pu être évité si les femmes avaient eu davantage leur place et leur mot à dire à Wall Street. Doit-on prendre au sérieux l’étude effectuée par John Coates et Joe Herbert[5] auprès de seulement 17 traders de la City de Londres, selon laquelle une corrélation existerait entre le niveau de testostérone (mesuré par le rapport entre la taille de l’index et de l’annulaire) et les prises de risque dans l’activité boursière ?
Il est regrettable que cette étude si critiquable d’un point de vue épistémologique ait pu justifier des affirmations telles que celle en 2014 de la présidente du Fonds monétaire international (FMI). Christine Lagarde avait alors défendu une plus grande inclusion des femmes dans la prise de décision économique au motif que si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, la crise aurait été moins grave, voire n’aurait pas eu lieu. Or, par exemple, les économistes Uri Gneezy, Kenneth L. Leonard et John A. List soulignent la nécessité d’étudier la compétitivité respective des femmes et des hommes comme l’expression non de différences biologiques, mais de rapports construits socialement. Leurs recherches démontrent que si les hommes sont plus compétitifs que les femmes dans les sociétés patriarcales, c’est l’inverse dans les sociétés matrilinéaires[6]. Le comportement de plus grande prise de risque par les hommes est alors à comprendre comme l’expression de leur éducation à une plus grande confiance en eux.
Deuxièmement, ce discours est idéologiquement signifiant car il porte une conception néo-essentialiste, voire naturaliste, des qualités dites féminines et masculines.
Troisièmement, la justification des politiques d’égalité par l’argument de la performance de la mixité ou de la lutte contre les discriminations soulève des discussions en termes non seulement de rigueur scientifique et de portée idéologique, mais aussi d’implications concrètes, et ceci à deux niveaux. D’une part, même dans le scénario le plus optimiste, où preuve serait faite qu’il est rentable de ne pas discriminer, le risque est de continuer à enfermer les discriminés dans une mise en scène de leurs différences. D’autre part, si la performance n’est pas démontrée, l’égalité devient une option rationnelle … ou pas. Le fait de recourir à la démonstration de la performance des politiques d’égalité, présentée sur le registre du « gagnant-gagnant », débouche sur une dépolitisation où tout est affaire de chiffres et de négociation. En effet, si le critère de justification des politiques d’égalité est leur rentabilité, prouver que les politiques discriminatoires et d’exclusion sont rentables devient aussi pensable. La brèche est ouverte dans d’autres domaines tels que celui des dépenses publiques de solidarité et de redistribution, en particulier celles touchant à la santé et à l’éducation. Est-on certain que les bourses sur critère social « rapportent » plus qu’elles ne coûtent ? Que la gratuité de l’école publique soit un « plus » pour la croissance ? Qu’il soit économiquement fondé de financer les hôpitaux?
Comment sort-on de ce piège ?
Pour sortir de ce piège, il s’agit de repolitiser l’égalité, ce droit fondamental qui est en haut de la pyramide politique républicaine. Ce rappel peut apparaître étrange, mais il est essentiel. Pourquoi doit-on justifier les politiques d’égalité – femmes/hommes mais pas seulement – au nom de leur rentabilité alors que par exemple sur les questions de sécurité au travail, on ne transige pas. L’enjeu n’est pas de savoir si la sécurité leur coûte plus qu’elle ne leur rapporte, les entreprises n’ont pas le choix. Il y a des engagements qui ne sont pas conditionnés à leur rentabilité et l’on ne peut que s’en réjouir. Nous trouverions cela déplacé de faire un calcul coût/bénéfice en ce qui concerne le respect des règles de sécurisation des chantiers par exemple. La question à se poser est pourquoi ne sommes-nous pas choqués par le fait de justifier l’application du droit fondamental d’égalité par le calcul coûts/bénéfices ?
Le risque est d’en arriver à un arbitrage cynique entre les discriminations rentables et coûteuses. Concernant l’égalité salariale par exemple, doit-on se réjouir qu’une étude de la fondation Concorde, relayée en particulier par le Figaro dans un article du 30 octobre 2017 affirme que ces inégalités entraînent une perte de 62 milliards pour l’économie française ou doit-on avec le journaliste Christophe Barbier dire que « si on payait les femmes comme les hommes, les entreprises seraient ruinées »[6] ? Cette affirmation doit être prise au sérieux car l’analyse des coûts et des bénéfices des politiques d’égalité peut en effet conduire au diagnostic que celles-ci ne sont pas rentables. Ainsi, au niveau macroéconomique, des travaux ont montré que la discrimination salariale à l’encontre des femmes accroît l’attractivité de certains pays en termes d’investissements directs étrangers et donc leur dynamisme économique. L’économiste Stéphanie Seguino[7] souligne que dans les pays semi-industrialisés ayant des économies ouvertes et fortement imbriquées dans la globalisation (Thaïlande, Taiwan par exemple…), la discrimination salariale stimule la croissance économique. En effet, les écarts de salaire femmes-hommes y sont supérieurs aux écarts de productivité ente les sexes, ce qui rend ces pays attractifs aux investissements étrangers. Le moindre coût du travail des femmes constitue alors une source de profit. Ainsi, l’argument prétendument pragmatique de l’investissement social dans l’égalité la met en danger en la conditionnant à la démonstration de sa rentabilité.
Conscient de ce risque, le commissaire général de France Stratégie, Jean Pisani-Ferry affirme ainsi, dans son avant-propos au rapport de septembre 2016 sur Le coût économique des discriminations, que si preuve était apportée que les discriminations « bénéficiaient à l’économie, cela ne les rendrait pas plus acceptables [8]». Et il poursuit: « Il se trouve cependant que les discriminations sont économiquement pénalisantes, que leur coût pour la collectivité est élevé, et donc que leur élimination induirait, à terme, un gain substantiel en croissance et en revenu. » Cet argument d’autorité ne suffit pas à fermer la brèche ouverte à la primauté du chiffre sur le politique. L’approche coûts/bénéfices a sa place pour choisir le meilleur instrument pour atteindre un objectif d’égalité non conditionné lui à une quelconque rentabilité.
Faut-il mettre des femmes en avant pour permettre aux jeunes femmes de se lancer ? Faut-il des modèles ?
En mettant en avant des femmes qui arrivent à tout concilier avec le sourire, on occulte à la fois l’asymétrie avec les hommes (envers qui il y a certes des attentes, mais pas celle de « concilier ») et les conditions de cette réussite (moyens financiers, réseaux, aide familiale…). En France, le modèle est encore celui de la super woman, de la femme qui doit tout réussir : sa vie privée en ayant une famille, des enfants (et en s’en occupant !), sa vie professionnelle, tout en restant féminine au sens de répondant aux codes de la séduction. L’effet pervers de ce type de modèle est de plus d’individualiser la réussite, le mérite, mais aussi la responsabilité à travers le fameux trop facile « si tu veux tu peux ». Or, une cadre à 2000 euros par mois (et même plus si elle est en famille monoparentale) ne peut pas se permettre de payer une baby sitter pourtant nécessaire pour être disponible et présente et donc promouvable…
Après la libération de la parole des femmes, il est temps que ceux qui sont en position de changer les règles du jeu prennent leur responsabilité, les politiques bien sûr, mais aussi les dirigeants du monde économique. Etre à la hauteur du principe d’égalité, c’est prendre des mesures concrètes comme instaurer des réunions à l’heure du déjeuner, comme cela se fait dans les pays nordiques. L’enjeu est de se libérer des comptes de fée pour se donner les moyens de porter l’égalité.
[1] Cf. Fiches Education, INSEE Références – Edition 2017.
[2]. Amartya Sen, Repenser l’inégalité, Paris, Seuil, 2012 ; John Rawls, La Justice comme équité. Une reformulation de la théorie de la justice, Paris, La Découverte, 2008, p. 229-239.
[3]. Voir en particulier Julie A. Nelson, « Not-So-Strong Evidence for Gender Differences in Risk Taking », Feminist Economics, 22:2, 2016.
[4]. Anne Sibert, “Sexism and the City: Irrational Behaviour, Cognitive Errors and Gender in the Financial Crisis”, Open Economies Review 21, février 2010, p. 163-166.
[5]. John Coates, Joe Herbert, “Endogenous Steroids and Financial Risk Taking on a London Trading Floor”, Proceedings of the National Academy of Sciences U S A, 22, avril 2008, p. 6167-6172.
[6]. Uri Gneezy, Kenneth L. Leonard, John A. List, « Gender Differences in Competition : Evidence form a Matrilineal and a Patriarcal Society », Econometrica, 77 (5), 2009, p. 1637-1664.
[7] Stéphanie Seguino, « Gender inequality and economic growth: A cross-country analysis”, World Development, 28(7), 2000, p. 1211-1230.
[8] France Stratégie, Le coût économique des discriminations. Rapport remis à la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, et au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, par Gilles Bon-Maury et al, septembre 2016: http://www.strategie.gouv.fr/publications/cout-economique-discriminations

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits