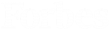Coach d’une grande championne, Serena Williams, et patron d’une importante académie de tennis, l’exercice peut paraître schizophrénique et requérir un don d’ubiquité. Mais Patrick Mouratoglou s’en sort très bien, sans forcer, comme quand il lâche son revers lifté. Reportage « embarqué » et interview de fond… de court bien sûr.
Avec son mètre 85, ses yeux bleu profond, sa barbe de trois jours et son allure « relax » de DJ du bout de la nuit, Patrick Mouratoglou se reconnait au premier coup d’œil. Le coach de Serena Williams depuis une décennie est aussi un « serial entrepreneur » qui a créé l’une des plus importantes académies de tennis d’Europe et lance un nouveau circuit, l’Ultimate Tennis Showdown (UTS), qui pourrait révolutionner l’univers monolithique du tennis professionnel. Pour percer à jour le personnage et décrypter ses projets, Forbes a choisi de le suivre pendant une journée, d’entraînements en réunions, de rigolades en engueulades. Mourat’ pour les intimes est assurément un animal étrange, fait à la fois d’humilité non feinte et d’égocentrisme affiché, de distance et de chaleur mêlées. Autant de paradoxes qui font son charme et expliquent sans doute sa réussite. Car en effet, « the coach » a plutôt tendance à réussir ce qu’il entreprend.
Du jeudi 5 novembre à 17h30 au vendredi 6, 16h30, il a joué le jeu de l’« embedded » et de l’interview-vérité sans tricher, poussant le cabotinage jusqu’à lancer calmement : « Je n’aime pas votre question et je vais vous dire pourquoi… » Pourquoi ? Pour le savoir, il faut lire ce sujet inédit sur Patrick Mouratoglou, l’homme qui a fait de sa passion un business et de son business une passion.
Jeudi 5, 17h30 : Patrick Mouratoglou nous rejoint dans le salon VIP de son académie en tenue de ville pour un entretien de 1h30. Après les banalités d’usage et quelques plaisanteries sur mon carnet de notes maculé de dessins d’enfant, nous démarrons l’entretien. Derrière l’apparente décontraction, point une certaine tension dès la première question, qui s’estompera au fil du temps. Un pur plaisir d’interview : Patrick se révèle affûté comme ses élèves sur le court, sympathique et surtout, franc du collier (lire p. 110). Nous terminons vers 18h30 afin qu’il puisse enchaîner avec une réunion zoom en anglais avec des femmes coachs. Les problèmes techniques l’agacent : « Les gars, vous pouvez y aller mais le système ne marche pas. » Aucun de ses collaborateurs ne partira tant que la liaison ne sera pas établie. Rien de tel qu’une petite vanne pour manager ses équipes en douceur. Nous nous retirons car le maître des lieux veut garder sa confidentialité à cet échange.
Vendredi 6, 7h15 : C’est son rituel du matin.
Patrick sort pour une grande promenade d’une heure avec ses trois chiens, un malinois, un rottweiler et un doberman qui vient de fêter son premier anniversaire. Aujourd’hui, c’est à l’étang de Fontmerle, près de Mougins, qu’il s’offre ce premier set avec ses partenaires préférés. Lancers d’objets, courses, tout est bon pour distraire le trio et entamer la journée qui attend Patrick Mouratoglou avec un grand bol d’air. Et un moment d’affection partagée.

8h30 : Retour à la maison de Mougins pour enfiler l’uniforme de l’homme d’affaires détendu (jean, baskets dorées, chemise blanche, veste bleu marine et pochette blanche) puis avaler un petit déj frugal : café, croissant, jus d’orange. Ensuite, direction l’académie située à Biot, joli village connu pour son musée Fernand Léger et, désormais, pour son country club…
9h30 : Le boss arrive au salon VIP pour une réunion de travail avec son directeur délégué, Nicolas Queru, qui doit lui rendre compte des dernières actualités de son nouveau circuit « qui ne concurrence pas l’ATP », l’Ultimate Tennis Showdown (UTS). Nicolas Queru commence par la synthèse d’une étude sur les jeunes et le tennis à la télé :
— Notre enquête confirme que nous avons raison de cibler les jeunes. La plupart ne regardent plus le tennis à la télé. L’âge moyen des téléspectateurs, c’est 61 ans !
— Ça ne cesse de décliner depuis cinquante ans, on est face à une tendance de fond, confirme Patrick. Notre enjeu est d’accrocher les moins de 40 ans. Tous les codes de l’UTS doivent leur parler : immédiateté, spontanéité, naturel.
— Sur mille abonnés à l’appli UTS, on a 59 % de satisfaits. C’est très bon. Chez les plus jeunes, on monte à 68 %.
— Attention quand même à ne pas décrocher chez les autres. Il y a des critiques ?
— Oui, anecdotiques. 1 % des gens disent : « C’est pas du tennis. » Normal. On avait anticipé le risque grâce aux tests d’avant le démarrage.
— Donc pour le haut niveau, c’est très positif. Et les femmes ?
— On va le faire, mais le calendrier de l’ATP complique les choses.
— Au fait, il faut que l’on place les caméras au cœur du jeu pour que le téléspectateur ait vraiment l’impression de participer, note Patrick. Le succès d’UTS en dépend. Le format de quatre quart-temps de 10 minutes fonctionne ?
— Oui, même si on réfléchit à raccourcir pour avoir encore plus de rythme. Peut-être quatre fois 8 minutes. Sinon, on a un souci avec la pub télé. Les chaînes ne savent pas où les placer parce qu’au changement de côté, il y a les interviews des joueurs.
— Débrouillez-vous mais il faut des plages pour la pub ! D’une façon générale, si on veut attraper les jeunes, il faut s’inspirer du e-sport. Je connais mal ce secteur. Essayez de m’organiser un brief d’une heure avec un expert. Merci Nicolas, ça avance bien.
10h30 : Les deux hommes poursuivent par un tour d’horizon budgétaire. Ils préfèrent rester seuls. Les journalistes sont rarement les bienvenus quand on aborde ces sujets…

11h30 : Rendez-vous sur l’ocre. Patrick Mouratoglou a troqué sa tenue de ville pour un survêtement à ses couleurs du meilleur effet. Il fait la tournée des courts afin de mieux connaître ses élèves, échanger avec leurs entraîneurs et, de-ci de-là, distiller quelques conseils que les académiciens absorbent telles des éponges qu’ils sont encore à cet âge. Sur le premier terrain, l’ancienne championne française Mary Pierce joue les consultantes de luxe. Sa silhouette s’est affinée depuis l’époque où elle soulevait de la fonte pour rafler les grands chelems. « Elle travaille pour nous de façon sporadique mais sa collaboration pourrait devenir plus officielle », glisse Patrick.
Elle entraîne un jeune Ivoirien qui impressionne par ses frappes et son gabarit puissant. Le patron étudie le tennis de ses protégés mais pense aussi à leur future image. Un pur coach. Sur un court voisin, un garçon vaguement barbu montre de belles dispositions. Il est programmé pour partir l’an prochain dans une université américaine avec laquelle l’académie Mouratoglou entretient d’excellentes relations. Son entraîneur précise : « C’est une chance immense qu’ils ont de pouvoir étudier dans ces universités sans payer 60 000 dollars. Le niveau de la prise en charge dépend de leur niveau de tennis. Ça motive ! » Tous les académiciens ne deviendront pas des joueurs professionnels. Mais ils auront le choix en matière d’orientation. La déambulation continue. Mourat’ est concentré. Il entre sur un court où s’entraînent quatre garçons hyper toniques. Très naturellement, Patrick aborde l’un d’eux. « C’est bien mais il faut que tu te places plus tôt sur la balle, que tu recules plus vite. »

— Nous avons recruté notre coach, un ancien 70e mondial qui a déjà bossé à Dubaï. Il y en a trois autres qui arrivent, un Français, un Italien et un Libanais qui parle arabe.
— Il sont formés à nos méthodes ? s’inquiète Patrick.
— Pas fini, ils ont encore un mois de formation, ils seront opérationnels en décembre.
— On a des sponsors ?
— Oui, Dunlop et Asics. Je pars à Dubaï, tous les équipements seront floqués Mouratoglou dès l’ouverture, même les balles seront frappées du M !
— Que dit notre directeur marketing ?
— On ne peut pas faire un lancement événementiel à cause du Covid mais on va enregistrer une vidéo avec des joueurs de l’académie, notamment Khachanov et Andrescu qui sont à Dubaï. L’annonce officielle est prévue pour le 15 décembre.
— Super, on n’a pas trop le temps maintenant mais il faudra que l’on fasse un point sur les autres développements internationaux, les projets d’académie en Amérique et en Asie et les écoles partantes pour monter avec nous des tennis-études. On possède une marque numéro un mondial, on doit la monétiser.

15h15 : Retour sur les courts pour un nouveau tour du propriétaire car les joueurs qui étaient en classe le matin sont arrivés à l’entraînement. Nous nous éclipsons car, après cette seconde séance, Patrick filera tôt, comme tous les vendredis, pour passer le week-end en famille.
Vous exercez plusieurs métiers mais celui pour lequel on vous connait le mieux, c’est coach. Quelles qualités faut-il pour faire un bon coach de sportifs de haut niveau ?
P.M : Il faut d’abord un regard positif sur les choses et les gens. Être plus dans la bienveillance que dans le jugement. Il m’arrive d’être en désaccord complet avec les champions dont je m’occupe, mais je ne leur dis pas parce que je suis leur coach, je me mets dans leur peau…
… Je vous interromps sur ce point, car ce que vous nous dites va à l’encontre des idées reçues. Quand on voit des documentaires où l’on montre un entraîneur avec son équipe, il y a toujours ces scènes où il étrille les sportifs. La bienveillance n’est pas de mise.
P.M. : C’est très télévisuel, c’est pour ça que l’on montre ça. Il peut arriver que l’on ait besoin de mettre les doigts dans la prise à son joueur. Avec Serena, ça s’est passé trois fois en neuf ans. Quand on le fait, c’est forcément à un moment vital, et en mesurant les conséquences éventuelles d’un tel acte.
Lesquelles ?
P.M. : Le risque de rupture entre les deux personnes. On ne peut bien travailler avec un joueur que si on regarde davantage ses qualités que ses défauts. Cet état d’esprit est indispensable.

Mais si on ne critique pas son joueur, comment on le fait avancer ?
P.M. : Comme cela justement. C’est encore une idée reçue de penser que l’on fait progresser quelqu’un en détectant ses faiblesses et en appuyant dessus. Je préconise le contraire. Apporter de la confiance, c’est la clef. Quand un joueur se sent fort, il gagne. Sur le plan technique, je construis sur les points forts car c’est avec ça qu’on fait les champions. Je suis dans une dynamique d’amélioration, pas de correction. Toujours le regard bienveillant. Ensuite, il faut être méthodique, patient et impatient.
En fait, vous ne coachez que des joueurs que vous admirez. Cela signifie donc que vous pouvez refuser vos services.
P.M. : Absolument. Cela m’est d’ailleurs arrivé à plusieurs reprises. Si un joueur ne me fait pas rêver, c’est mort.
Vous parlez de sa façon de jouer ?
P.M. : Pas seulement. Je regarde aussi la personnalité.
Les qualités que vous avez décrites, de bienveillance, de positivité, sont-elles les mêmes pour un coach de dirigeants d’entreprise, par exemple ?
P.M. : À 100 % ! Il n’y a pas de coaching efficace sans ce penchant naturel.
Quand vous intervenez dans des séminaires d’entreprises ou des formations de dirigeants, quels messages faites-vous passer ?
P.M. : Ceux qui me sollicitent veulent que je leur explique comment on fabrique un champion parce qu’ils souhaitent que leurs cadres deviennent des champions, la meilleure version d’eux-mêmes.
C’est utile ?
P.M. : Oui et non. Eux sont très contents et me demandent de revenir. Mais pour une véritable efficacité, il faudrait plus de suivi. Je ne crois pas à la magie, je crois au travail. Mais je sais que les gens préfèrent souvent l’ostéo au kiné parce qu’avec le kiné, il faut bosser…
Bien vu. Vous êtes aussi chef d’entreprise. Manager des équipes, c’est une forme de coaching ?
P.M. : Oui. Mais pour répondre de manière tout à fait honnête me concernant, je devrais prendre plus de temps avec les gens mais je n’y arrive pas. Donc je vais droit au but. Comme dirigeant, je demande plus à mes équipes de s’adapter à moi que le contraire. Alors que dans le coaching, c’est moi qui m’adapte au joueur. Ce sont finalement deux métiers différents.
Et semblables ?
P.M. : Oui, parce que le coach comme le dirigeant doivent fixer des lignes directrices.
Avec une Serena Williams, c’est vous qui fixez les lignes directrices ?
P.M. : Bien sûr. Mais après des jours, des semaines, parfois des mois d’observation et de discussions.
Quand vous débutez votre collaboration avec cette championne qui a déjà gagné 13 grands chelems à ce moment-là, c’est vous qui fixez les orientations ?
P.M. : Oui. Elle n’avait pas gagné de grands chelems depuis trois ans et venait de perdre au premier tour à Roland-Garros. Nous commençons à travailler et 15 jours plus tard, elle l’emporte à Wimbledon en simple et double. Ensuite, elle a tout gagné et est redevenue numéro un mondiale. Là, elle me dit : « C’est très bien mais mon rêve, c’est de regagner à Roland-Garros. » Je lui ai préparé un plan de travail qu’elle a validé et elle a réussi.
Coach d’une championne comme Serena Williams et chef d’entreprise sont deux activités très chronophages. Vous voulez continuer à cumuler ?
P.M. : J’ai construit des édifices solides de part et d’autre, pas question d’abandonner. Le secret, c’est une bonne équipe. L’académie peut tourner sans moi. Pendant un Grand Chelem, je suis sur les matchs de Serena, Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff, je vais aux entraînements, souvent je dîne avec eux, c’est du 24 h/24. Il ne me reste plus beaucoup de créneaux pour l’académie. Comme je ne suis pas un control freak, ça tombe bien !
Quelle est la différence entre coach et mentor ?
P.M. : Le coach endosse 100 % des responsabilités. Donc, avec Serena, je contrôle tout le sportif, les intervenants (médecins, kiné, alimentation, etc.), les entraînements, etc. Même une partie de sa vie de famille car elle peut avoir un impact sur ses résultats. J’ai créé une relation qui permet ça. Comme mentor, avec Stefanos, par exemple, j’interviens quand je le juge nécessaire et je suis disponible s’il en a besoin. Mais je ne suis pas responsable de ses résultats puisqu’il a un coach.
Mentor, c’est une fonction rare dans le sport…
P.M. : Oui. Stefanos m’appelle souvent dans des moments-clés. Je l’ai repéré quand il n’était pas connu, je lui ai donné une structure pour se développer quand il avait 16 ans. À 18 ans, j’ai vu qu’il manquait de physique. Il fallait lui construire le corps dont il aurait besoin pour les quinze prochaines années. Je lui ai donc trouvé un entraîneur physique, un kiné… J’ai toujours chapeauté son projet.
La rencontre avec Serena Williams a-t-elle changé votre vie ?
P.M. : Je n’aime pas votre question et je vais vous dire pourquoi. D’abord, on ne sait pas ce qui se serait passé si je ne l’avais pas croisée. Et de toute façon, je pense que cela s’est passé à ce moment-là parce que j’étais prêt, crédible pour jouer ce rôle. Si ça n’avait pas été elle, j’aurais sans doute atteint ce niveau avec quelqu’un d’autre. Serena n’est pas un accident. De son côté, elle était déjà une championne quand je l’ai connue, mais avec moi, elle a changé de dimension. Au fond, on a explosé ensemble dans nos métiers respectifs. Avant elle, Marco Baghdatis ou Aravane Rézaï m’avaient aussi beaucoup apporté.
Pourquoi une Américaine est-elle venue chercher un coach français alors que les États-Unis sont un grand pays de tennis ?
P.M. : Les bons joueurs cherchent généralement un coach dans leurs pays, souvent par facilité, mais les champions cherchent le meilleur coach, peu importe sa nationalité.
L’académie Mouratoglou est née en 2006 et en 2012, j’ai gagné mon premier Grand Chelem
Êtes-vous impliqué dans le business de Serena Williams ?
P.M. : Pas du tout. Je ne veux pas de parasitage dans mon travail auprès d’elle, donc je ne parasite pas celui des autres. Je connais le métier d’agent mais je ne l’exerce plus.
Vous pensez parfois à l’après-Serena ?
P.M. : Non, pas trop car je veux rester concentré sur sa fin de carrière. Mais je sais que les meilleures choses ont une fin. Ça ne me traumatise pas.

Le tennis de haut niveau est-il en crise actuellement ?
P.M. : Oui. Parce qu’en fait, le sport est en compétition avec des médias très puissants. Le tennis, le foot, ça existe depuis des décennies. Leurs formats n’ont jamais été modifiés. Mais sont arrivés les réseaux sociaux, les plateformes, le e-sport… Un jeune qui a du temps a désormais le choix entre regarder une série sur Netflix, jouer en réseau, discuter avec ses copains sur Snapchat ou Whatsapp ou regarder un match de tennis ! Les autres formats sont mieux adaptés aux jeunes qui veulent des choses dynamiques, rapides, modernes. Un match de tennis, c’est un contenu ancien, long, lent. Cette crise est aggravée dans le tennis par le fait qu’il y a une gouvernance trop éparpillée. Cela nuit à la compréhension des compétitions dont les règles changent d’un tournoi à l’autre.
Il faudrait une organisation qui coordonne l’ensemble ?
P.M. : Sans doute, mais chaque entité s’accroche à son propre pouvoir. Les grands chelems, les différents circuits, etc. Au bout du compte, cette politisation à l’extrême nuit au tennis. Et moi, je ne fais pas de politique.
Puisqu’on en parle, pensez-vous toujours au poste de capitaine de l’équipe de France de coupe Davis ?
P.M. : Si on fait appel à moi, je réfléchirai. Mais c’est un poste très politique. Or, je ne fais pas campagne, je n’essaye pas de convaincre les joueurs, les dirigeants, etc.
Partant du constat que vous faites sur le tennis mondial, vous avez lancé un nouveau circuit, l’Ultimate Tennis Showdown (UTS). Quelle ambition avez-vous pour l’UTS ?
P.M. : Le tennis doit renouveler sa fan base et donc intéresser les jeunes. Or, aujourd’hui, il vit sur ses acquis qui remontent aux années 70. Avec UTS, je ne veux pas changer le tennis que j’adore et auquel je reste loyal. En revanche, nous avons créé un produit annexe pour recruter un public jeune qui correspond beaucoup plus à la manière dont ce public consomme la vidéo. Nous proposons un spectacle plus court, dynamique, vivant, immersif.
Immersif ?
P.M. : Le tennis à la télé est un spectacle distancié. Les caméras sont très loin. Lors des matchs UTS, la caméra est à l’intérieur du court. Les journalistes peuvent poser des questions aux joueurs au changement de côté pour évoquer leurs stratégies, le coaching est autorisé et retransmis en direct, on vit le match de l’intérieur.
Quelles sont les autres innovations d’UTS ?
P.M. : Nous avons mis au point un système de cartes à points qui permet de relancer un match déséquilibré. Ainsi, le suspense reste entier quel que soit le scénario de la rencontre. Par ailleurs, on raconte une histoire qui va plus loin que deux gars qui tapent dans la balle pour gagner. Nous laissons les joueurs exprimer leurs émotions qui sont interdites sur le circuit traditionnel. On a le droit de casser une raquette… On dit aux participants : exprimez-vous, montrez qui vous êtes ! Nous ne sommes pas là pour donner des leçons de morale. Dans les années 80, on avait des Connors, McEnroe, Nastase qui donnaient un spectacle infiniment plus intéressant. Je veux recréer ce climat.
Et ça marche ?
P.M. : Les premiers tournois ont été diffusés dans 100 pays de cinq continents. Le pari du rajeunissement a été gagné, 50 % de nos spectateurs ne regardaient jamais le tennis auparavant. Ceci alors que la tendance des télés est de se désengager du tennis. L’UTS peut faire revenir du public vers l’ATP et la WTA. Nous ne sommes pas concurrents mais complémentaires.
L’ATP ne voit pas les choses comme ça…
P.M. : Je ne peux pas parler à leur place mais l’ATP est consciente des problèmes. Moi, je me positionne clairement en partenaire. Je propose même de mettre l’UTS sous l’égide de l’ATP. Il peut y avoir deux ligues pros différentes, avec des règlements différents, qui cohabitent sous la tutelle de l’ATP. 2020 a été notre première saison mais 2021 sera notre vrai lancement avec la création d’un classement et d’un « masters ».
Et financièrement ? C’est rentable ?
P.M. : Nous avons investi 100 % sur les fonds propres de Mouratoglou Tennis Group et de la holding qui chapeaute l’ensemble de nos activités, même celles qui sont hors tennis comme les parcs de trampoline. Nous en possédons une trentaine en France qui marchent très bien. Nous sommes leader en France et numéro 2 européen. Et les projets ne manquent pas. Je ne peux pas tout dévoiler mais celui auquel je tiens beaucoup, c’est une appli de e-coaching. Cela fait dix ans que j’y pense, l’intelligence artificielle permet vraiment de la faire aujourd’hui. Pour en revenir à l’UTS, nous avons pris en charge le premier investissement pour démontrer que ça marche. Nous avons eu plusieurs top 10 parmi lesquels Thiem, Tsitsipas et Zverev, des Français comme Gasquet et d’autres, et tous ont demandé à revenir car ils ont adoré. Il y avait des prize money intéressants. Maintenant, nous sommes en phase de levée de fonds pour passer à la vitesse supérieure. C’est la banque Lazard qui s’en charge, ses dirigeants y croient car c’est un projet international.

Vous aimez être disruptif dans le business ?
P.M. : Oui. J’aime faire des choses qui n’ont jamais existé avant. C’est mon mode de pensée, « out of the box » comme disent les Américains.
Vous avez le goût du risque ?
P.M. : Oui mais je ne joue pas au casino. Je prends des risques mesurés.
Pourquoi mettez-vous autant votre nom ou votre initiale « M » en avant dans vos activités ? C’est de l’ego ou du marketing ?
P.M. : Quand j’ai démarré l’académie en 1998, je me suis dit qu’il me fallait une marque. Après avoir négocié avec lui, j’ai choisi le nom de Bob Brett qui était un très grand coach. L’académie Bob Brett a duré six ans. Puis il est parti pour monter une académie concurrente à son nom ! Là, je me suis dit : « Tu as fait le pire investissement de ta vie. » Donc j’ai décidé de mettre mon nom en avant pour incarner ma philosophie de coaching. Le problème est que je n’avais pas encore une grande réputation de coach. L’académie Mouratoglou est née en 2006 et en 2012, j’ai gagné mon premier Grand Chelem. À présent, la marque a de la valeur, je vais donc au bout de la logique de son développement. Pour ce qui est de l’ego, j’en ai évidemment et tant mieux, c’est nécessaire pour réussir de grandes choses.
Pour finir, un mot de votre activité de mécénat tourné vers les jeunes talents.
P.M. : Via ma fondation, j’ai réuni des donateurs fanas de tennis pour aider des jeunes qui n’en ont pas les moyens à s’accomplir. Tsitsipas ou Coco Gauff par exemple sortent de la fondation. L’actuel champion du monde junior aussi. On les aide financièrement mais, surtout, on leur apporte les compétences dont ils ont besoin pour progresser. En clair, on supervise leur projet tennis, sans que l’académie n’en tire le moindre bénéfice. Je ne mélange pas business et philanthropie.
<<< À lire également : Maria Sharapova Prend Sa Retraite Du Tennis A La Tête D’Une Petite Fortune >>>

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits