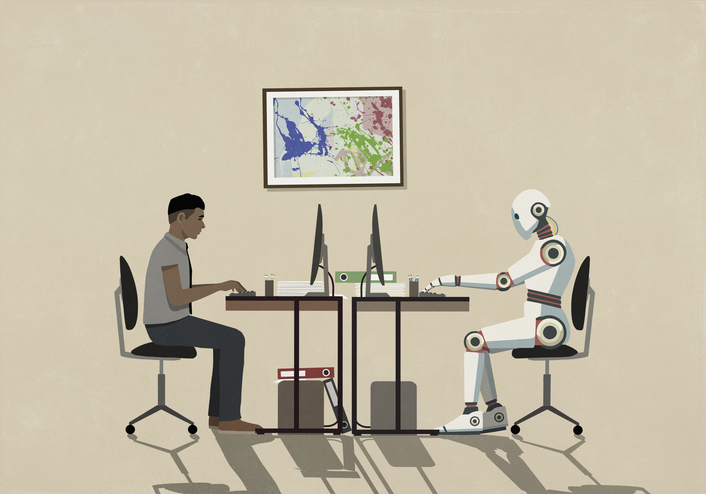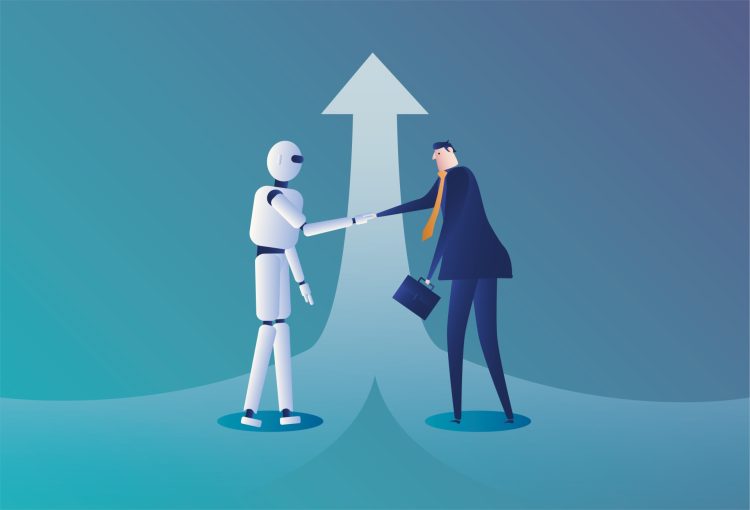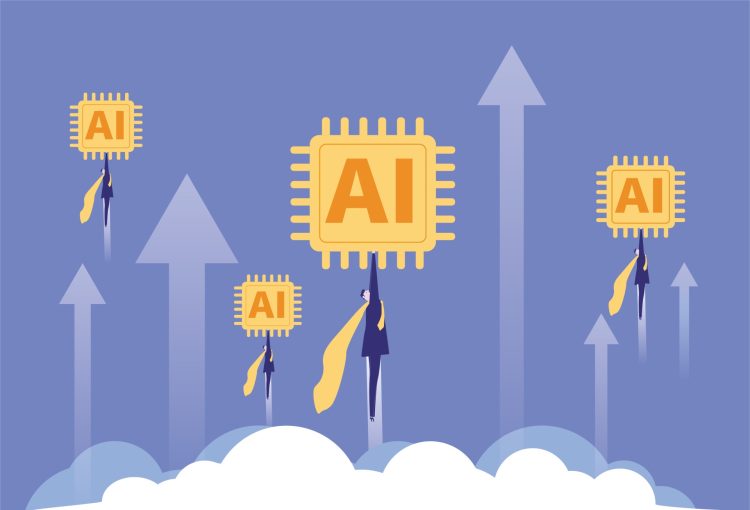Une récente étude de l’université de Stanford met en garde les entrepreneurs en intelligence artificielle. En interrogeant 1 500 salariés de 104 professions différentes, les chercheurs ont découvert que 41 % des tâches automatisées par les start-ups de Y Combinator concernent des activités jugées peu prioritaires, voire déconseillées à automatiser.
Autrement dit, une large part des outils développés ciblent des missions que les employés ne souhaitent pas voir prises en charge par des machines. Malgré la frénésie autour du recrutement de talents en IA, les fondateurs semblent souvent s’atteler à des problématiques que les travailleurs jugent peu importantes, voire délicates.
En s’appuyant sur la base de données O*NET du département du travail des États-Unis et une nouvelle échelle baptisée Human Agency Scale, l’équipe de Stanford met en lumière un décalage majeur : les start-up soutenues par le capital-risque concentrent leurs investissements sur l’automatisation des tâches créatives et managériales, tandis que les salariés demandent avant tout un soutien pour les tâches répétitives et routinières. Ce déséquilibre se traduit par des milliards de dollars mal investis et une opportunité colossale manquée d’améliorer la productivité sur le terrain.
Pour les salariés, l’IA doit automatiser les corvées, pas les tâches créatives
À l’inverse, les travailleurs souhaitent que l’IA prenne en charge les tâches répétitives et fastidieuses du quotidien, plutôt que celles qu’ils trouvent stimulantes. L’étude de Stanford révèle que les tâches prioritaires pour l’automatisation, selon les salariés, sont essentiellement routinières : gestion des notes de frais, saisie de données, production de rapports, résolution de problèmes informatiques. Par exemple, une enquête menée par UiPath auprès de 6 400 employés montre que les tâches les plus plébiscitées pour l’automatisation sont l’analyse de données (52 %), la saisie ou création de bases de données (50 %), la résolution de problèmes IT (49 %) et la génération de rapports (48 %). Selon ProcessMaker, un employé de bureau consacre 10 % de son temps à la saisie manuelle et plus de la moitié à la création ou la mise à jour de documents. Pour 69,4 % des répondants, l’IA est avant tout un moyen de « libérer du temps pour des tâches à forte valeur ajoutée », plutôt qu’un substitut aux aspects créatifs ou plaisants de leur travail.
Ironiquement, les start-up font souvent l’inverse. Plutôt que de s’attaquer aux corvées, elles développent des outils pour automatiser des tâches de stratégie, marketing ou gestion client ; des domaines que les salariés préfèrent garder sous contrôle humain. Le résultat frôle le ridicule : pendant que les employés croulent sous des milliers de copier-coller hebdomadaires et attendent des validations de frais, les start-up visent des cas d’usage séduisants mais peu prioritaires. Certaines études estiment que 26 % du temps de travail d’un employé de bureau est perdu dans des tâches inutiles (soit environ 76 jours par an et par salarié), et près de la moitié des dirigeants pensent qu’une meilleure technologie pourrait améliorer la productivité. Pourtant, 41 % des projets IA soutenus par Y Combinator ciblent précisément les tâches que les salariés jugent les moins prioritaires à automatiser.
Les investissements en automatisation manquent leur véritable objectif
Le capital-risque alimente ce décalage. Au premier trimestre 2025, un record de 73,1 milliards de dollars (soit 57,9 % du total des financements en capital-risque) a été investi dans les start-up spécialisées en IA et machine learning, dans le cadre de la course mondiale à l’intelligence artificielle. Les investisseurs recherchent avant tout des ruptures technologiques spectaculaires, au détriment des gains progressifs de productivité. Mark Goldberg, investisseur de longue date chez Index Ventures, confiait au Wall Street Journal qu’après l’arrivée de ChatGPT, les investisseurs sont tombés dans une forme de « pensée magique », espérant que la valeur de l’IA se matérialiserait à la vitesse de la lumière. En réalité, cette ruée vers les financements a conduit les fondateurs à privilégier les démonstrations tape-à-l’œil, au détriment des besoins concrets des utilisateurs.
Les chiffres dressent un constat alarmant : plus de 90 % des start-up en IA échoueraient dans les cinq ans, et 42 % des entreprises auraient abandonné la majorité de leurs projets IA, faute d’alignement avec des problématiques réelles. Autrement dit, en négligeant les besoins concrets des salariés, beaucoup parient sur des technologies spectaculaires qui ne rapportent rien. Pendant ce temps, les tâches essentielles, mais « ennuyeuses », restent largement délaissées.
Humains et IA : un partenariat équilibré, pas une substitution
L’un des enseignements les plus marquants de l’étude est que les salariés souhaitent collaborer avec l’IA, sans pour autant être remplacés. Stanford a mis au point une Human Agency Scale allant de H1 (automatisation complète) à H5 (contrôle 100 % humain), révélant une tendance nette : dans 47 des 104 métiers analysés, la préférence dominante est H3, c’est-à-dire un partenariat équilibré entre l’humain et l’IA. Même lorsque l’IA est capable d’exécuter une tâche seule, les salariés préfèrent souvent conserver leur implication. Globalement, ils réclament un niveau de supervision humaine plus important que celui jugé nécessaire par les experts en IA dans près de la moitié (47,5 %) des tâches.
Ce constat rejoint la célèbre formule de Sundar Pichai, PDG de Google : « Le futur de l’IA n’est pas de remplacer les humains, mais d’augmenter leurs capacités. » Pour les salariés, l’IA doit avant tout supprimer les corvées ingrates, sans leur ôter leur rôle central. Edward Houghton, du Chartered Institute of Personnel & Development au Royaume-Uni, insiste : « L’automatisation permet de valoriser la dimension humaine et de tirer parti des relations, difficiles à automatiser. » En pratique, les entreprises qui conçoivent des outils d’IA pour renforcer plutôt que remplacer l’effort humain trouveront plus facilement succès et adhésion.
Confiance et burnout : une résistance à l’automatisation
Même lorsque l’IA se révèle utile, la méfiance reste forte parmi les salariés. Selon Stanford, le principal frein à son adoption (45 %) est le manque de confiance dans la précision et la fiabilité des systèmes. La crainte de perdre son emploi (23 %) et la perte du « contact humain » (16 %) figurent également parmi les préoccupations majeures. Ce déficit de confiance se reflète dans les sondages : seuls 55 % des employés font confiance à un déploiement responsable de l’IA, contre 62 % des dirigeants. Par ailleurs, un nombre croissant de salariés refusent tout simplement d’utiliser ces outils.
Un rapport récent révèle que 31 % des employés (et 41 % chez la génération Z) reconnaissent avoir « saboté » des projets d’IA en boycottant les outils mis à leur disposition. Kevin Chung, directeur stratégique chez Writer, explique : « Il y a deux ans, la majorité pensait : “Pourquoi former ce robot qui risque de me voler mon travail ?’”Aujourd’hui, après l’avoir testé, beaucoup sont déçus par les résultats et s’en désillusionnent. »
Autrement dit, cette résistance ne traduit pas un attachement aux tâches administratives, mais une frustration face à des IA souvent décevantes. Pour inverser la tendance, transparence et implication sont indispensables : exclure les salariés ne fera qu’aggraver burnout et méfiance. Comme le souligne Sarah Elk, de Bain : « Si l’IA est perçue comme une boîte noire imposée aux équipes, la confiance ne s’établira pas… Les résultats sont bien meilleurs lorsque les utilisateurs sont associés dès le départ. »
Les gains tangibles d’une automatisation bien ciblée
Après avoir identifié les mauvais axes d’investissement, il est temps de se concentrer sur les économies réelles qu’offre l’automatisation des bonnes tâches. Par exemple, 26 % du temps de bureau est englouti par des tâches administratives inutiles, avec en moyenne 42 minutes par jour consacrées à des activités sans valeur ajoutée et 24 minutes aux notes de frais. Dans une équipe de 20 personnes, cela représente plus d’un million d’actions de copier-coller chaque année. Automatiser ne serait-ce qu’une partie de ces tâches pourrait générer des économies considérables.
Ces chiffres révèlent une opportunité majeure : les plus grands gains résident dans les tâches « peu glamour ». Plutôt que de se focaliser sur le prochain chatbot à la mode, les entrepreneurs gagneraient à s’attaquer aux corvées ennuyeuses et chronophages que les salariés rejettent. Pour les entreprises, cela signifie transformer du temps perdu en temps productif, avec à la clé des économies substantielles.
La voie à suivre : écouter ses salariés
Les conclusions de Stanford révèlent une évidence : réussir avec l’IA, c’est d’abord répondre aux besoins humains, pas céder à la fascination technologique. Les dirigeants gagneraient à suivre le conseil de Sundar Pichai en privilégiant le partenariat plutôt que le remplacement, en concevant des systèmes en lesquels les salariés peuvent avoir confiance. Cela passe par une implication réelle des équipes dans la conception, une totale transparence sur les capacités des outils, et une formation adaptée aux nouveaux rôles centrés sur l’humain.
Du côté des investisseurs et des fondateurs, il est temps de tempérer l’enthousiasme et de se poser la bonne question : résolvons-nous un problème réel ? Adopter une approche centrée sur l’humain, en développant des assistants pour les tâches répétitives et fastidieuses, pourrait ouvrir des marchés immenses. Ce n’est peut-être pas spectaculaire, mais c’est ce que les salariés attendent.
L’étude met en lumière un angle mort coûteux : l’industrie de l’IA s’est trop souvent demandé « peut-on le faire ? » alors qu’elle devrait se demander « doit-on le faire, et est-ce que les utilisateurs en ont vraiment besoin ? »
Aujourd’hui, 41 % des outils d’IA se trouvent dans la zone de « non-recommandation » car ils négligent les besoins des utilisateurs. Les entreprises qui réussiront seront celles qui écouteront leurs salariés et cibleront les tâches monotones et répétitives, plutôt que de courir après des rêves technologiques. Dans la course à l’automatisation au service de la productivité, les vrais gagnants seront ceux qui développeront les outils attendus par les salariés, transformant ainsi ce frein de 41 % en une véritable opportunité.
Une contribution de Moin Roberts-Islam pour Forbes US – traduit par Lisa Deleforterie
À lire également : Managers : et si l’IA devenait votre meilleure alliée ?

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits