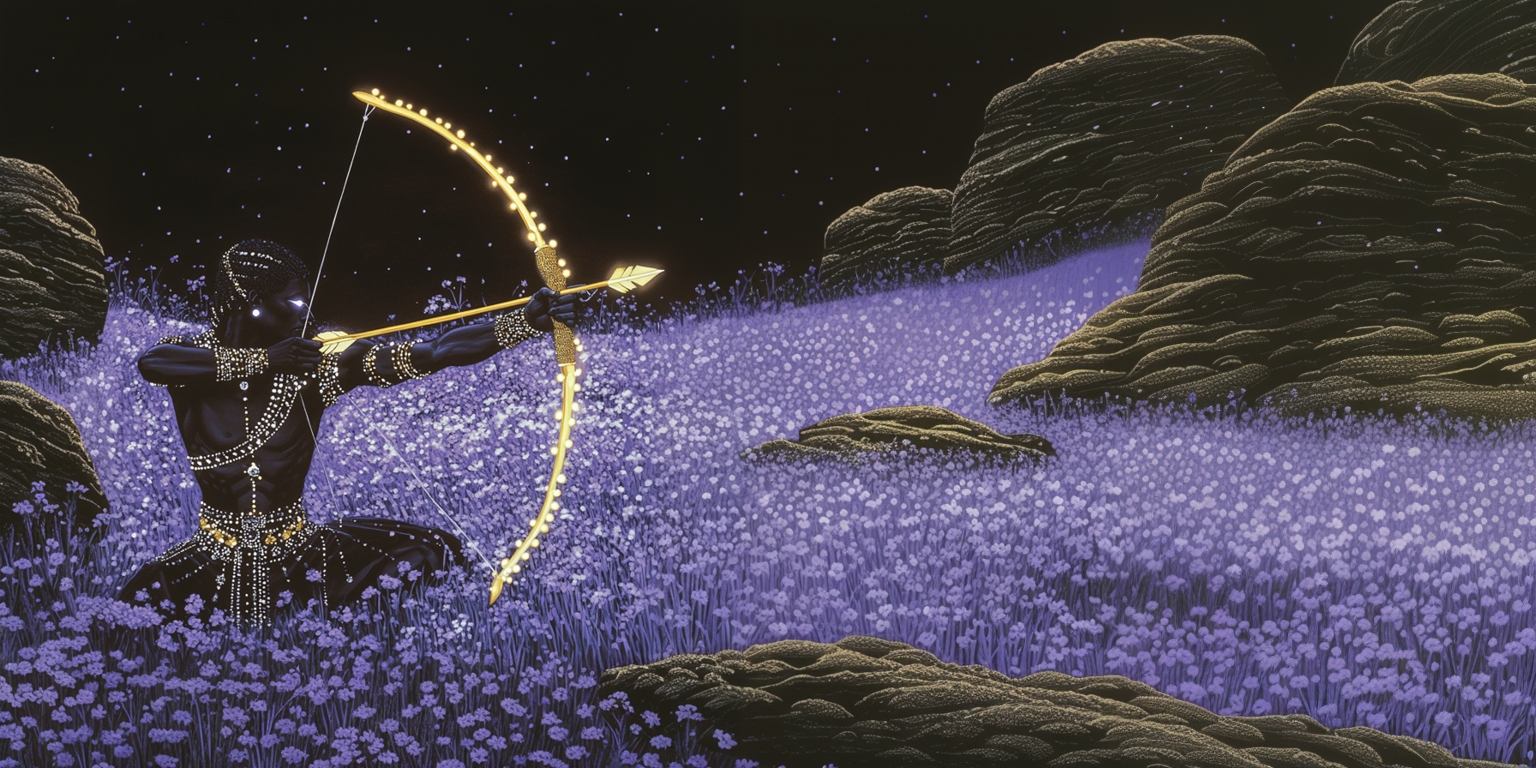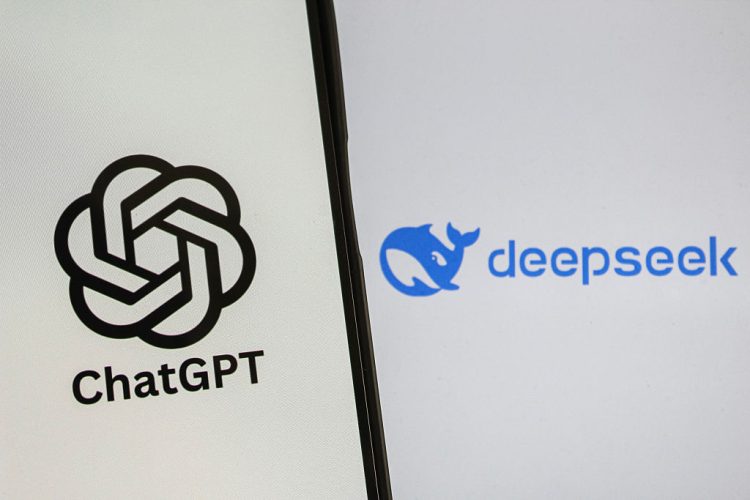Le 18 juillet 2025, un « méga deal » militaire historique est envisagé entre Kyiv et Washington. Ce deal suppose que l’Amérique s’engage à acheter à l’Ukraine des drones conçus pour le champ de bataille du pays. En échange, Kyiv achèterait aussi des armes aux États-Unis et, surtout, partagerait l’expérience acquise pendant les 3 ans de guerre contre la Russie.
Pourquoi les États-Unis sont-ils friands de ce retour d’expérience ? Pour le comprendre, il faut remonter au début de la guerre.
Au début de mars 2022, une colonne russe de soixante-quatre kilomètres avance vers Kyiv. Les images satellites la montrent comme une « chenille de mort », sûre de sa puissance mécanique… jusqu’à ce qu’une trentaine de volontaires de l’unité Aerorozvidka, armés de drones artisanaux, détruisent trois véhicules en tête de convoi ; la route se bloque, l’offensive s’enlise, la chenille de mort finit par faire demi-tour et rentrer en Biélorussie. Trente geeks, quelques kilos de plastique explosif, et du logiciel : l’information vient de prouver qu’elle pèse plus lourd que la tôle.
Cette nuit-là fait basculer la guerre : la victoire n’est plus affaire de tonnage, mais d’algorithme. Les mois suivants confirment ce glissement. La société Palantir installe son système bourré d’IA, Gotham, à Kyiv ; l’outil fusionne données satellites, vidéos de drones et rapports de terrain pour générer des options de tir et collecter des preuves de crimes de guerre. Dans son sillage, Microsoft, Google, Starlink et Clearview transforment l’Ukraine en « AI War Lab » (laboratoire de la guerre IA).
Pour orchestrer cet afflux, Kiev crée Brave1, une plateforme qui attribue désormais le label « Test in Ukraine » aux prototypes validés au combat. Le 17 juillet 2025, le gouvernement ouvre même le front à des fournisseurs étrangers : drones, contre-mesures et lasers peuvent être testés en conditions réelles, avec retour d’expérience quasi immédiat. Le champ de bataille devient incubateur.
La miniaturisation suit. Le Switchblade 300 – trois kilos, une grenade en charge utile, guidage GPS – coûte moins qu’un obus de char et se déploie depuis un tube portatif. Au sol, les chiens-robots BAD-2 de quinze kilos transportent munitions ou kits de déminage ; trente exemplaires patrouillent déjà le Donbass et, anecdote révélatrice, remontent le moral des troupes qui les baptisent comme des mascottes. Face à eux, la Russie intensifie ses vagues de Shahed : près de mille attaques par mois en 2024, plus de trois mille cinq cents en moyenne sur les cinq premiers mois de 2025. L’« essaim » devient la nouvelle unité de feu.
L’OTAN observe, intègre : le 14 avril 2025, l’Alliance signe un contrat record pour déployer le Maven Smart System de Palantir dans sa chaîne de commandement stratégique. La guerre ukrainienne n’est plus un événement lointain ; elle réécrit la doctrine occidentale. Voici cinq leçons pour l’OTAN à l’ère de l’IA.
Première leçon — La masse cède devant l’agilité
La doctrine classique reposait sur des « capacités de dissuasion » mesurées en chars, en tubes d’artillerie et en tonnes de kérosène. Or un essaim de micro-drones bon marché suffit désormais à saturer ces mastodontes. Les États-Unis ont livré plus de 700 Switchblade 300 : trois kilos d’explosifs, guidage GPS, liaison Starlink, lancement depuis une tranchée glacée. Côté russe, le drone suicide Shahed, à 50 000 € l’unité, devient la cible d’intercepteurs ukrainiens imprimés en série pour dix fois moins cher ; Moscou en tire pourtant plus de mille par semaine au printemps 2025. Le rapport coût-efficacité, jadis favorable au gros tonnage, s’inverse : frapper « mille petits coups » ruine un ennemi mécaniquement supérieur sans grever le budget du défenseur.
Deuxième leçon — La chaîne de frappe (« kill chain ») se distribue
Hier, la kill chain se découpait en trois séquences : détecter, planifier, engager. Aujourd’hui, ces maillons fusionnent dans la tablette d’un chef de section. Les flux vidéo des drones, analysés par modèles de vision et LLM locaux, livrent en quelques secondes une recommandation de trajectoire ou de frappe. L’opérateur valide d’un geste et la munition rôdeuse part. La boucle OODA — Observe, Orient, Decide, Act, conceptualisée par le colonel John Boyd — se condense : observation et orientation sont prises en charge par l’algorithme, décision et action s’exécutent presque simultanément. Les centres de commandement deviennent des nœuds de synchronisation plutôt que des goulots d’étranglement. Toute organisation trop hiérarchisée perd d’emblée le tempo.
Troisième leçon — Le brouillard se déplace d’identification vers l’attribution
Voir l’ennemi n’a jamais été aussi facile : capteurs satellites, données open source, réseaux sociaux et drones quadricoptères mettent le champ de bataille sous haute résolution permanente. Le vrai brouillard se loge désormais dans la question qui décide et comment : un tir mortel vient-il d’une routine automatique ? D’un centre allié ? D’un opérateur isolé ? Comment prouver la présence — ou l’absence — d’un doigt sur la gâchette numérique ? Dans cette guerre narrative, l’auditabilité des algorithmes devient une arme diplomatique.
Quatrième leçon — L’innovation suit le rythme des déploiements logiciels
Un char Leopard évolue par tranches de dix ans ; un drone FPV ukrainien passe de la version 1.0 à 1.3 en six semaines. Le label « Test in Ukraine » permet à un constructeur européen de valider un drone terrestre en trois mois, retours d’expérience concrets à la clé. Chaque offensive teste une mise à jour, chaque repli déclenche un correctif. L’OTAN, dont les programmes s’étalent encore sur dix ans, doit apprendre à versionner ses arsenaux comme on versionne du code : correctifs, rollback et mises à jour en flux tendu.
Leçon 5 — La dissuasion change de registre
La terreur nucléaire reposait sur la promesse de dommages apocalyptiques. Or une hyperarme logicielle, furtive, réplicable et peu coûteuse, peut aujourd’hui infliger une paralysie énergétique ou économique sans atteindre le seuil nucléaire. Quand Palantir adapte Gotham pour cartographier en temps réel les infrastructures russes, elle fournit à Kiev la capacité de déjouer — ou de menacer — un réseau ferroviaire entier en quelques clics. La crédibilité de la « punition massive » s’effrite : l’escalade devient plus probable, la ligne rouge floue. Il faut dès lors concevoir une dissuasion algorithmique — reposant sur la résilience des réseaux, la redondance des capteurs et la transparence de l’IA — qui complète, sans la remplacer, la dissuasion nucléaire. Le contrat Maven-OTAN illustre déjà cette bascule : sécuriser le code devient protéger le territoire.
Dans mon livre sur la géopolitique de l’IA, Hyperarme (NIV, 2025), j’écrivais que le monde de l’information s’était invité dans l’industrie comme Tesla s’était invité dans l’automobile : en inversant l’ordre établi. En Ukraine, le même renversement frappe l’art militaire : le capital décisif n’est plus l’acier, mais la ligne de code qui éclaire, vise et frappe avant que l’adversaire ne comprenne qu’il est déjà dépassé. Pour l’OTAN, le défi n’est plus seulement d’acheter des drones ou de brancher de nouveaux capteurs ; il est d’intégrer, d’itérer et de gouverner un écosystème d’armes qui apprennent plus vite que les états-majors ne délibèrent. C’est cette expérience, acquise par l’Ukraine par la force des choses, qui intéresse tant les États-Unis et les pousse à envisager un accord-cadre faisant de l’Ukraine un partenaire industriel privilégié.
La colonne de 64 km n’avait pas seulement trop peu de carburant ; elle avait surtout un siècle de retard logiciel.
À lire également : La souveraineté numérique européenne : un défi existentiel à l’ère du cloud

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits