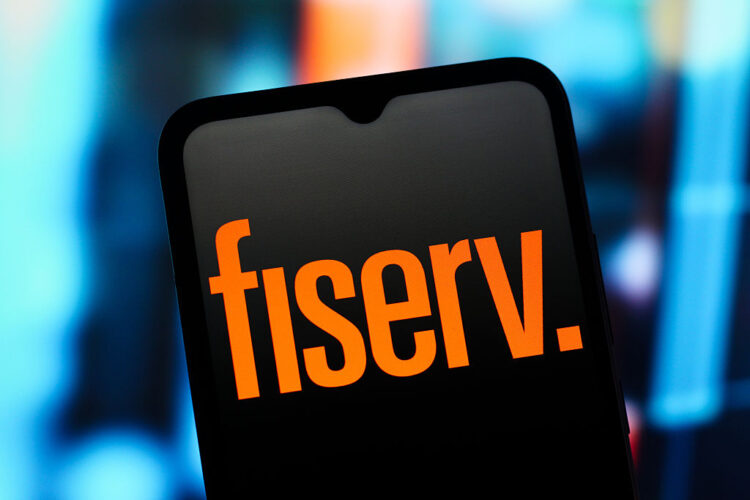Une tribune écrite par Valérie Pilcer – Administratrice indépendante, spécialiste en gouvernance et risques et coach en IA générative
Depuis deux ans, l’intelligence artificielle générative a bouleversé le paysage professionnel, et ce n’est qu’un début. Ce qui relevait hier de la science-fiction est désormais accessible via une simple interface. Résumer un document, simuler un scénario, analyser un contrat, identifier des signaux faibles, préparer un discours ou une stratégie : autant d’actions que les dirigeants peuvent aujourd’hui déléguer à des outils comme ChatGPT, Claude, Copilot ou d’autres modèles de langage.
Mais à mesure que la technologie progresse, une vérité s’impose : l’IA ne remplace pas la décision, elle redéfinit le décideur.
Une nouvelle posture de leadership
Un dirigeant qui s’appuie sur l’IA ne délègue pas son pouvoir de décision. Il en augmente la portée, la vitesse et parfois la profondeur. Encore faut-il maîtriser les fondamentaux et éviter les pièges. Comment interroger un modèle de langage ? Comment structurer sa pensée pour que la machine la comprenne ? Quels sont les biais des modèles, leurs limites, leurs angles morts ? Comment vérifier leurs réponses ? Quels usages sont pertinents, et lesquels sont risqués ?
Ces questions dessinent une nouvelle responsabilité : le dirigeant devient chef d’orchestre de la machine.
Les promesses trompeuses de la performance immédiate
La première erreur est de croire que l’IA fonctionne comme un moteur de recherche. Tapez une question vague, et vous obtiendrez une réponse vague. Demandez un résumé, et vous aurez un texte lisse, séduisant, mais parfois creux.
Pour obtenir des résultats à la hauteur de vos attentes, il faut apprendre un nouveau langage : le prompt. Pas besoin de coder, ni de comprendre en détail la mécanique interne des Large Language Models. Mais il est essentiel de maîtriser cette grammaire d’interaction avec la connaissance, avec ses règles, ses codes et ses pièges. Comme pour toute langue, un apprentissage s’impose.
Une armée de jeunes stagiaires brillants (mais imprévisibles)
L’IA peut donner l’impression de dialoguer avec un expert universel. En réalité, l’image la plus juste est celle d’une équipe de stagiaires : rapides, créatifs, mais imprévisibles. Ils produisent du contenu, des idées, des synthèses, des hypothèses. Mais ils n’ont pas le recul, la hiérarchie des priorités, ni l’intuition forgée par l’expérience.
C’est donc au dirigeant de jouer un rôle d’encadrement : cadrer la demande, vérifier à chaque étape, affiner progressivement. Sans cela, les recherches peuvent partir dans la mauvaise direction, l’abondance de données peut se transformer en confusion et l’utilisation de ces outils peut finalement faire perdre du temps plutôt que d’en gagner ! Exactement comme avec des stagiaires qu’il faut former…
La vérité arrangée
Il est à présent de notoriété publique que l’IA peut parfois vous induire en erreur en affirmant avec aplomb des contrevérités. Ce sont les hallucinations. Un modèle de langage peut inventer une source, un chiffre, un auteur, avec une assurance désarmante. Dans le secteur bancaire, un responsable d’audit interne a demandé à une IA la liste des réglementations européennes à venir en 2025. La réponse semblait solide. Mais deux des textes cités n’existaient pas.
Certes, les modèles intègrent désormais des références de sources. Mais celles-ci doivent toujours être vérifiées. Car une chose est sûre : vous ne pouvez pas faire confiance aveuglément à votre IA. Des techniques existent pour limiter les erreurs (recours à des bases validées, outils de “RAG” Retrieval-Augmented Generation qui interrogent vos propres documents). Mais la vigilance demeure impérative.
Le monde à sa portée
La prochaine étape est déjà là : les agents IA. Contrairement aux modèles actuels, qui se contentent de répondre à une requête, ces agents enchaînent des tâches, mobilisent des outils, accèdent à des bases de données externes et prennent des initiatives dans un cadre défini.
Imaginez un agent chargé de surveiller en permanence vos concurrents, d’analyser les évolutions réglementaires, de suivre les tendances géopolitiques, et d’alerter le conseil d’administration dès qu’un seuil critique est franchi. Une aide formidable. Mais aussi un pas de plus vers une délégation implicite : accepter que l’agent choisisse ce qui mérite ou non votre attention.
Se priver de ces outils serait se priver d’un avantage stratégique. Mais leur confier aveuglément son jugement serait une erreur fatale. L’équilibre est délicat : utiliser sans céder.
La formation comme levier de souveraineté intellectuelle
Ces biais révèlent une réalité : sans formation, l’IA peut fragiliser plus qu’elle ne renforce. On en attend trop, ou pas assez. On se limite à des usages marginaux, alors qu’elle pourrait transformer la gouvernance.
Car un modèle de langage n’est pas seulement une promesse d’efficacité opérationnelle. C’est un moyen d’ouvrir des univers de connaissance, de développer sa réflexion stratégique, d’affiner sa capacité à questionner, et de renouveler son regard sur l’entreprise.
Exercer son rôle de dirigeant avec l’IA suppose donc l’acquisition de compétences nouvelles. Il s’agit de savoir structurer les prompts pour poser les bonnes questions, de maîtriser des techniques de contrôle qualité pour vérifier les réponses, d’intégrer la gestion éthique et décisionnelle pour prévenir les biais et respecter les cadres de conformité, et, de plus en plus, de savoir configurer son propre assistant personnalisé, adapté à son rôle, à sa posture et à ses priorités.
Contrairement à ce que l’on croit, l’IA ne simplifie pas la décision : elle la rend plus exigeante. Elle oblige à poser des questions claires, à structurer le raisonnement, à expliciter les critères d’arbitrage. Elle révèle la complexité au lieu de la masquer.
Elle devient alors un miroir cognitif, qui oblige à clarifier sa pensée, à explorer ses angles morts, à identifier ses propres biais. En ce sens, l’IA est une école de rigueur intellectuelle. Elle ne pense pas à notre place : elle nous oblige à mieux penser.
Conclusion : la nouvelle langue du leadership
La véritable révolution de l’IA n’est pas technique, elle est cognitive. Elle n’impose pas seulement de nouveaux outils, mais une nouvelle discipline, une transparence accrue, une langue nouvelle du leadership. Celle du prompt clair, du contrôle exigeant, du dialogue permanent avec la machine.
Ignorer cette mutation, c’est courir le risque d’une dépendance stratégique. L’embrasser, c’est renforcer sa souveraineté intellectuelle, sa capacité d’anticipation et son pouvoir d’orienter le collectif.
Le cadre général est ainsi fixé. Dans les prochains épisodes, nous explorerons, domaine par domaine, comment l’IA transforme la posture des dirigeants et des administrateurs, que ce soit au Comité Exécutif ou dans les comités spécialisés du Conseil d’administration. Car demain, aucun comité spécialisé, qu’il s’agisse d’audit, de stratégie, de RSE, de rémunérations ou d’innovation, ne pourra faire l’économie de cette révolution cognitive.
À lire également : Célébrer nos champions IA Européens ne suffit pas, il faut maintenant leur faire confiance

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits