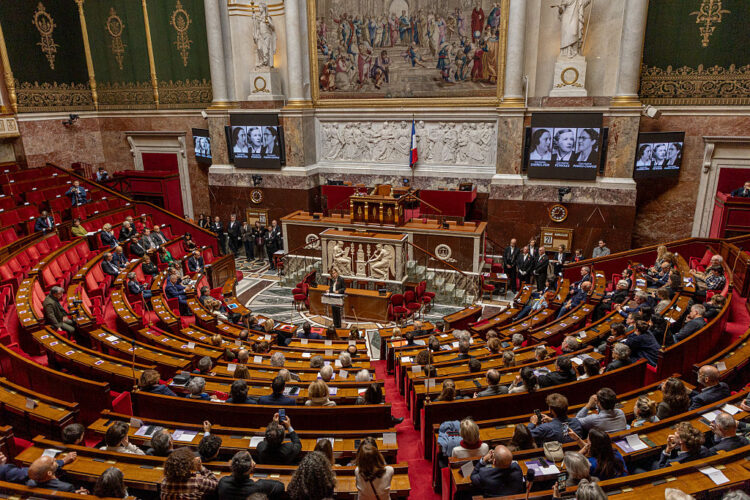Une tribune écrite par Par Charles Pfister, co-fondateur du Groupe Yespark
À Paris, la voiture occupe près de 50 % de la voirie, alors qu’elle ne représente qu’un tiers des déplacements. En face, les piétons, qui réalisent près de la moitié des déplacements, n’ont accès qu’à 43 % de l’espace public. Quant aux cyclistes, leur part explose, mais les infrastructures restent limitées, et les services de proximité (livraison, logistique, végétalisation) peinent à trouver leur place.
Les élections municipales de 2026 devront s’emparer de cette question. Non pas pour mener une guerre à la voiture, mais pour faire des choix clairs sur l’usage d’un espace public devenu rare et stratégique. Car la crise que traversent nos villes n’est pas une crise d’espace, mais une crise d’usage.
Quand la ville étouffe
En ville, une voiture reste immobile 95 % du temps. Ce simple fait suffit à interroger notre gestion de la voirie. Avec un autre regard, tout change : une place de stationnement sert en moyenne 3 conducteurs par jour. Cette même place peut permettre à 12 cyclistes de stationner leur vélo, peut accueillir une terrasse de café pour 8 à 10 personnes ou encore un îlot végétalisé qui bénéficiera au bien-être de centaines d’habitants.
80 % de la ville de demain existe déjà. L’enjeu n’est pas de construire toujours plus, souvent au prix de l’artificialisation, mais de réutiliser mieux : valoriser les ressources invisibles, les croisements d’usage, la réversibilité du bâtiment. Cela suppose de sortir du réflexe de l’expansion pour adopter une stratégie de sobriété intelligente : mutualiser les espaces, reconvertir les usages, intensifier ce qui fonctionne déjà.
Appel aux collectivités pour faire bouger les lignes
En 2026, il faudra trancher : poursuivre le statu quo, c’est figer la ville dans un modèle inefficace et inéquitable. Assumer une nouvelle organisation de l’espace, c’est préparer une ville plus fluide, plus sobre, plus résiliente.
À l’heure où le foncier se raréfie et où chaque mètre carré est convoité, continuer à privilégier un usage aussi peu actif est un contresens économique, écologique et urbain.
L’espace public doit être géré comme un bien commun vivant, à adapter en fonction des besoins réels. Cela implique une bascule stratégique autour de trois leviers :
- Réduire progressivement le stationnement en surface, avec des objectifs mesurables et différenciés selon les territoires. Par exemple : 10 % par an dans les zones denses bien desservies. A ce jour, la Ville de Paris a par exemple supprimé plus de 10 000 emplacements pour transformer et végétaliser l’espace urbain.
- Réorienter le stationnement vers les parkings hors voirie, existants, souvent sous-utilisés, et bien mieux intégrés dans le tissu urbain. Prenons l’exemple de Paris, grâce aux parkings souterrains (publics sous-utilisés et privés vacants) Paris pourrait supprimer durablement entre 30 000 et 50 000 places de stationnement en voirie, soit environ 25 % à 40 % du parc actuel, sans réduire la capacité totale de stationnement.
- Instaurer une fiscalité incitative, à l’image du modèle bruxellois COBRACE, qui vise à améliorer la qualité de l’air en régulant le stationnement privé non résidentiel (bureaux, centres commerciaux, institutions, etc.). Ce cadre réglementaire impose une taxe sur les places de stationnement excédentaires, incitant les propriétaires à limiter l’usage exclusif et à ouvrir leurs parkings sous-utilisés à des usagers extérieurs.
Des villes comme Oslo, qui a réorienté plus de 20% de sa voirie vers des espaces piétons et cyclables, l’ont démontré : réduire la place de la voiture en surface ne nuit pas à la mobilité. Au contraire, cela redonne de la lisibilité, de la fluidité et du confort à l’ensemble des usages urbains.
Ce n’est pas un projet contre la voiture. C’est un projet pour la ville. Une ville qui choisit enfin de fonctionner autrement. Face à la saturation, à la pression foncière, aux bouleversements climatiques, chaque place de stationnement en voirie libérée devient une opportunité : planter un arbre, créer un îlot de fraîcheur, étendre une terrasse, tracer une piste cyclable, ou encore accueillir un espace logistique du dernier kilomètre.
À lire également : Quand l’instabilité se paie cher : combien la crise politique coûte-t-elle à la France ?

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits