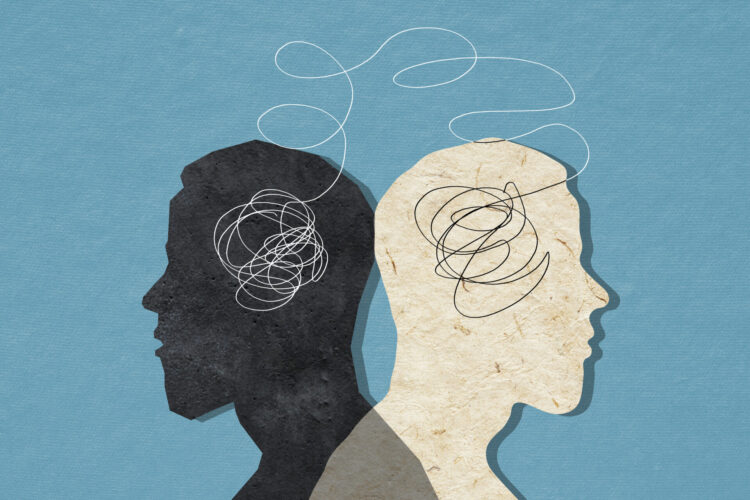Une tribune écrite par Claire Bottineau, Directrice RSE d’Elis
La mode B2B : la circularité symbole de profits et non de coûts
42 nouveaux articles d’habillement neufs par Français en 2024, cela paraît peu et pourtant c’est une donnée qui en dit long sur la surconsommation de vêtements en France. Selon l’éco-organisme Refashion, c’est un article de plus par rapport à 2023. Un chiffre et une tendance qui soulignent la nécessité de ralentir et d’inverser la courbe. Le modèle économique des marques de la fast-fashion, fondé sur le volume, l’obsolescence et le renouvellement permanent, n’est plus soutenable. Mais pour ce faire, il faut changer de paradigme ; autrement dit, considérer les logiques circulaires comme étant un vecteur de création de valeur et non comme une difficulté ou un coût supplémentaire.
Passer de la contrainte à l’opportunité en basculant vers de nouveaux modèles d’affaires peut en effet apparaitre au départ comme une tache insurmontable. Et pourtant, il faut investiguer une autre approche, davantage axée sur le service que sur la propriété. Et ici, le B2B peut servir d’inspiration aux marques. En intégrant l’usage au cœur de leur modèle économique, certaines entreprises du B2B systématisent l’éco-conception pour rendre leurs produits réparables, réutilisables et leur assurer une durée de vie maximale. Certaines ont même démontré que la circularité pouvait parfaitement s’inscrire dans une trajectoire de croissance et de profitabilité à grande échelle. Rappelons également qu’un modèle comme celui-ci encourage l’emploi local et peut constituer un levier pour maintenir ou créer de nouveaux emplois et métiers ! Il peut également agir comme un formidable levier de sensibilisation en proposant sur le lieu de travail des produits qui ne sont pas achetés, mais loués ou mutualisés. Une façon de s’approprier, tester et d’adopter ces modèles et d’en découvrir les bénéfices pour les retranscrire dans la sphère personnelle par la suite.
Économie circulaire : prendre en compte l’ensemble des dimensions
Certaines expérimentations impliquant la notion d’économie circulaire, ne sont que trop isolées pour créer un mouvement de fond ou se cantonnent à certains segments de cette approche. Cette démarche est souvent réduite à la seule intégration des matières recyclées ou au recyclage en fin de vie, occultant les autres boucles (réparation, mutualisation, reconditionnement…).
Il est important de faire comprendre que le recyclage n’est qu’un maillon de la chaîne et qu’il est nécessaire de travailler sur les autres piliers de l’économie circulaire pour avancer. Il faut donc aussi avancer sur la maintenance, la réparation, la réutilisation ou le reconditionnement. Certes, c’est un objectif ambitieux, mais la circularité n’est pas une utopie, c’est une réalité, qui de plus dispose de réels bénéfices environnementaux en réduisant les consommations de ressources (eau, énergie, matières premières…) et les impacts (émissions de CO2 par exemple). La Fondation Ellen MacArthur estime ainsi que « l’économie circulaire est nécessaire pour atteindre le Zéro Emissions Nettes » et que près de « 10 milliards de tonnes de CO2 (soit 20% des émissions mondiales) pourraient être réduites grâce à la transition de certains secteurs vers des modèles circulaires ».
La règlementation ? L’ultime levier
Prouver qu’un modèle peut être durable et rentable ne représente qu’une partie du chemin, convaincre de l’adopter constitue la seconde. Une solution souvent avancée est de passer par la règlementation ; mais les récents exemples montrent que même si ces leviers sont puissants, ils peuvent s’avérer insuffisants dans un contexte socio-économique complexe. Une approche basée sur un changement de paradigme, de success stories et d’innovations de rupture peut être bien plus puissante.
En réalité, ce sont ces réussites emblématiques qui bouleversent et définissent les pratiques. Les exemples de Vinted ou de Leboncoin ont eu un impact fort sur les habitudes de consommation en prouvant qu’un autre modèle est possible. Derrière ces réussites, il faut donc encourager l’innovation, en approfondissant la notion d’économie circulaire, en valorisant d’autres usages, en partageant et dupliquant les bonnes pratiques déjà éprouvées en BtoB ou en trouvant d’autres modèles économiques alternatifs. C’est ainsi que le secteur de la mode pourra contribuer à son échelle à limiter son impact dans une approche économique viable.
Car, au-delà de créer une mode plus durable, il s’agit aussi de saisir l’opportunité de développer de nouveaux marchés et de renforcer la résilience de l’entreprise, devenant ainsi un vecteur de confiance pour l’ensemble des parties prenantes : clients, investisseurs ou salariés.
À lire également : Fast fashion : l’urgence d’une transition vers une mode durable

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits