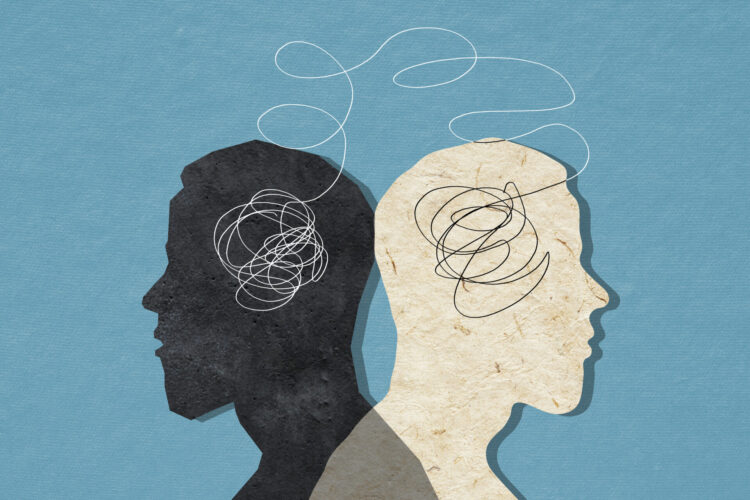Une tribune écrite par Romain Ferré, Directeur de la Promotion de Novaxia Développement
Une ode à la mixité et à la proximité…
Créer des quartiers hybrides capables de mêler logements, commerces, équipements publics, services, lieux culturels, écoles, crèches, espaces de travail, et restaurants, c’est précisément cela, la démobilité. Ou comment favoriser la diversité des usages à l’échelle la plus fine possible. Cela implique de sortir d’une logique binaire qui oppose quartiers résidentiels et quartiers tertiaires, pour construire des lieux complets, intenses, vivants. La logique de mixité induite ici ne relève pas de l’utopie. Elle est déjà à l’œuvre dans de nombreuses opérations de recyclage urbain. Elle répond d’une part aux attentes des élus – qui refusent de voir naître de nouvelles « cités dortoirs » ou des quartiers de bureaux désertés en dehors des jours ouvrés – mais aussi à une demande des citoyens, renforcée post-Covid : celle de passer moins de temps dans les transports et plus dans des lieux de vie qualitatifs. Elle rejoint aussi un enjeu de fond : dans un contexte de réduction du télétravail où les entreprises cherchent à (ré)attirer leurs collaborateurs au bureau, il devient crucial d’offrir un environnement de travail situé dans un quartier vivant, et non isolé.
Prenons l’exemple de ce que l’on appelle dans notre jargon immobilier le QCA (Quartier Central des Affaires), en particulier le triangle d’or du 8e arrondissement de Paris. Pourquoi ce secteur continue-t-il à bien fonctionner malgré la crise du bureau ? Parce qu’il n’est pas monofonctionnel. Il concentre une offre complète : commerces, restaurants, salles de sport, services. On y travaille, mais on y vit aussi. Ce modèle vertueux attire à la fois des entreprises et des habitants. Et il est économiquement plus pérenne : les commerçants et pourvoyeurs de services qui s’y implantent peuvent tabler sur une double clientèle. Une illustration bien loin de ce que l’on peut observer, encore aujourd’hui, dans certains quartiers constitués exclusivement de bureaux, à l’instar de La Défense, qui peinent à exister en dehors des horaires de travail. Dès le vendredi après-midi, les rues y sont vides. Preuve qu’une architecture pensée uniquement pour une fonction finit par appauvrir tout un quartier.
… qui implique de lever les tabous encore prégnants dans l’urbanisme contemporain.
Mais pour parvenir à cette mixité fonctionnelle, encore faut-il pouvoir adapter l’espace urbain. Il nous faut ainsi repenser nos pratiques et accepter que la reconversion ne signifie pas simplement « transformer un bureau en logement ». D’autant plus que les bâtiments existants – notamment les anciens immeubles tertiaires – ne sont pas toujours compatibles avec les nouveaux usages : plafonds trop bas, structures peu modulables, normes inadaptées… D’où la nécessité, parfois, de déconstruire pour mieux reconstruire.
Cette démarche, souvent perçue à tort comme un désastre environnemental, peut au contraire s’inscrire dans une logique de durabilité. Outre le fait de permettre une programmation plurielle, ces opérations de recyclage urbain peuvent et doivent être pensées de sorte à éviter l’étalement urbain dans une logique ZAN+ (Zéro Artificialisation Nette), optimiser les surfaces végétalisées avec un retour à la pleine terre, et réemployer des matériaux issus de la déconstruction dans une logique d’économie circulaire.
La démobilité s’inscrit dans une vision globale : répondre à la crise du logement sans céder à l’artificialisation des sols et réactiver les friches tertiaires et autres bâtiments vacants ou obsolètes en les rendant attractifs. C’est cela, construire la ville sur la ville. Alors que les nouveaux modèles d’aménagement doivent conjuguer écologie, densité, et désirabilité, la démobilité n’est pas une réduction du mouvement, c’est une réactivation de la proximité. Une manière de faire de la ville un lieu de vie en continu, et non une succession de zones spécialisées. C’est une nouvelle grammaire pour penser la ville de demain. Une ville du bon sens, qui rapproche les fonctions, réduit les distances, et restaure les liens.
À lire également : Génération Z : quand la mobilité devient un critère d’attractivité

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits