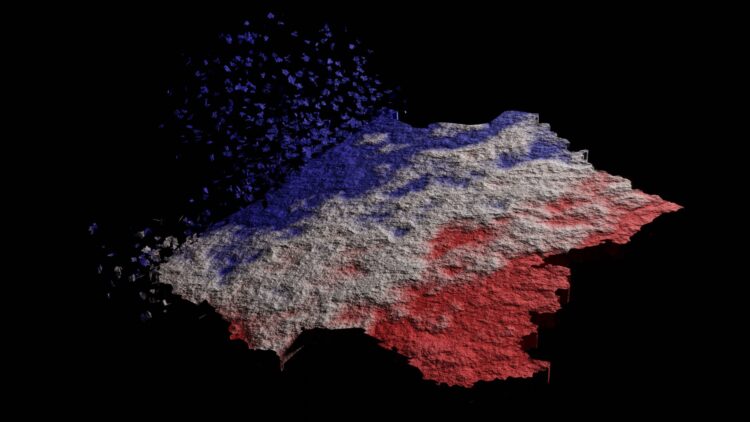Une tribune écrite par Gianmarco Guadalupi, Principal, EFESO Management Consultants
Des modèles industriels obsolètes
Le modèle européen a reposé sur un triptyque performant : maîtrise des motorisations thermiques, diversité produit et ingénierie de haut niveau. Un modèle gagnant tant que la transition technologique restait modérée et que la valeur des composants restait localisée en Europe.
Ce socle est aujourd’hui fissuré. Le passage à l’électrique et aux SDV (software-defined vehicles) redistribue la chaîne de valeur : batteries, composants électroniques et logiciels embarqués sont majoritairement produits en Asie et aux États-Unis. La part de la valeur ajoutée qui reste en Europe lors de la fabrication d’un véhicule a diminué, de 80-90% avant COVID à 30-40%. Les tentatives de rattrapage rencontrent des obstacles : le projet de logiciel Cariad de Volkswagen s’est soldé par deux milliards d’euros de pertes ; Northvolt, figure de proue des batteries européennes, a déposé le bilan début 2025.
Les constructeurs européens entretiennent des gammes trop complexes et peu mutualisées, générant surcoûts, cannibalisation et délais de développement trop longs. Face à Tesla, BYD ou Xiaomi capables d’industrialiser un modèle en deux ans, ils arrivent souvent sur le marché avec des produits déjà dépassés et des ventes inférieures aux prévisions. En parallèle, la montée des tensions commerciales fragmente le commerce mondial, accroît l’incertitude, alourdit les coûts logistiques et fragilise encore les chaînes d’approvisionnement.
Un cadre réglementaire instable, source d’immobilisme
Cette inertie est aussi alimentée par un manque de lisibilité des politiques publiques européennes. Les changements répétés autour de la norme Euro 7, l’incohérence des incitations fiscales liées aux hybrides rechargeables ou encore l’absence de feuille de route claire sur la circularité des batteries ont contribué à désorienter les industriels. L’instabilité du cadre réglementaire a eu pour effet direct de figer les décisions stratégiques et de retarder les investissements.
L’Union européenne n’a pas su, jusqu’à présent, endosser un rôle de chef d’orchestre dans cette transformation systémique. À l’inverse, la Chine a imposé des orientations fermes à ses industriels qui leur ont permis d’anticiper la disruption. Des normes qui visent à sécuriser le marché, contrôler l’innovation et imposer leurs règles à l’international.
Réinventer le modèle industriel : trois leviers structurants
Il faut rationaliser les gammes et plateformes pour favoriser une ingénierie plus modulaire et plus rapide. La complexité actuelle est un frein à l’agilité. La mutualisation doit devenir la norme pour accélérer le développement produit et réduire les coûts d’ingénierie. Ce changement permettrait aux constructeurs européens de réduire leur time-to-market et de réagir plus rapidement aux évolutions technologiques.
Une relocalisation partielle de la chaîne de valeur est également nécessaire. Il est stratégique de recentrer des compétences et capacités de production sur des composants critiques : électronique de puissance, logiciels embarqués, assemblage de modules batteries. Cela suppose la mise en place d’alliances industrielles et un soutien clair des pouvoirs publics via des investissements structurants.
Il faudra enfin opérer un changement de paradigme managérial. La compétitivité future reposera autant sur l’excellence opérationnelle que sur l’agilité stratégique. Les dirigeants devront apprendre à piloter dans l’incertitude, à investir sans attendre une stabilité réglementaire parfaite, et à rompre avec des logiques internes trop rigides. L’adaptation à des cycles courts et imprévisibles nécessitera une nouvelle culture de décision et de risque.
Une industrie à reconstruire dans un nouveau jeu global
L’industrie automobile européenne n’a pas définitivement perdu la course. Mais elle a laissé filer plusieurs longueurs d’avance. Le rattrapage exigera plus qu’une simple adaptation : il s’agira d’une reconstruction.
Alors que les États-Unis dominent le logiciel et que la Chine a pris la main sur l’électrification et l’électronique, l’Europe doit construire son propre avantage compétitif. Elle ne le trouvera ni dans l’imitation, ni dans la nostalgie, mais dans une vision nouvelle de l’industrie : plus modulaire, plus circulaire, plus interconnectée.
À lire également : L’industrie autonome : nouvelle frontière de performance, nouvelle approche

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits