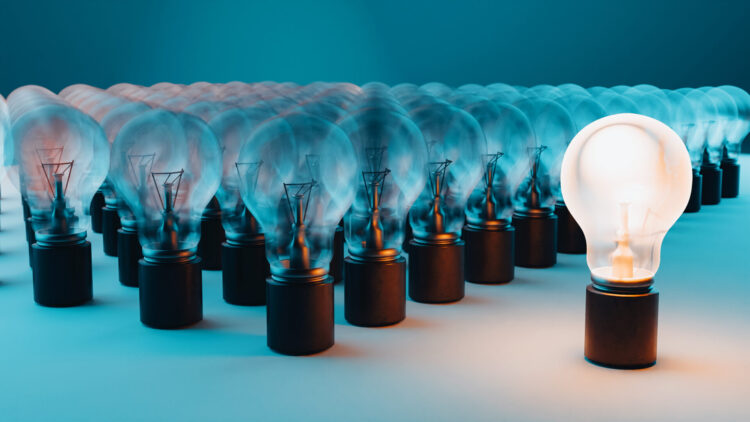Une tribune par Benoit Ranini, président de TNP
Une volonté politique à la hauteur des menaces
La défense européenne ne peut pas se limiter à des discours. Elle exige d’abord une unité stratégique entre les États, qui fait aujourd’hui défaut. Les menaces extérieures s’accroissent : à l’Est avec la guerre en Ukraine, au Sud avec l’instabilité en Méditerranée, et au sein même de nos démocraties avec la montée des ingérences informationnelles. Dans ce contexte, il est urgent de définir une ligne commune, claire et ferme. Cet engagement doit aussi se traduire en chiffres. À La Haye, les membres de l’OTAN ont décidé de tendre vers 5 % du PIB consacré à la sécurité, dont 3,5 % pour l’armée. Mais l’Europe ne peut pas se contenter d’aligner des pourcentages. Les budgets doivent être investis dans des programmes communs, ambitieux et structurants : avion de combat du futur (Scaf), char de nouvelle génération (MGCS), sous-marins nucléaires d’attaque, porte-avions européens. Ces projets phares ne verront le jour que si les États dépassent leurs rivalités industrielles et politiques.
Enfin, la question de la défense ne peut rester confinée aux sommets diplomatiques. C’est aussi une affaire de société. L’effort collectif suppose de reconnaître que la sécurité a un prix : celui de l’impôt, mais aussi de l’engagement. Certains pays recourent déjà à la conscription, d’autres renforcent leurs réserves, d’autres encore encouragent le service civique. Sans cette mobilisation citoyenne, l’Europe risque de bâtir une défense déconnectée des peuples qu’elle prétend protéger.
Une industrie fragmentée qui doit passer à l’échelle
L’Europe dispose d’industriels de rang mondial : Airbus, Dassault, Thales, Safran, Naval Group, Rheinmetall, Leonardo, Saab. Pourtant, face aux mastodontes américains comme Lockheed Martin ou Northrop Grumman, elle reste fragile. Le secteur est éclaté, sous-capacitaire, parfois miné par des rivalités nationales. Cette dispersion nous condamne à dépendre d’alliés extérieurs pour des équipements critiques. Pour rompre cette dépendance, il faut un véritable saut industriel. Cela passe par une consolidation du secteur, l’industrialisation des chaînes de valeur et une accélération des cycles de développement. À l’image de ce qu’a vécu l’automobile dans les années 1980, la défense doit massifier sa production, automatiser davantage et réduire ses délais. Produire plus vite et à moindre coût n’est plus une option : c’est une condition de survie. La question des talents est tout aussi centrale. Sans ingénieurs, techniciens et ouvriers spécialisés, aucune montée en puissance n’est possible. Or, la défense souffre encore d’une image ambivalente auprès des jeunes générations. Pour inverser cette tendance, il faut valoriser l’innovation, la contribution à des programmes stratégiques et le rôle de la défense dans la préservation des libertés. Si nous échouons à susciter des vocations, l’Europe ne pourra pas rivaliser à long terme.
La souveraineté se jouera sur les technologies de rupture
La guerre en Ukraine a rappelé une vérité simple : la supériorité technologique ne suffit pas sans des volumes massifs d’armement. Mais l’inverse est tout aussi vrai. Avoir des stocks d’obus ou de drones ne remplace pas la maîtrise des technologies de pointe. C’est l’alliance des deux qui garantit la supériorité sur le champ de bataille. Or, la souveraineté ne se joue plus uniquement avec des chars ou des missiles. Elle se décide désormais dans le cyberespace, dans l’espace extra-atmosphérique, dans les grands fonds marins. Intelligence artificielle, technologies quantiques, hypersonique, systèmes autonomes en essaim : ce sont ces innovations qui feront la différence dans les conflits de demain. Gagner une guerre, ce sera aussi savoir couper les réseaux électriques ou paralyser les communications d’une ville entière. Dans ce domaine, l’Europe doit adopter une approche hybride. Il ne s’agit plus d’opposer civil et militaire, mais de combiner les deux. Les chaînes de valeur de demain mêleront cybersécurité, cloud souverain, énergie et composants critiques. Et cette hybridation suppose de faire une place aux nouveaux acteurs : PME, ETI, start-up, qui innovent vite et bousculent les méthodes établies. L’avenir de la défense européenne passera par leur intégration dans l’écosystème et par une stratégie de co-investissement public-privé ambitieuse.
Si l’Europe veut demeurer maîtresse de son destin, elle doit investir, consolider et innover. L’alternative est claire : payer aujourd’hui le prix de la souveraineté, ou demain celui de la dépendance.
À lire également : L’industrie automobile européenne face à une crise systémique : repenser le modèle industriel pour survivre

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits