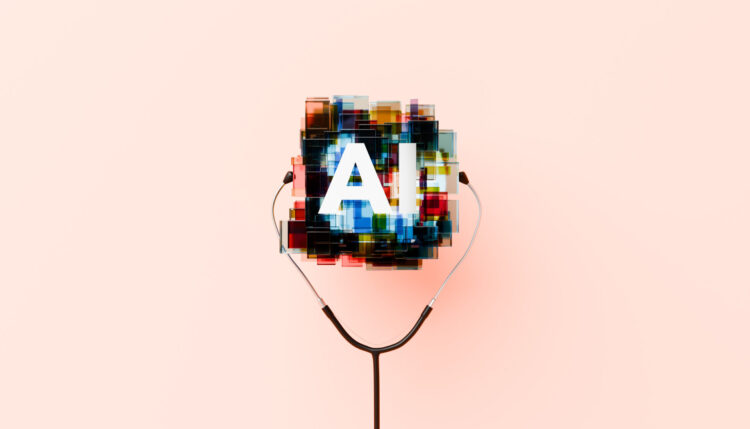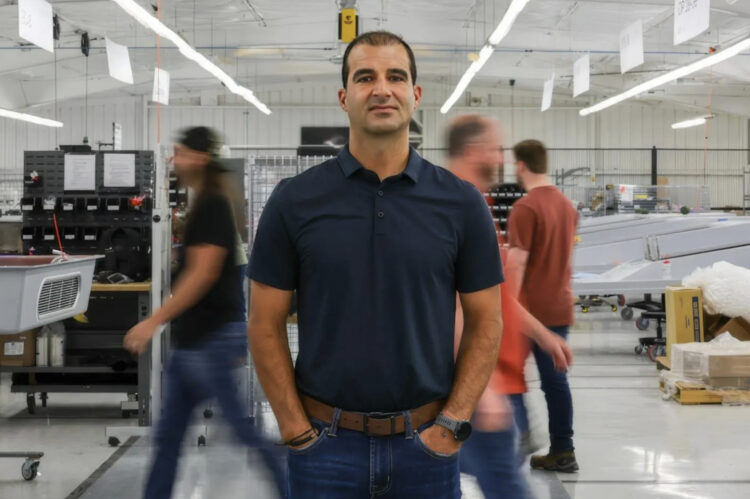Un article écrit par Gilian Berquiere, Senior Manager chez BearingPoint
Ce constat intervient dans un contexte budgétaire tendu. La question du financement de la recherche et de l’innovation demeure un sujet essentiel pour une nation comme la France, d’une part parce que cette recherche est censée construire les succès médicaux, sociaux et économiques de demain ainsi que la croissance des prochaines décennies. À titre d’exemple, la suppression du statut Jeune Docteur, la réduction du taux du Crédit Impôt Innovation (CII) et les restrictions sur le Crédit Impôt Recherche (CIR) inquiètent ; ces mesures pourraient freiner l’embauche de jeunes chercheurs et affaiblir la compétitivité des PME / ETI innovantes.
La recherche constitue aujourd’hui un levier stratégique de souveraineté et d’influence internationale. Dans un contexte d’inflexion géopolitique et technologique, elle devient un vecteur de soft power incontournable, notamment dans des domaines structurants comme l’intelligence artificielle, le quantique ou la transition énergétique, où la France doit impérativement renforcer sa position. Le maintien de l’enveloppe France 2030 est une bonne nouvelle, mais les reports de crédits et les arbitrages budgétaires fragilisent les ambitions affichées.
Les universités, grandes écoles et entreprises jouent un rôle central dans cet écosystème. Le financement des laboratoires de recherche doit être renforcé, notamment pour attirer les talents internationaux. Les partenariats public-privé, les chaires d’entreprise et les structures d’accompagnement à l’innovation doivent être encouragés. Dans le domaine de la santé, la générosité des donateurs ne doit pas être découragée par des rabots fiscaux.
À ce titre, il convient de rappeler le rôle clé des universités, grandes écoles et entreprises dans ce domaine et de ne pas les brider, bien au contraire. Dans le champ des Universités et Grandes Écoles, le financement des laboratoires de recherche devrait être renforcé. Le bilan de Shanghai montre que la France a de bonnes bases, mais est encore distancée. La crise de certains laboratoires de recherche aux États-Unis depuis le début de l’année (financement, visas internationaux) pourrait inciter à capter des chercheurs internationaux, la guerre des talents dans ce domaine n’est pas négligeable. Via des laboratoires de recherche, des chaires ou des structures d’accompagnement aux entreprises innovantes, les universités et Grandes Ecoles travaillent aussi avec des acteurs privés.
Le financement de chaire par des entreprises, qui se développe depuis 15 ans en France n’est pas encore au niveau de nos voisins. Dans le domaine de la santé, l’appel à la générosité fonctionne plutôt bien (Institut Pasteur, Institut Curie) mais ne doit pas être découragé par des rabots fiscaux. Souvent mal perçues en France, les écoles de management constituent, on l’oublie souvent, le domaine de l’enseignement supérieur où la France excelle le plus (10 Grandes Ecoles françaises dans le top 40 mondial du Financial Times). Comble, ce Top 10 est essentiellement financé par les Etudiants et leur famille… la hausse significative des frais de scolarité de ces écoles est montrée du doigt mais derrière cette hausse se cache, notamment, l’enjeu du financement de la Recherche. Encourager les banques à mieux financer ces étudiants, renforcer les bourses publiques ou meilleures orientations des fonds d’études européennes sont des pistes à suivre.
Du côté des entreprises, le rôle du Crédit Impôt Recherche (CIR) et du Crédit Impôt Innovation (CII) demeure depuis plus de 15 ans une force française. Il serait de courte-vue de classer les CIR / CII dans le champ des simples niches fiscales. Il est naturel que les résultats de la recherche et du développement ne soient pas garantis : par définition, l’innovation implique une part de risque et d’incertitude. C’est précisément ce qui rend ces dispositifs si essentiels. Trop souvent réduits à de simples niches fiscales dans le débat public, ils soutiennent pourtant un tissu d’entreprises bien plus large que les grands groupes médiatisés. Ce sont les PME, les ETI et même les TPE qui doivent en bénéficier majoritairement. Il serait donc judicieux de renforcer ces mécanismes, en particulier pour les entreprises de moins de 5.000 salariés. Le CIR représente aujourd’hui 0,3 % du PIB, soit une contribution significative mais encore insuffisante au regard des 0,8 % manquants pour atteindre l’objectif national de 3 % du PIB consacré à la R&D. Ce n’est pas un simple enjeu fiscal : c’est le financement de la croissance des décennies à venir.
Enfin, l’épargne privée des Français, qui représente deux fois la dette nationale, pourrait être mieux orientée vers le financement de l’innovation. Des incitations fiscales ciblées permettraient de transformer cette richesse en moteur de croissance future.
La France a les talents, les infrastructures et les ambitions. Il lui manque aujourd’hui une vision budgétaire cohérente et volontariste pour faire de la recherche et de l’innovation les piliers de sa compétitivité et de sa souveraineté.
À lire également : Prime Macron, impôt sur le revenu et heures sup’ : les premières pistes du Budget 2026

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits