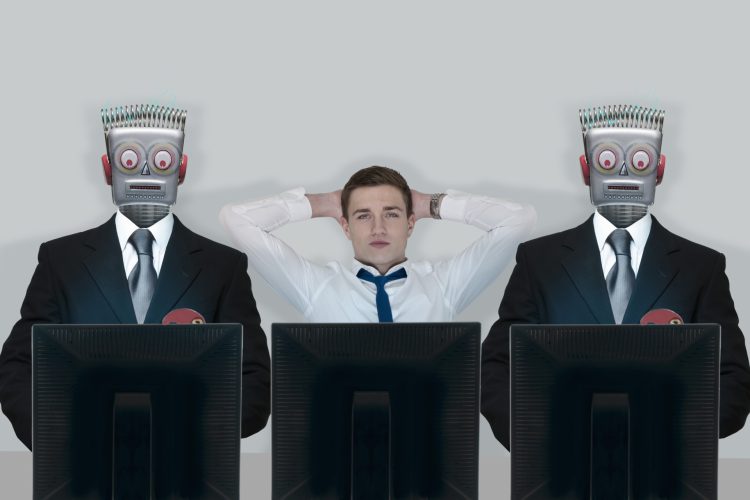La simplification est partout. Elle s’affiche dans les discours d’entreprise, figure dans les feuilles de route des comités exécutifs, alimente les plans de transformation dans le secteur public comme dans le privé. Mais sur le terrain, la réalité est moins enthousiasmante. En effet, dans la plupart des cas, les projets échouent, patinent, ou produisent… de nouvelles complexités.
Une contribution de Marc Sabatier, CEO de Julhiet Sterwen
Le règne de l’implicite
Simplifier est un acte profondément complexe. Ce n’est pas une question de processus, de gouvernance, d’organigrammes ou d’outils. C’est une transformation en profondeur des modes de fonctionnement. Or ceux-ci sont souvent invisibles, implicites, culturellement enracinés. Et dans bien des cas, ils préservent avant tout le statu quo, dans l’idée d’éviter les conflits, de diluer les responsabilités, de ne pas prendre de décisions susceptibles de déstabiliser l’ordre établi.
Les démarches affichées comme des initiatives de simplification sont souvent des projets de réduction de coûts. On fusionne, on supprime des échelons hiérarchiques, on automatise… Sans effet tangible de simplification. Pire : la confusion s’installe, les décisions se ralentissent et se concentrent. Pourquoi ? Parce que ces projets s’attaquent aux « objets » de l’organisation (structures, outils, reporting…) sans toucher aux liens invisibles qui les relient : les pratiques quotidiennes, les arbitrages officieux, les circuits d’information occultes. Ils évitent les « chez nous ça se passe comme ça » que personne ne s’autorise à affronter.
Une inertie enracinée dans l’histoire
La complexité ne s’installe pas du jour au lendemain. Elle sédimente au fil du temps : une réorganisation mal digérée, une crise gérée sans remise en question, des ajustements successifs face aux urgences. Le tout donne naissance à un système complexe et illisible, qui s’ancre jusqu’à devenir une norme.
Souvent, la complexité apporte une forme de confort : elle permet d’éviter les responsabilités claires ou encore de contourner les tensions internes. Dès lors, toute tentative de simplification est perçue comme une menace. Elle bouscule les équilibres implicites, force à désigner les dysfonctionnements, remet en question les postures managériales. Dans la plupart des grandes organisations, plusieurs biais structurels alimentent cette complexité.
En premier lieu, les organisations ont tendance à se standardiser. Si chaque entreprise se dit, à juste titre, « unique », la majorité d’entre elles adopte les mêmes modèles, souvent importés sans adaptation, en ignorant les réalités culturelles et historiques propres à chaque structure. L’échec est donc inéluctable.
Ensuite, les transformations sont souvent pensées en silos. Les projets s’empilent, sur les processus, la culture, le management, sans être pensés comme un tout cohérent. Résultat : des actions déconnectées, peu lisibles, qui laissent une impression d’agitation stérile.
Enfin, les organisations font face à la dilution des responsabilités. Les managers sont censés décider, mais les arbitrages sont souvent réalisés ailleurs, dans des comités plus ou moins formels, ou à des niveaux inappropriés.
Une transformation systémique et incarnée
La simplification ne se contente pas d’ajustements. Elle remet en cause des habitudes, des situations installées. Elle nécessite une transformation systémique touchant aux structures, processus, pratiques de travail, et surtout aux comportements collectifs. L’impulsion doit venir du haut : tant que les dirigeants ne s’engagent pas eux-mêmes dans le changement de leurs pratiques, avec le courage managérial que cela implique, aucune simplification ne sera crédible ni possible.
Au-delà d’être un levier d’efficacité redoutable, la simplification est aussi un vecteur de qualité de vie au travail. Dans la plupart des enquêtes internes, elle apparaît comme l’attente numéro un des collaborateurs : moins de frictions, plus de clarté, plus d’autonomie. En réduisant la charge mentale, en clarifiant les priorités, en fluidifiant les décisions, elle agit directement sur l’engagement.
La simplification ne doit plus être vue comme une option ni un effet de mode. Elle devient indispensable dans un monde lui-même toujours plus complexe. Elle permet chaque jour de s’infliger un peu moins à soi-même l’entretien bienveillant d’une complexité interne et ses effets délétères sur l’engagement des collaborateurs.
À lire également : De la disruption à la connexion : repenser le lieu de travail en plaçant l’humain au cœur

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits