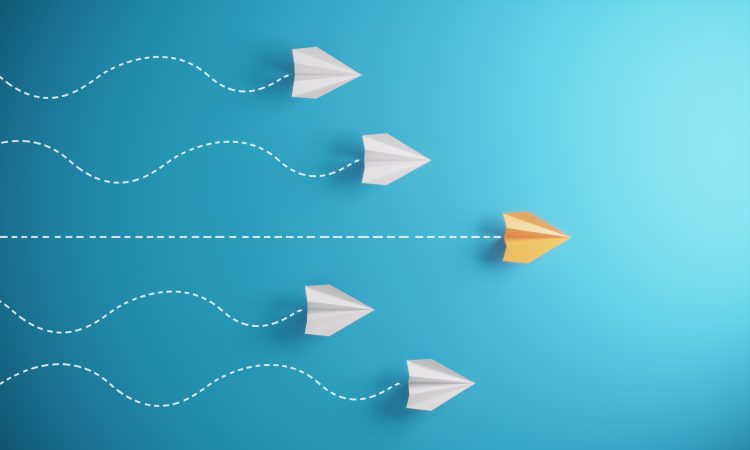Les dirigeants n’ont jamais pris autant de décisions, et pourtant, nombreux sont ceux qui doutent de leur propre jugement. D’après une étude de McKinsey, les cadres passent aujourd’hui près de 40 % de leur temps à décider, pourtant, la plupart estiment que ce temps est mal utilisé. Le problème ne vient ni du rythme ni du volume des décisions à prendre, mais d’un manque de clarté.
Dans bien des organisations, la performance est valorisée au détriment du discernement : un déséquilibre qui nuit à la qualité des décisions prises au sommet.
Nous évoluons dans des cultures où l’apparence prend souvent le pas sur la profondeur, où l’assurance est valorisée, même quand elle remplace la réflexion. Pourtant, le véritable jugement ne naît ni dans les réunions expéditives ni dans les formules percutantes. Il se forge avec le temps, sous la pression, à travers les conséquences, et grâce à la rigueur qu’on met à interroger ce qui a motivé une décision.
Trop souvent, nous confondons autorité avec détermination, et confiance avec clarté. Mais le discernement, lui, est d’un tout autre ordre. C’est une compétence rare : celle de percevoir les signaux faibles, de remettre en cause les évidences et de décider en pleine conscience, non par réflexe, ni par habitude. Ce n’est ni de l’intuition pure, ni de l’analyse froide. C’est une discipline de leadership : celle qui permet de garder une vision lucide quand le temps manque, que la pression monte et que l’erreur coûte cher.
La plupart des dirigeants n’ont jamais appris à développer leur jugement. Beaucoup n’ont tout simplement pas eu le temps, l’espace, ni même le cadre nécessaire pour l’exercer réellement.
Comment se construit le jugement ?
Cette question m’est apparue avec plus de clarté lors d’un échange avec Gary Klein, l’un des pionniers mondiaux de la recherche sur la prise de décision.
Gary Klein s’est penché sur des environnements parmi les plus extrêmes : incendies, zones de guerre, unités de soins intensifs, opérations de renseignement. Il a conseillé la Maison Blanche sur la conception de sa salle de crise, collaboré avec l’armée américaine et publié plusieurs ouvrages majeurs, dont Sources of Power et Seeing What Others Don’t. Ses travaux ont donné naissance à ce qu’on appelle aujourd’hui la prise de décision naturaliste : une approche centrée non sur les modèles abstraits, mais sur la façon dont les professionnels prennent réellement des décisions sous pression, dans le feu de l’action.
Il a également développé le modèle RPD (Recognition-Primed Decision), qui montre que les décideurs expérimentés ne passent pas forcément par une analyse méthodique de toutes les options. À la place, ils reconnaissent des schémas familiers, projettent mentalement les conséquences probables d’une action… et décident. Ce processus peut donner l’impression d’une simple intuition, mais il repose en réalité sur l’expérience accumulée, pas sur des suppositions.
Dans Sources of Power, il résume cette dynamique en une phrase percutante : « Les experts ne calculent pas. Ils imaginent. » C’est cette simulation mentale, née de l’exposition répétée à des situations complexes et d’une réflexion consciente, qui distingue les décisions rapides des décisions éclairées.
Le psychologue allemand Gerd Gigerenzer qualifie ce phénomène de rationalité écologique : une forme d’intuition qui fonctionne précisément parce qu’elle a été formée dans la réalité du terrain. Ce n’est pas un instinct aveugle, mais une reconnaissance affinée au fil du temps. Comme Klein, Gigerenzer insiste sur le fait que le jugement se construit. Et le discernement, au fond, c’est cette capacité à savoir quand faire confiance à son instinct… et quand le remettre en question.
Le mythe de l’expérience
L’une des critiques les plus constantes formulées par Gary Klein, c’est que l’expérience ne garantit pas l’expertise. Avoir occupé un poste à responsabilité, même pendant des années, ne signifie pas nécessairement avoir développé un véritable discernement.
Les données de Gallup sur le leadership vont dans le même sens : les dirigeants les plus efficaces ne sont pas toujours ceux qui affichent les CV les plus impressionnants. Ce sont souvent ceux qui ont su traverser des échecs, apprendre de leurs erreurs, s’adapter, et surtout prendre le temps d’analyser ce qui avait réellement changé dans leur manière de faire.
Mais dans de nombreuses cultures managériales, la réflexion reste marginale. On enchaîne les décisions, on passe à la tâche suivante, sans jamais prendre de recul sur ce qui a marché, ou pas. Sans ce temps d’arrêt, les schémas se figent, et les angles morts persistent.
Les cadres peuvent avoir l’impression d’avancer, mais sans retour critique sur les résultats, leur jugement stagne. Répéter sans réfléchir n’est pas de l’expérience, c’est juste de la répétition.
Au début de ses recherches dans les services d’incendie, Klein a voulu interroger les commandants « les plus expérimentés ». On lui a répondu par une question simple mais révélatrice : « Vous voulez ceux qui ont le plus d’années derrière eux… ou ceux qui sont les plus compétents ? »
Certains, lui a-t-on expliqué, avaient dix ans d’ancienneté, mais en réalité vécu la même année dix fois. Ils n’avaient pas vraiment appris, ils avaient juste enduré.
Dans mon travail de coach auprès de cadres dirigeants, j’ai souvent observé le même phénomène : répéter ce qui a déjà fonctionné peut donner l’illusion de l’expertise. Mais dans un monde en constante mutation, ce qui a marché hier ne garantit rien pour demain.
Les règles changent, les repères se déplacent, et c’est précisément dans ces moments d’incertitude que le discernement devient essentiel. Ce n’est pas ce que nous savons qui compte, mais notre capacité à percevoir ce qui a changé.
Simulations, doutes et véritable apprentissage
De nombreuses entreprises misent sur les simulations pour former leurs leaders, dans l’espoir de recréer les conditions de pression du réel. Mais Gary Klein, lui, reste sceptique : « Elles ne désorientent pas », m’a-t-il confié. « Elles ne provoquent pas de réflexion. Souvent, elles se contentent de vérifier si quelqu’un suit bien les instructions. »
Les simulations réellement utiles ne sont pas les plus lisses ni les plus confortables. Elles bousculent. Elles mettent à l’épreuve les certitudes, déclenchent le doute, révèlent les angles morts. Ce sont celles qui déstabilisent les leaders de façon constructive.
Klein insiste depuis longtemps sur un point : « L’une des qualités les plus importantes d’un décideur est sa capacité à remettre en question ses propres hypothèses. » Or, les environnements qui encouragent ce type d’introspection sont rares, mais ce sont eux qui font la différence entre formation… et transformation.
Les bonnes simulations soulèvent des questions essentielles, celles qui font naître le discernement :
- Et si j’avais tort ?
- Qu’avons-nous manqué ?
- Quelles certitudes reposent sur des suppositions non vérifiées ?
- Qui n’a pas encore été écouté ?
Gary Klein insiste sur un point crucial : l’évolution vient souvent du fait de prendre une décision avant de se sentir complètement prêt, tout en restant attentif à ce que cette décision révèle. L’objectif n’est pas simplement de boucler un exercice, mais d’apprendre dans la zone d’inconfort, là où la vraie transformation s’opère.
Il est également à l’origine de la méthode « pre-mortem » : avant de lancer un projet important, imaginez qu’il a échoué. Ensuite, demandez-vous pourquoi. Mieux encore, Klein recommande un double pre-mortem — en plus de simuler l’échec du plan, envisagez aussi ce qui pourrait se passer si ce plan n’était pas mis en œuvre. Il ne s’agit pas de nourrir la peur, mais d’identifier les fragilités avant qu’elles ne deviennent des réalités.
Pourtant, toutes les équipes ne sont pas prêtes à accueillir cette approche. Klein m’a raconté l’exemple d’une unité militaire qui rejetait le pre-mortem, craignant que cela ne démoralise les troupes. Cette résistance est significative : dans de nombreux milieux de leadership, le doute reste trop souvent perçu comme une faiblesse.
En réalité, le doute est un puissant signal de prise de conscience. Il met en lumière ce qui pourrait être ignoré ou passé sous silence. Toutes les décisions ne méritent pas forcément d’être remises en question, mais un nombre bien plus important devrait être soumis à un examen approfondi, notamment en s’interrogeant sur ce qui n’a pas été dit ou perçu.
Certaines des pires erreurs de l’histoire reposent justement sur des certitudes inébranlables qui n’ont jamais été contestées. Pensez à la tragédie de la navette spatiale Challenger ou à l’explosion de Deepwater Horizon. Ces catastrophes n’ont pas résulté d’un manque de confiance, mais d’un refus collectif de s’arrêter pour questionner ces certitudes.
À l’inverse, il existe des moments où le discernement s’impose avec une urgence extrême. Gary Klein cite en exemple l’un des plus frappants : le « Miracle de l’Hudson » en 2009, quand le capitaine Chesley « Sully » Sullenberger a réussi à poser son Airbus A320 sur l’eau, sauvant tous ses passagers après une collision brutale avec des oiseaux qui a détruit ses deux moteurs peu après le décollage.
Pas de manuel, pas de checklist. Juste quelques secondes pour décider, et toute une vie d’expérience concentrée en un choix impossible. Pour Gary Klein, ce moment n’a rien d’une simple chance : c’est la démonstration d’un discernement aiguisé sous pression. Un type de jugement qui ne s’apprend pas en suivant des procédures, mais en sachant voir l’essentiel quand tout s’effondre autour de soi.
Ce que l’IA ne peut pas remplacer
Quand nous avons abordé le sujet de l’intelligence artificielle, Klein a livré une réponse sans détour : « Ces systèmes ne comprennent pas. Ils sont programmés pour réagir. Ce n’est pas la même chose que penser. »
L’IA peut traiter le langage, imiter la fluidité d’une conversation… mais elle ne ressent ni le danger, ni l’absence, ni l’hésitation, ni les conséquences d’une décision. « Pour porter un jugement, il faut être directement impliqué », insiste-t-il. « Pas simplement de manière informatique, mais de façon humaine, avec tout ce que cela implique. »
L’IA peut accompagner et enrichir la prise de décision, mais elle ne peut pas forger le jugement, qui reste la prérogative de celui qui choisit et qui doit vivre avec les retombées de ses choix.
La pratique du discernement
Les meilleurs dirigeants avec lesquels j’ai travaillé ont souvent un point commun : ils commencent par écouter leurs sensations. Ils ralentissent, prêtent attention à ce qui les met mal à l’aise, et captent ce qui reste non-dit. Ils scrutent les tensions entre ce qui paraît juste et ce qui suscite un doute. C’est là que naît le discernement. Il ne repose pas uniquement sur les données, mais aussi sur les manques que l’on choisit d’explorer.
La plupart des formations au leadership insistent sur la planification stratégique, la gestion des parties prenantes ou la communication maîtrisée. Ces compétences sont nécessaires, mais le discernement pousse ailleurs, sur un terrain plus subtil.
Il se nourrit de questions plus calmes, moins scénarisées, comme :
- À quelle pression suis-je réellement en train de répondre ?
- Est-ce que je cherche à paraître clair, ou est-ce que je vois vraiment clair ?
- Quelles certitudes ai-je choisi de ne pas remettre en question ?
- Quelle part de cette décision vais-je revoir, et à quel moment ?
- Est-ce que je prends cette décision parce qu’elle est juste, ou parce qu’elle est facile ?
Ces interrogations ne sont pas de simples réflexions : elles traduisent un jugement qui se construit ou s’affine.
L’étude de Gallup met en lumière les expériences-clés qui accélèrent la maturité des leaders. Mais toutes les expériences ne se valent pas. Les moments où le jugement est véritablement mis à l’épreuve partagent généralement plusieurs caractéristiques clés :
- Assumer la responsabilité d’un échec
- Naviguer dans des contextes de tension éthique ou d’ambiguïté culturelle
- Prendre des décisions sans réponse évidente
- Choisir en sachant que ces décisions affecteront des vies, bien au-delà des chiffres
Ces expériences ne se déroulent pas dans un cadre ordonné ou clair. Elles sont souvent chaotiques. Pourtant, elles transforment la manière dont les dirigeants portent leur attention, redéfinissent la confiance, et laissent derrière elles une forme de clarté discrète mais durable.
Le jugement ne se mesure pas sur un tableau de bord, ni dans les rapports de performance. Pourtant, c’est lui qui forge la solidité des décisions quand la pression monte. Dans un monde où les dirigeants évoluent sous des délais toujours plus courts, sous le regard de tous, avec des enjeux majeurs, il reste peu de place pour l’erreur et encore moins pour se cacher derrière de simples résultats.
Gary Klein rappelle : les bonnes décisions ne viennent pas de l’accumulation d’informations, mais d’une vision plus claire. Cette vision exige présence, attention et réflexion. « On ne peut pas apprendre à prendre les bonnes décisions, mais on peut aider les gens à mieux voir », m’a-t-il confié. C’est là que le discernement prend racine.
Le discernement n’est pas une compétence supplémentaire. Il est à la base de toutes les autres. Et il ne s’acquiert pas par la simple répétition ou la rhétorique, mais dans la pression, la résilience, et ces moments où l’on continue à chercher, longtemps après que d’autres ont abandonné.
Une contribution de Vibhas Ratanjee pour Forbes US – traduit par Lisa Deleforterie
À lire également : Managers : et si l’IA devenait votre meilleure alliée ?

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits