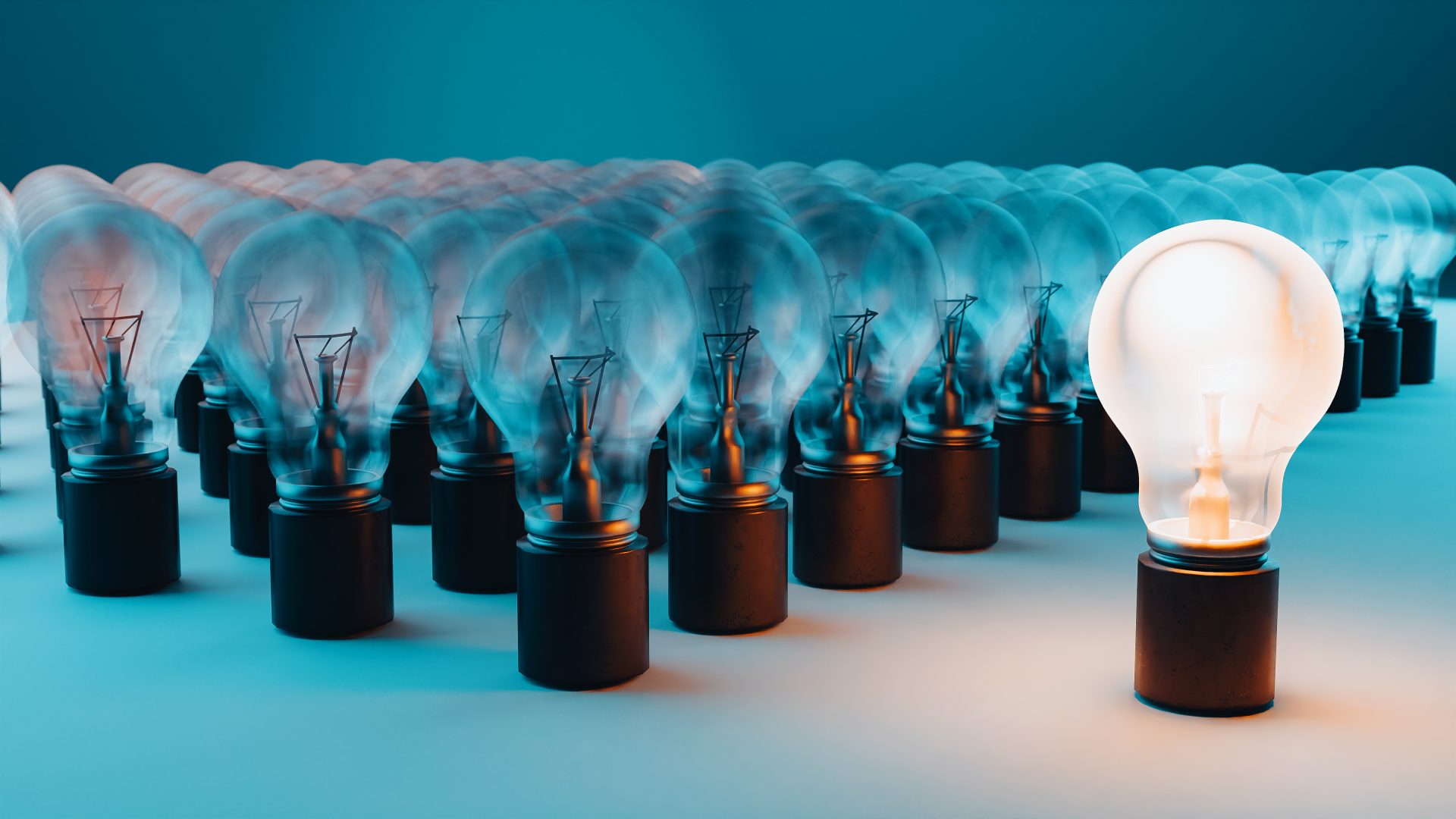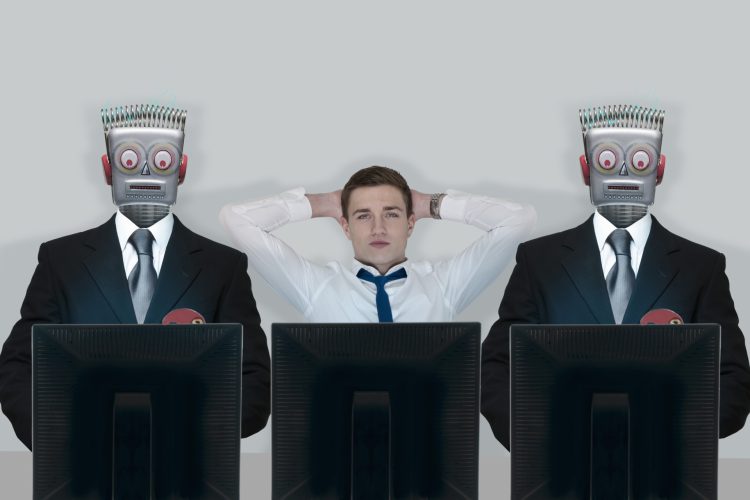Dans un monde où le leadership s’exprime souvent par la parole, la visibilité et la rapidité de décision, le Japon offre un modèle différent fondé sur l’écoute, une hiérarchie à la fois bien ancrée et discrète, la puissance du silence et l’influence implicite.
Une contribution de Zdravka Bondidier, experte automobile et mobilité durable.
« Tu vas devoir apprendre à ne pas dire non à ton client. »
La remarque, mi-blagueuse, mi-sérieuse, m’avait été lancée par un de mes interlocuteurs de PSA (aujourd’hui Stellantis) lorsque je lui ai annoncé que je partais pour le Japon. Mon nouveau client s’appelait Toyota, et derrière cette phrase un peu piquante se cachait une réalité que je n’allais pas tarder à expérimenter : un monde où l’équilibre se joue dans le non-dit, les gestes codés, et le respect ritualisé.
La force de la concision
Je me souviens encore de ma première réunion avec la direction d’ingénierie de Toyota : le hall d’entrée, orné d’un paravent japonais impressionnant, donnait le ton avant même d’entrer dans la salle. Pas de photo de ce cadre solennel : tous les téléphones avec appareil photo restaient à l’accueil des locaux de Toyota. L’heure des introductions aux différents membres de Toyota : j’attendais mon tour, après mes supérieurs (hiérarchie oblige). Échange des cartes de visite, les salutations par inclinaisons respectueuse et formules de politesse bien rodées marquaient le début d’une performance minutieusement orchestrée. J’avais reçu à l’avance un plan de table, comme pour un mariage, qui facilitait grandement l’identification des participants par leur rang. Pourtant, après avoir récolté une dizaine de cartes de visite, je me demandais encore qui, parmi tous ces managers vêtus de la veste gris clair si emblématique de Toyota, était le véritable décideur. A ce moment-là, une dernière personne est entrée, rapide échange des cartes de visite et toute le monde s’est assis avec une rapidité étonnante.
Le tour de table commence : honneur aux invités, les présentations se font à tour de rôle. Nous, les Européens, avons tendance à faire de longues introductions, à expliquer (presque) toute notre carrière en cherchant à tisser des liens avec nos interlocuteurs ou plutôt de les impressionner avec nos titres et succès.
Mais la présentation du « big boss » japonais était frappante : moins d’une minute. Je me rappelle encore ses mots simples après les formules de politesse : « Je travaille chez Toyota depuis 33 ans et j’ai contribué à de nombreux projets ». Silence.
Cette brièveté apparente en disait long. C’est loin d’être un simple exercice de style ou un manque d’intérêt. Elle traduit une posture profondément ancrée dans la culture japonaise du leadership : celle d’une légitimité qui ne nécessite pas d’être justifiée à chaque fois par des grandes paroles ou une démonstration explicite de compétences ou de qualités. Sa présence, son histoire, et le respect qu’il a acquis dans le temps suffisent à ressentir son autorité naturelle. Cette approche contraste avec de nombreux modèles occidentaux, où le leadership est souvent associé à la capacité de se rendre visible et à l’affirmation de soi (parfois au détriment des autres). En France ou en Allemagne, affirmer devant tout le monde son point de vue, défendre son périmètre ou valoriser ses réussites fait partie intégrante du rôle managérial. Au Japon, le pouvoir s’exerce davantage par l’exemplarité, la constance, et la maîtrise des codes sociaux, plutôt que par la confrontation ou l’éloquence.
Cette manière de faire peut nous sembler distante, impersonnelle, voire déstabilisante. Ayant auparavant collaboré étroitement avec des collègues indiens, j’étais habituée à une toute autre approche. En Inde, établir une relation de travail passe presque toujours par une connexion personnelle : au début des réunions, on s’enquiert spontanément de la famille, de ce qu’on a fait pendant le weekend, on partage facilement des anecdotes. Les échanges informels sont valorisés, car ils permettent de tisser de la confiance. La frontière entre vie personnelle et professionnelle est plus poreuse, et l’empathie passe souvent par ces moments d’ouverture.
Au Japon, à l’inverse, cette proximité n’est ni attendue ni recherchée dans le cadre professionnel. Poser une question sur la vie privée d’un collègue peut sembler intrusif, voire déplacé. Le respect se traduit par la retenue, l’économie de parole, la discrétion. On collabore sans nécessairement connaître les détails de la vie de l’autre, et cela n’enlève rien aux bonnes relations professionnelles. Cette posture plus sobre, plus codifiée, demande un temps d’adaptation pour beaucoup de managers occidentaux, habitués à créer du lien par le dialogue personnel.
Mais elle suggère que la qualité d’une relation de travail peut s’exprimer autrement qu’à travers la proximité prétendue ou réelle : moins démonstrative, certes, mais fondée sur la fiabilité, la constance et un respect profond de l’espace de l’autre.
Un leadership en observation mais pas sans contrôle
En dehors des salles de réunion, le leadership des managers japonais se manifeste au quotidien de manière aussi silencieuse qu’omniprésente. Mon chef de département japonais, depuis mon arrivée, ne m’avait quasiment pas parlé en dehors des salutations quotidiennes. Au bout d’un mois, je m’étais convaincue qu’il n’avait aucune idée de ce que je faisais, ni de comment j’avançais sur mes sujets. Jusqu’au jour où mon ancien chef français est venu au Japon pour un voyage d’affaires. Il a naturellement commencé par saluer son homologue japonais et lui a demandé comment avançait mon projet. Mon bureau étant à côté, j’ai entendu la réponse qui, à ma stupéfaction, était un compte-rendu précis sur mes activités incluant également le feedback de mon client.
C’est à ce moment-là que j’ai compris une dimension essentielle du leadership à la japonaise : l’observation discrète, la confiance, et une non-intervention assumée dans l’opérationnel au quotidien. Avant de partir pour le Japon, je redoutais un certain micro-management. Paradoxalement, c’est au Japon que j’ai ressenti une autonomie (presque) totale mais sous un regard constant, attentif et silencieux. On laisse les experts faire ce qu’ils savent faire le mieux. Cette approche peut désarçonner au début, surtout lorsqu’on vient de cultures managériales plus directives comme en France, où l’attente implicite est souvent de « rendre des comptes » régulièrement ou de solliciter des validations successives. Au Japon, la légitimité repose sur la compétence reconnue dès le départ : si vous êtes là, c’est que vous êtes capable. Il n’y a pas d’injonction à faire ses preuves par la visibilité ou par la démonstration constante. Ce modèle valorise la rigueur, la constance et l’autonomie, tout en imposant, en filigrane, un niveau d’exigence très élevé : celui d’être à la hauteur en toute circonstance.
Travailler dans ce cadre, c’est apprendre à gérer son travail avec discipline et précision, sans attendre un retour explicite immédiat. C’est aussi une marque de respect : on ne vous interrompt pas, on n’est pas régulièrement sur votre dos mais on observe de loin. Et si les résultats sont là, la reconnaissance, elle aussi, sera silencieuse, subtile mais bien réelle.
Laissez faire … mais pas quand les choses vont mal.
A la moindre difficulté, par défaut c’est mon manager japonais qui assumera toutes les responsabilités pour l’équipe, indépendamment de qui ou quoi était à l’origine du problème. Cela reflète une logique du collectif : ce n’est pas l’individu qu’on expose mais on responsabilise tout le monde aux effets des erreurs. Dans ce système, le manager prend sur lui les conséquences des erreurs et absorbe les tensions, assumant pleinement son rôle de bouclier. Il est garant des résultats et sa discrétion du quotidien contraste avec la solidité avec laquelle il encaisse en cas de crise. Pendant une crise au travail, le focus est exclusivement centré sur comment résoudre au plus vite la situation dans un environnement constructif. Il n’y a pas des petites phrases piquantes pour mettre mal à l’aise consciemment ou inconsciemment celui que l’on pense fautif.
J’ai vu à l’œuvre des managers japonais qui assumaient pleinement leurs responsabilités, sans jamais se défausser sur leurs équipes lorsque les difficultés surgissaient. Lorsqu’un effort supplémentaire était demandé aux équipes le manager était là aussi. Que ce soit par des horaires étendus, par le travail le weekend ou par l’annulation des vacances de la Golden week, le manager partage les contraintes imposées à son équipe. Et ce n’était pas pour faire de la figuration. Bien au contraire : ils retroussaient leurs manches, étaient présents sur le terrain, et s’impliquaient activement dans la résolution des problèmes. En tant que fournisseur, j’ai moi-même été confrontée à la rigueur des managers de Toyota, capables de poser des questions d’une précision redoutable. Ils connaissaient les détails, comprenaient les enjeux techniques, savaient vite identifier les failles et implémenter des actions correctives.
On pense souvent qu’au Japon, la responsabilité est diluée, qu’on ne désigne jamais de fautif. Ce biais vient du fait que dans notre culture occidentale, on associe « la faute à personne » avec « aucune conséquence pour personne ». C’est loin d’être vrai au Japon. Une fois la tempête finie, des analyses approfondies seront effectués et des actions correctives seront lise en place. Les processus et outils seront adaptés. Des formations aux employés seront dispensées. Certaines personnes seront également rétrogradées de leurs positions. Ceci se fera avec beaucoup de discrétion en présentent ce changement comme « une meilleure façon » d’être au service de l’entreprise. Et il y aura, bien entendu, des excuses officielles souvent perçues comme une humiliation chez nous.
S’excuser n’est pas une faiblesse du leadership mais marque du respect
Beaucoup de contenus de développement personnel nous apprennent des dizaines de façons d’éviter de s’excuser, au motif que cela affaiblirait ou nuirait à notre assertivité en contexte professionnel. Dire « pardon » ou « excusez-moi » est presque devenu une faute stratégique que notre interlocuteur pourrait exploiter à notre détriment.
Cette approche m’a toujours laissé une impression de déséquilibre. Elle me frappe particulièrement ayant vécu au Japon où, à l’inverse, éviter de s’excuser peut être perçu comme une impolitesse, voire un manque de respect.
Loin de signifier un aveu de faiblesse, l’excuse au Japon est une forme codifiée de reconnaissance de l’autre. Elle signifie : j’ai conscience que quelque chose a pu vous causer un désagrément, et je prends la responsabilité relationnelle de le reconnaître. Cette posture ne nie pas les faits, ne cherche pas forcément à trancher qui a « raison », mais elle vise à protéger la relation, ce qui reste au cœur de la culture managériale japonaise. S’excuser même pour des choses aussi mineures que poser une question à un(e) collègue pendant qu’il/elle travaille n’est jamais perçu comme une faiblesse, mais comme un signe de maturité et de respect profond pour l’autre.
Et si, au lieu de redouter de paraître “faible”, on voyait dans l’excuse bien placée une forme de leadership naturel, celui qui n’a rien à prouver mais beaucoup à préserver ?
Un leadership qui ne s’affiche pas, mais qui s’incarne
Il est impossible de saisir toute la complexité du management à la japonaise en un seul article. Vivre et travailler au Japon n’a pas seulement remis en question mes repères culturels : elle a profondément élargi ma compréhension du leadership. J’y ai découvert une manière d’exercer l’autorité sans éclat. Cette culture du « moins visible » n’est pas une absence. C ’est une présence feutrée, mais exigeante. Elle valorise l’humilité, la loyauté, le respect tout en restant intransigeante sur la qualité et la responsabilité.
Peut-être est-ce là une des grandes leçons de ce voyage : dans un monde où le bruit, la vitesse et la démonstration prennent souvent le dessus, il existe d’autres formes de puissance — plus sobres mais tout aussi efficaces. Et si le leadership se mesurait moins à ce que l’on dit qu’à ce que l’on incarne ?
Le management à la japonaise évoque souvent un univers rigide, ultra-hiérarchisé, où l’on exécute sans contester. Et c’est précisément cette image que mon expérience au Japon a peu à peu fissurée pour révéler la forêt derrière l’arbre. Car si la hiérarchie est bien présente – codifiée, respectée, souvent imposante – elle s’accompagne d’un souci constant de consensus, de l’intérêt collectif, et d’un art subtil de l’influence.
C’est au Japon que j’ai compris que le leadership ne parle pas fort : il s’exerce au-delà des mots.
À lire également : Leadership à l’américaine : plus motivant ou plus direct ?

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits