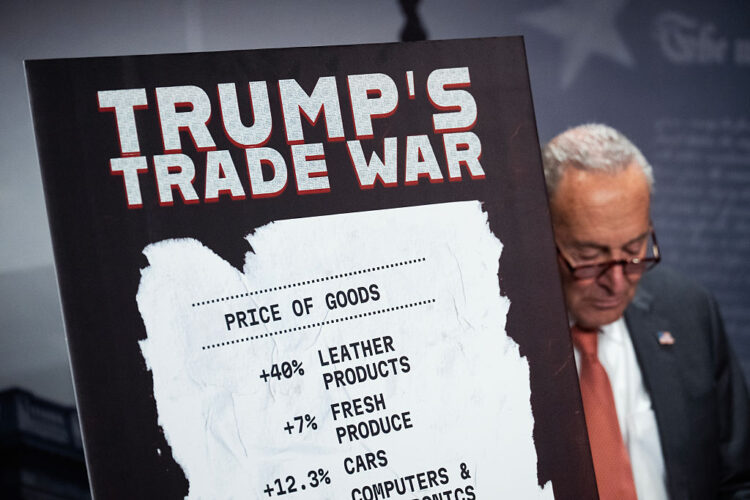Moins de cases à cocher, plus de clarté stratégique. C’est le message envoyé par l’EFRAG en publiant, le 31 juillet 2025, ses projets de révision des normes européennes de reporting de durabilité (ESRS). Derrière ce mouvement, il ne s’agit pas de desserrer l’étau réglementaire, mais de rendre le reporting extra-financier plus lisible, plus ciblé, et surtout plus utile aux décisions des entreprises comme des investisseurs. Dans un contexte où la directive CSRD fixe le “qui” et le “quand” de la publication, les ESRS en précisent le “quoi”. Et ce “quoi” est désormais en train d’être profondément remodelé pour concilier exigence et pragmatisme.
Une contribution de Matthew Fisher, Head of Policy chez Watershedc
Moins de volume, plus de valeur
La dynamique de simplification répond à un mandat formel de la Commission européenne, confié en mars 2025. L’objectif est de réduire le nombre de points de données obligatoires, préserver le noyau quantitatif du reporting et améliorer la clarté d’ensemble. Les chiffres sont parlants. Le nombre de points obligatoires recule de 57 %, et le total des points – obligatoires et volontaires – diminue de 68 %. L’effort se concentre sur le qualitatif, avec 77 % de la réduction portant sur des informations narratives ou semi-narratives. Pour autant, les éléments jugés utiles pour les investisseurs ne sont pas effacés ; ils sont rassemblés dans un Guide de mise en œuvre non obligatoire (NMIG) que les entreprises pourront consulter à leur gré. Le message est ainsi net, moins de dispersion, davantage de pertinence.
Ce recentrage s’accompagne d’une réécriture qui fluidifie l’ensemble. Les standards gagnent en lisibilité grâce à des définitions clarifiées, à la suppression des redondances et à un regroupement thématique plus intuitif. Les exemples sont mieux alignés sur les processus métier habituels. Surtout, la narration rapproche désormais explicitement durabilité et performance financière, afin que le rapport CSRD ne soit pas un silo, mais un prolongement naturel du pilotage stratégique et du reporting de gestion.
Pivot du dispositif, l’évaluation de double matérialité est, elle aussi, rendue plus praticable. Un nouveau chapitre d’ESRS 1 introduit des considérations « terrain » ; une approche top-down partant du modèle économique et du contexte sectoriel, l’appui sur les pratiques des pairs pour faire émerger les sujets probablement matériels, et une charge de preuve raisonnable et proportionnée lorsqu’un enjeu est manifestement matériel pour le secteur ou le business model. On quitte la logique d’exhaustivité procédurale pour renouer avec un exercice d’arbitrage stratégique.
Un cadre plus opérable et mieux articulé
La norme générale ESRS 2 reste obligatoire, mais elle est remaniée pour mieux s’articuler avec les normes thématiques, comme E1 sur le climat. Les zones de chevauchement sont réduites, la frontière entre stratégie, gestion des risques et thématiques spécifiques est clarifiée, et certaines informations, notamment les PAT, ne sont à publier que si l’entreprise en dispose réellement. Cette architecture évite la répétition d’une même information dans plusieurs sections et facilite la lecture comme la production.
Au-delà, des allègements horizontaux ciblent les zones d’implémentation les plus sensibles. Les attentes en matière d’informations prospectives sont précisées, des seuils de matérialité plus clairs encadrent certaines métriques, la hiérarchie des sources pour les données liées à la chaîne de valeur est supprimée, ouvrant la voie à des estimations lorsque c’est praticable et fiable. Sur le climat, la frontière de consolidation retenue pour E1 s’aligne sur les états financiers consolidés, avec une divulgation additionnelle suivant une approche de contrôle opérationnel lorsque l’approche par contrôle financier ne reflète pas fidèlement les émissions globales de l’entreprise. L’ensemble renforce la cohérence avec le GHG Protocol sans diluer l’exigence européenne.
L’effort éditorial est visible dans tout le corpus… formulations ambiguës corrigées, distinction nette entre contenu obligatoire et non obligatoire, définitions harmonisées et ajout d’un glossaire et d’une table des acronymes. Ce travail de fond allège la friction d’usage, surtout pour les groupes qui doivent orchestrer plusieurs filières de données hétérogènes. Enfin, un point demeure en suspens, celui du traitement des informations commercialement sensibles, appelé à être précisé ultérieurement à la lumière du processus « Omnibus », qui vise plus largement à ajuster la CSRD elle-même.
Interopérabilité internationale et trajectoire d’adoption
L’EFRAG avance sur la compatibilité avec les standards de l’ISSB (IFRS S1 et S2) partout où l’alignement est possible sans dénaturer les spécificités européennes. Le concept de « présentation fidèle » devient un principe directeur, et un inventaire des évolutions terminologiques figure en annexe. Pour la divulgation des effets financiers anticipés des risques et opportunités de durabilité, l’EFRAG consulte encore, deux options coexistant dans les projets en raison d’un manque de consensus au sein du Sustainability Reporting Board. Dans l’intervalle, des mesures de calendrier sont proposées : la première année de reporting, les entreprises peuvent omettre l’ensemble des points liés aux effets financiers anticipés sur les volets environnementaux et sociaux ; les deuxième et troisième années, elles publient des informations qualitatives, sans exigence chiffrée.
Cette convergence pragmatique n’efface pas les différences de fond. L’Europe conserve sa boussole de la double matérialité et une attention élargie aux parties prenantes. Mais l’interopérabilité progresse, ce qui réduit le risque de doubles processus et facilite, pour les groupes internationaux, la constitution d’un socle de reporting unifié.
Le calendrier se précise. La consultation publique court jusqu’au 30 septembre 2025. L’EFRAG finalisera ensuite les textes en octobre et novembre avant de transmettre son avis technique à la Commission le 30 novembre. L’adoption des ESRS révisés est attendue au premier semestre 2026 via un acte délégué. Cette trajectoire pourrait toutefois être modulée par les arbitrages de la révision plus large de la CSRD en cours dans le cadre « Omnibus », au besoin avec des ajustements complémentaires des ESRS. Autrement dit, la direction est fixée, mais une marge d’affinage subsiste.
En somme, la séquence engagée par l’EFRAG ne réduit pas l’ambition européenne, elle la rend plutôt praticable. Moins d’items, plus de clarté, une articulation renforcée avec la finance et une évaluation de double matérialité recentrée sur le modèle d’affaires. Tout concourt donc à transformer un exercice perçu comme lourd en outil de pilotage. Les entreprises auraient tort d’attendre le texte final pour se mettre en ordre de marche. Les demandes quantitatives, comme les émissions sur les trois scopes, l’énergie, l’eau, les ou effets financiers des risques climatiques, resteront le cœur dur du dispositif et sont les plus exigeantes à documenter et à faire auditer. La coopération entre RSE et finance devient, elle, non négociable pour relier la performance de durabilité aux trajectoires stratégiques. La clarté progresse, mais l’incertitude n’est pas un prétexte à l’immobilisme. Mieux vaut bâtir dès maintenant un système de reporting capable d’absorber les ajustements à venir que de subir, demain, une réforme dont le cap est déjà tracé.
À lire également : La Cour internationale de justice ouvre la voie à des poursuites climatiques contre les États-Unis

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits