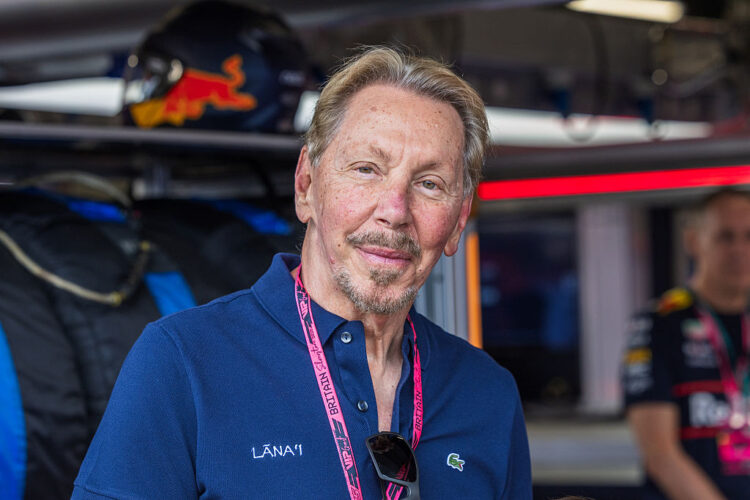Une tribune écrite par Gérald Lelong, Directeur général de Forx
L’Union européenne applique déjà des règles strictes en matière de conformité et de sécurité, en empêchant certains produits d’entrer sur son marché. Par exemple, des jouets, équipements électroniques ou textiles en provenance de Chine peuvent être interdits d’entrée ou rappelés après contrôle. Ces restrictions ne relèvent pas directement d’une logique économique. Elles sont avant tout justifiées par la sécurité, la santé publique ou la protection de l’environnement. Mais elles jouent un rôle de filtre de la concurrence. Une piste envisageable serait d’appliquer aux produits importés les mêmes normes que celles imposées aux producteurs européens, notamment sur les plans social et environnemental.
Il ne s’agit pas de se replier ni de dresser des barrières tarifaires, mais d’assumer un haut niveau d’exigence. Cette stratégie peut servir deux objectifs. D’une part, protéger un tissu industriel fragilisé, et de l’autre, donner le ton à l’échelle mondiale. L’Europe a peu de chances de remporter une guerre économique sur le terrain du moins-disant. Cela dit, elle peut être en tête d’un nouveau modèle industriel avec pour maître mot qualité, responsabilité et innovation.
Prioriser les filières critiques et penser relocalisation
Réindustrialiser l’Europe sans miser sur la robotisation serait une illusion. C’est elle qui rend possible le retour de certaines productions, non pas en jouant sur le coût du travail, mais en misant sur la flexibilité et la compétitivité des usines. Elle change aussi le quotidien des opérateurs : moins de gestes répétitifs, plus de valeur ajoutée et de sécurité. En France, investir dans cette transformation, c’est faire bien plus qu’acheter des machines : c’est poser les bases d’une souveraineté retrouvée et rendre nos sites à nouveau attractifs pour les capitaux et les talents.
Cela suppose aussi de cibler clairement les secteurs critiques. La microélectronique, par exemple, représente aujourd’hui une ressource stratégique difficilement substituable. Des acteurs comme STMicroelectronics sont inestimables. Perdre ces structures, ce serait perdre bien plus qu’un site de production : ce serait mettre en péril des pans entiers de souveraineté technologique. Il en va de même pour l’intelligence artificielle, domaine dans lequel l’Europe est aujourd’hui doublement dépendante : vis-à-vis des États-Unis pour les logiciels, et de la Chine pour certains composants comme les cartes et les serveurs. Pourtant, les capacités existent pour bâtir une véritable autonomie. A condition de structurer une volonté politique et industrielle forte…
La relocalisation peut s’inscrire dans cette stratégie si elle est perçue comme un levier économique et pas comme une charge ou une contrainte. Cela implique un environnement fiscal et administratif plus lisible, des incitations à l’investissement, et surtout une cohérence entre ce qui est exigé localement et ce qui est toléré à l’importation. Appliquer des standards élevés aux producteurs nationaux tout en accueillant des produits qui ne les respectent pas crée un déséquilibre structurel.
Cette vision ne peut être portée efficacement qu’à l’échelle européenne. Les chaînes de valeur ne s’arrêtent pas aux frontières. La compétitivité ne se décrète pas à l’échelle d’un seul pays. L’Europe peut devenir un bloc industriel crédible, mais uniquement si les efforts sont alignés, mutualisés et pensés collectivement.
Mobiliser les PME et analyser les résultats obtenus
Les territoires et les PME ont leur rôle à jouer dans cette dynamique. Le tissu productif français repose déjà largement sur un réseau de petites et moyennes entreprises, qui fournissent souvent l’essentiel de la valeur ajoutée, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle. Ces entreprises, parfois invisibles, sont déjà au cœur des chaînes industrielles. Les politiques de souveraineté doivent les reconnaître comme telles, et non comme de simples relais locaux.
Enfin, toute stratégie industrielle, pour être efficace, doit pouvoir être évaluée. Deux grandes formes de dépendance concentrent aujourd’hui les fragilités européennes : la dépendance logicielle, plus facile à mesurer, et la dépendance matérielle, plus diffuse, car liée à un tissu industriel long à transformer. La souveraineté passe aussi par la capacité à produire des biens, des technologies ou des ressources que d’autres ne peuvent pas ignorer ou remplacer facilement.
C’est à cette condition que l’Europe pourra retrouver une forme d’autonomie réelle, sans se couper du monde, et en restant fidèle à ce qu’elle sait faire de mieux : allier exigence, innovation et ambition collective.
À lire également : Faire face aux défis de l’accélération industrielle dans la défense : une équation stratégique pour la souveraineté française

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits