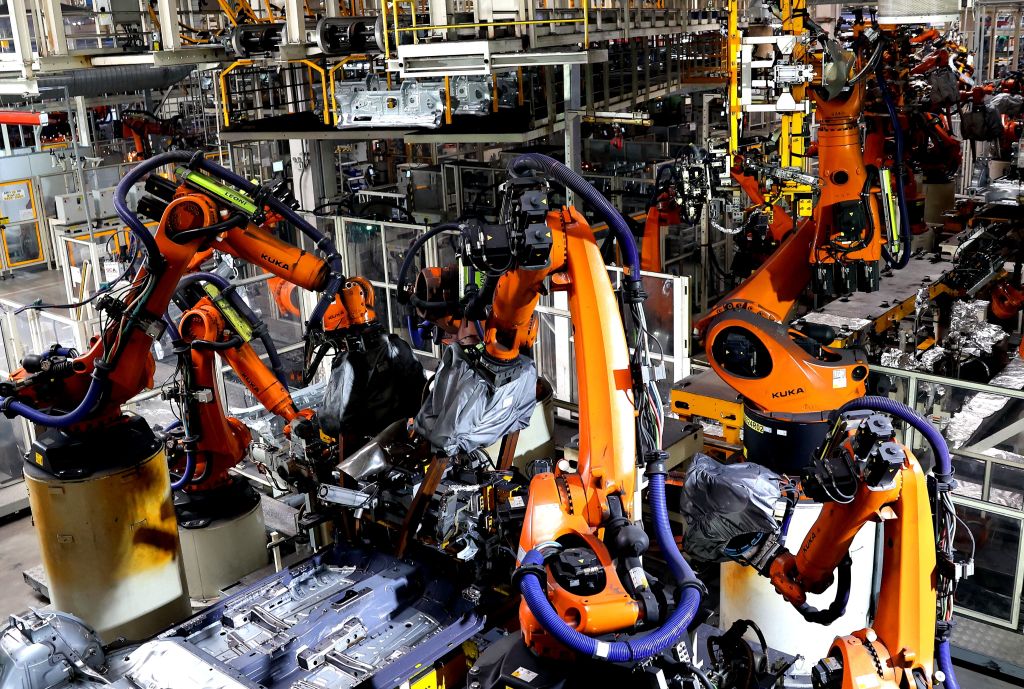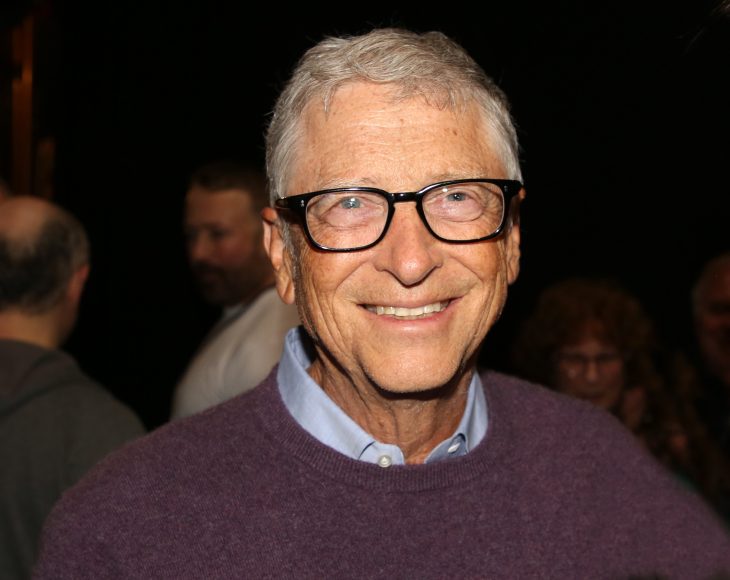Lisbonne, Barcelone, Florence… Ces villes, emblématiques du tourisme européen, ont commencé à dire stop. À Lisbonne, depuis avril 2025, toute nouvelle autorisation de location courte durée est suspendue dans 19 quartiers historiques, dès que le seuil de 5 % du parc résidentiel est atteint. L’objectif : enrayer la pression sur le logement. Mais la méthode soulève une question essentielle.
Une contribution par Théo Deniau, Founder & CEO – @Guestadom / Vice-président réseau SPLM (Syndicat des Professionnels de la Location Meublée)
Et si, plutôt que de cibler la location en elle-même, on s’attaquait enfin au vrai angle mort du débat : l’inoccupation massive des résidences secondaires ? En France, près de 3,7 millions de logements sont ainsi utilisés quelques semaines par an, parfois moins. Dans certains territoires, ils représentent plus d’un logement sur deux. Faut-il interdire leur usage temporaire… ou encourager leur mise en circulation raisonnée ?
Car le vrai déséquilibre est là : dans des logements existants condamnés à rester fermés. Et si la location courte durée, loin d’être un problème, était justement l’une des clefs pour éviter de construire toujours plus, en mobilisant ce qui dort déjà ?
Une caricature bien commode
On a longtemps opposé rentabilité et responsabilité comme s’il fallait choisir entre remplir son frigo ou éteindre les lumières : la rentabilité est brandie comme extraction, la responsabilité comme sacrifice. Ce dualisme simplifie à outrance un débat bien plus nuancé.
Aujourd’hui, la location courte durée est souvent accusée de tous les maux : désertification, gentrification, surtourisme, spéculation. Et si nous regardions ailleurs ? Si le vrai sujet était la façon de faire, et non le principe même ?
Selon l’INSEE, la France compte aujourd’hui entre 3,2 et 3,7 millions de résidences secondaires, ce qui représente près de 10 % du parc résidentiel national (source : INSEE, Fichier des logements, 2023). Ce taux est l’un des plus élevés d’Europe. Dans certaines zones côtières comme Quiberon, ce chiffre grimpe jusqu’à 66 %, ce qui transforme littéralement le paysage urbain pendant la basse saison. L’été, les volets s’ouvrent, les commerces tournent à plein régime ; l’hiver, tout semble figé, comme mis sous cloche. Et pourtant, à quelques kilomètres de là, on continue de construire. Un paradoxe architectural et écologique qui interroge sur l’usage réel du parc immobilier existant.
À l’échelle européenne, la tendance est similaire : les locations de courte durée proposées via les plateformes numériques ont généré près de 719 millions de nuitées en 2023 (source : Eurostat, 2024). La France, première destination touristique du continent, en concentre 159 millions à elle seule. Ce volume représente presque deux millions de nuitées par jour, signe d’un marché dynamique et profondément ancré dans les pratiques de voyage actuelles. Et la croissance continue : le dernier trimestre 2024 a enregistré une hausse de 17,4 % sur un an. Ces données illustrent que le phénomène n’est pas marginal ni passager ; il est devenu structurel dans l’économie du tourisme européen.
Louer un bien inoccupé ponctuellement n’est pas une déviance du numérique, comme la colère de certains locaux le prétend : c’est du bon sens. C’est valoriser des mètres carrés déjà construits, plutôt que d’en bâtir de nouveaux. C’est aussi une réponse pragmatique à la vacance immobilière, qui atteint parfois des niveaux plus élevés que le nombre de logements proposés en courte durée dans certaines communes. À l’heure des enjeux climatiques et de la sobriété foncière, mobiliser l’existant n’est pas seulement souhaitable : c’est indispensable. Et franchement, qui ne s’est jamais posé la question, en vacances, pourquoi il y a autant de volets fermés dans le coin ?
Et au-delà des chiffres, il y a du sens : pourquoi interdire à un particulier de louer son bien quelques semaines dans l’année, tout en l’autorisant à laisser ce même logement vide 12 mois sur 12 ? C’est un peu comme interdire la location de voitures entre particuliers sous prétexte de nuisances, tout en autorisant quelqu’un à posséder autant de véhicules qu’il veut, inutilisés, dans son garage. Ce paradoxe illustre l’absurdité de certaines décisions politiques qui frappent plus ce qui est visible (la location) que ce qui est problématique (la vacance).
C’est aussi un peu comme si, dans une grande famille, on vous interdisait de prêter une chambre vide à un cousin de passage, sous prétexte que cela dérangerait le voisinage, alors même que d’autres membres de la famille possèdent plusieurs maisons inoccupées depuis des années, sans que personne n’y trouve à redire.
En réalité, ces locations de résidences secondaires constituent aussi une forme de circuit court entre particuliers. Un lien direct entre un propriétaire et un voyageur. Pas de gros groupes hôteliers, pas d’intermédiaires opaques : une maison, une famille, un séjour. C’est aussi une manière de faire vivre les territoires autrement, de redonner un usage à des logements désertés, d’animer les rues, de faire tourner les commerces, de remplir les assiettes des restaurateurs locaux.
Reconnecter les acteurs au territoire
Un logement de vacances n’est pas qu’un toit. C’est une économie circulaire qui se met en branle : taxe de séjour collectée pour la commune, commerçants alimentés par les voyageurs, concierges employés pour accueillir, nettoyer, entretenir. Ce modèle crée de la valeur à plusieurs niveaux : fiscal, social, économique. Selon une étude d’Oxford Economics, les locations de vacances ont généré 149 milliards d’euros de retombées économiques dans l’Union européenne en 2023, tout en soutenant plus de 2,1 millions d’emplois directs ou indirects (source : Oxford Economics, 2024).
Enfin, si vous ne deviez retenir qu’une chose de cette tribune, oublions l’aspect économique de la location courte durée saisonnière, la vie de quartier que ça crée, l’attractivité des régions, etc. La location saisonnière, c’est pour beaucoup de Français synonyme de vacances, tout simplement. C’est le moment où les familles sortent du train-train quotidien du travail, les enfants de l’école. C’est le moment où on se crée des souvenirs, où on se reconnecte ensemble. C’est le moment où on vit vraiment ensemble, loin des tracas de la vie de tous les jours. Pour beaucoup, c’est le moment qu’on attendait dans l’année pour toucher au bonheur.
Réduire la location saisonnière, c’est aussi s’attaquer à ça. Et ça, c’est du concret. On récolte chaque mois des centaines de commentaires de personnes qui nous partagent leur bonheur, l’expérience des vacances en famille.
Sources :
NSEE – Résidences secondaires et logements occasionnels
« En France, 3,7 millions de logements sont des résidences secondaires ou occasionnels, soit 9,8 % du parc au 1er janvier 2024 » moncarnetlogement.fr+10insee.fr+10statistiques.developpement-durable.gouv.fr
Eurostat – Nuitées en location courte durée dans l’Union européenne
« 719 millions de nuitées en 2023 dans le secteur des locations de courte durée en Europe » ec.europa.eu+4ec.europa.eu+4news.airbnb.com
Oxford Economics (via Airbnb) – Impact économique des locations touristiques
« 149 milliards € générés et 2,1 millions d’emplois soutenus en 2023 dans l’UE » bnsp.insee.fr+13oxfordeconomics.com+13bnbnews.gr
À lire également : Tourisme en France : Bercy trace une nouvelle feuille de route pour 2030

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits