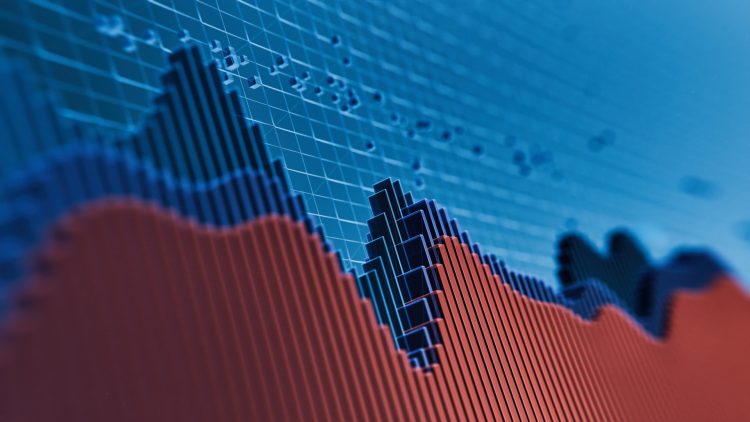Le géant des médias Condé Nast traverse une période charnière, marquée par des bouleversements majeurs au sommet de ses publications emblématiques. Entre départs inattendus et passations de pouvoir, c’est toute une ère qui semble toucher à sa fin, tandis que l’avenir s’écrit sous de nouveaux auspices.
Condé Nast a connu un printemps mouvementé. Le 25 mars, l’ancien rédacteur en chef de Vanity Fair, Graydon Carter, a publié ses mémoires intitulées When the Going Was Good: An Editor’s Adventures During the Last Golden Age of Magazines, un récit de ses 25 années à la tête du magazine. Le 3 avril, à peine une semaine plus tard, sa successeure, Radhika Jones, annonçait qu’elle quitterait la direction de Vanity Fair. Puis, le 10 juin, Mark Guiducci a été nommé à la tête du magazine — mais avec un titre différent de celui de rédacteur en chef : directeur éditorial mondial. Comme ce titre l’indique, il dirigera non seulement la branche américaine du magazine, mais aussi ses éditions à l’international. Mais ce n’était pas tout. Le 26 juin, après 37 ans à la tête de Vogue, Anna Wintour annonçait qu’elle quittait son poste de rédactrice en chef. Elle conserve néanmoins ses fonctions stratégiques : directrice éditoriale mondiale de Vogue et directrice du contenu de Condé Nast. Puis, le 15 juillet, dans un timing qui semblait presque trop parfait pour ne pas avoir été scénarisé, paraissait Empire of the Elite: Inside Condé Nast, the Media Dynasty That Reshaped America, signé Michael Grynbaum, journaliste média au New York Times.
Moins d’une semaine après la sortie de son livre, je m’entretiens avec lui. Inévitablement, la conversation revient sur Anna Wintour. « Le défi pour celui ou celle qui lui succédera sera de faire résonner l’esprit de Vogue auprès d’une nouvelle génération», me confie-t-il au téléphone. Il qualifie la période actuelle de « moment à la fois transitoire et transformateur » pour Condé Nast, et considère Anna Wintour comme « la figure la plus influente de l’entreprise aujourd’hui — non seulement pour son poids dans l’univers de la mode, mais aussi pour ses liens étroits avec les annonceurs de luxe, qui représentent une part essentielle des revenus du groupe ».
Il ne fait aucun doute : Anna Wintour est une figure difficile à remplacer. Icône reconnaissable entre mille avec sa coupe au carré impeccable et ses lunettes de soleil devenues emblématiques, elle a transcendé son rôle de rédactrice en chef pour devenir une célébrité à part entière.
Michael Grynbaum souligne qu’il sera ardu pour quiconque – qu’il s’agisse d’un rédacteur en chef ou, plus probablement, d’un responsable du contenu éditorial, le nouveau titre envisagé – d’égaler son aura médiatique. « Lorsqu’elle partira, Vogue devra trouver des moyens de préserver ses liens cruciaux avec l’univers de la mode, sans son atout le plus précieux », explique-t-il.
Cela dit, le départ de Wintour pourrait aussi ouvrir la voie à une nouvelle génération. « Je pense que certaines personnes chez Condé Nast se réjouissent à l’idée qu’un rédacteur plus jeune prenne le relais, avec une vision différente de celle d’Anna sur ce que devrait être Vogue », ajoute-t-il. « Et si l’on regarde dans le rétroviseur, d’autres figures jadis considérées comme irremplaçables chez Condé Nast ont bel et bien été remplacées — leurs successeurs ont su réinventer les marques pour une nouvelle époque. »
Selon lui, la relève existe : de jeunes talents brillants, prêts à faire entrer le magazine dans une nouvelle ère. Mais encore faut-il que Condé Nast leur offre les moyens de leurs ambitions. « La vraie question, c’est de savoir si la maison d’édition est prête à investir pour que Vogue retrouve le niveau de sophistication, de désirabilité et de glamour qui a fait sa légende. »
Reste à voir qui aura les épaules pour succéder à Anna Wintour, et si l’époque, elle, est encore capable de porter une telle figure.
« Dépenser, c’était la norme. »
À l’apogée de Condé Nast, le luxe n’était pas un excès — c’était une stratégie. Michael Grynbaum en dresse un portrait vivant dans Empire of the Elite, où il raconte avec précision une époque révolue : celle où la maison d’édition ne comptait pas ses dépenses pour offrir à ses collaborateurs un train de vie à la hauteur de ses ambitions.
À cette époque, les valises des rédacteurs en chef étaient expédiées par FedEx lors de leurs déplacements professionnels, pour leur éviter la contrainte de les transporter en avion. Les assistants devançaient parfois leur patron à Paris pour redécorer leurs suites d’hôtel selon leurs goûts. Quant aux shootings photo, ils pouvaient atteindre un demi-million de dollars rien qu’en frais de voyage, de décoration et de restauration : « presque comme des courts-métrages, simplement pour susciter chez le lecteur un moment d’émerveillement », raconte Grynbaum.
Le faste était partout, presque excessif. Et parmi les anecdotes les plus révélatrices, Grynbaum cite celle de la rédactrice en chef du magazine WIRED à la fin des années 1990. Venant tout juste d’intégrer le giron de Condé Nast, elle quitte San Francisco pour New York afin de rencontrer ses nouveaux supérieurs. Elle réserve une chambre dans un hôtel modeste, pensant bien faire. Mauvais calcul. « Lorsqu’ils ont appris où elle logeait, ils l’ont réprimandée », relate Grynbaum. « Ils lui ont dit : “Vous ne dépensez pas assez” ». Elle est aussitôt sommée de s’installer au St. Regis, sur la Cinquième Avenue, un hôtel au tarif trois ou quatre fois supérieur, estime-t-il.
« La logique était simple : lorsque vous rencontrez des annonceurs, ils s’attendent à ce que vous logiez au St. Regis », explique-t-il. Cette anecdote résume à elle seule la philosophie de Condé Nast à l’époque : la perception comptait autant — sinon plus — que la réalité. Dépenser n’était pas une option, c’était un signe de prestige, une partie intégrante de la marque.
Le modèle commercial de Condé Nast reposait sur l’exclusivité : « Créer ce monde désirable de luxe et de sophistication et faire payer les lecteurs et les annonceurs pour en faire partie », explique M. Grynbaum. Cet univers — incarné par Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, Allure, Glamour, Architectural Digest et d’autres titres — était plus qu’un simple catalogue de tendances : c’était un idéal de vie. Un monde auquel on aspirait. Et ce rêve vendait. « Ce fut un modèle incroyablement rentable pendant des années, car il offrait aux annonceurs haut de gamme un accès direct à une élite sociale, ou à ceux qui rêvaient d’en faire partie », souligne Grynbaum.
Condé Nast cultivait une forme d’aspiration sociale. Il façonnait une vision de la « belle vie », où le matérialisme devenait une esthétique, et les célébrités, des icônes quasi mythologiques. Ses publications étaient (et demeurent) des vitrines pour les meilleurs écrivains, photographes, stylistes et designers du moment. « Pendant des décennies, une entreprise new-yorkaise a dicté au monde ce qu’il fallait porter, admirer, consommer, et même penser », écrit Grynbaum dans Empire of the Elite. À son apogée, Condé Nast ambitionnait d’avoir « un pied dans chaque sphère et chaque moment de la vie humaine ». Être mis en avant dans ses pages signifiait, tout simplement, qu’on avait « réussi ».
Derrière cette réussite flamboyante se cachait pourtant un paradoxe : une entreprise « à la fois prospère et dysfonctionnelle », note-t-il. Et cette époque fastueuse — où l’on expédiait ses valises par FedEx avant même d’avoir décollé — avait une logique simple, selon Grynbaum : « L’important, c’était de dépenser. » Il poursuit : « En construisant l’image d’un lieu de travail irrésistible, peuplé de gens irrésistibles faisant des choses irrésistibles, Condé Nast a su donner envie au public de s’abonner et de faire partie de ce monde. »
Entrer chez Condé Nast relevait déjà de l’exploit. Mais, comme le souligne Michael Grynbaum, le véritable défi commençait une fois à l’intérieur. La pression ne retombait jamais, même pour ceux au sommet. « Il y avait des avantages certains à être rédacteur en chef à l’époque, mais ceux qui occupaient ces postes restaient anxieux, même aux plus hauts échelons », confie-t-il.
Pour son enquête, Grynbaum a interviewé plus de 200 personnes, dont de nombreux anciens cadres et rédacteurs. Ce qu’il a découvert ? Une atmosphère de privilège mêlée à une tension constante. « Ils bénéficiaient de tout : appartement pris en charge, voiture avec chauffeur, budget vêtements… Mais dans les faits, ils avaient rarement le temps d’en profiter, car la charge de travail était écrasante », explique-t-il.
La peur de décevoir, même à ce niveau, était omniprésente. « L’entreprise fonctionnait comme une cour médiévale : chacun tentait de s’attirer les faveurs du roi », dit Grynbaum. Et ce roi, c’était Samuel Irving “S.I.” Newhouse Jr., le président emblématique de Condé Nast pendant des décennies.
Chaque Noël, il réunissait les têtes pensantes du groupe autour d’un déjeuner au mythique restaurant Four Seasons. Ce rendez-vous annuel était bien plus qu’un simple moment de convivialité : c’était un rituel de pouvoir. « Le placement à table était minutieusement observé », raconte Grynbaum. « Être assis près de Newhouse était vu comme un indicateur direct de performance. »
Ce culte de la hiérarchie nourrissait une forme de rivalité interne. Vogue et Vanity Fair, par exemple, se disputaient les mêmes annonceurs, les mêmes lecteurs. Grynbaum évoque des anecdotes révélatrices sur les guerres feutrées que se livraient les titres du groupe : tentatives de discrédit auprès de marques potentielles, contrats d’exclusivité signés avec des photographes pour empêcher toute collaboration avec la « concurrence » interne.
Si Condé Nast rayonnait en apparence, l’éclat de ses publications masquait une culture d’entreprise marquée par une compétition intense, une obsession du rang hiérarchique, et des allégeances aussi précaires que calculées. Newhouse encourageait ces pratiques. « Il adorait l’idée de monter les rédacteurs en chef les uns contre les autres et estimait que cela les poussait à donner le meilleur d’eux-mêmes », m’explique Grynbaum. « C’est donc le style de gestion que Condé Nast a suivi pendant de nombreuses années. »
Si Newhouse incarnait le souverain d’une époque révolue, Anna Wintour s’est imposée comme la reine incontestée de l’ère contemporaine. Que devient alors l’ordre établi lorsque cette figure centrale choisit soudainement de se retirer ?
« À bien des égards, Anna Wintour est aujourd’hui la monarque incontestée de Condé Nast », souligne Michael Grynbaum. Elle supervise la quasi-totalité des titres du groupe, à l’exception notable du New Yorker. Elle joue un rôle clé dans le choix des rédacteurs en chef et dans l’élaboration des stratégies de marque.
Même si tout le monde reconnaît que les magazines traversent une période difficile — et que, selon Grynbaum, même le fleuron de Condé Nast « au mieux, équilibre à peine ses comptes, voire accuse des pertes » —, Anna Wintour conserve une influence inégalée dans le secteur. Son successeur devra donc se constituer un capital important, tant financier que social, dans un contexte particulièrement défavorable. « Si vous feuilletez un numéro de Vogue aujourd’hui, il ressemble plus à une brochure, comparé à l’annuaire téléphonique qu’il était autrefois, avec ses 900 pages de publicité », observe Grynbaum. « Pourtant, les choix du magazine continuent de faire sensation. »
Preuve en est avec la récente couverture consacrée à Lauren Sánchez pour son mariage avec Jeff Bezos. « Ça a déclenché un véritable buzz », explique Grynbaum. « Cela a provoqué des débats, suscité des réactions contrastées — certains ont adoré, d’autres détesté — mais tout le monde en a parlé. »
« Ce qui m’a frappé, c’est de voir Vogue reprendre sa place au cœur des débats culturels », ajoute-t-il. « Je ne crois pas que le magazine ait jamais vraiment disparu de la scène. » Pourtant, dans Empire of the Elite, Grynbaum écrit qu’un mastodonte comme Condé Nast « ne retrouvera jamais son lustre d’antan ». La désignation du successeur de Wintour reste cependant un enjeu de taille. Le principal défi ? Conquérir la jeune génération, celle qui n’a jamais connu les magazines à leur apogée. « Pour les plus de 40 ans, Vogue reste une référence majeure », souligne-t-il. « Ce n’est pas un hasard si Lauren Sánchez, à 55 ans, a accepté une séance photo exclusive pour le magazine. Mais ses enfants, eux, auraient-ils la même opinion ? »
« Aujourd’hui, une nouvelle génération de lecteurs ne s’intéresse plus du tout aux magazines papier et se montre moins impressionnée par les anciens géants des médias », constate-t-il. « Le défi majeur pour Condé Nast consiste désormais à sensibiliser ces jeunes générations à la valeur intemporelle de ses marques, qui continuent de représenter le raffinement et l’élégance. » Dans Empire of the Elite, Grynbaum entend montrer que, malgré ses imperfections, Condé Nast a joué, et continue de jouer, un rôle majeur dans la construction de la culture contemporaine.
« Le travail de sélection et de discernement reste essentiel pour nous aider à donner du sens à notre culture », explique-t-il. « À une époque où Internet est devenu un vaste chaos, le rôle de la curation est plus crucial que jamais. » Sorti à un moment particulièrement symbolique pour Condé Nast, son livre invite les lecteurs à remettre en question certaines idées reçues sur l’influence culturelle, tout en offrant une plongée fascinante dans un univers peut-être définitivement révolu.
Une contribution de Rachel Burchfield pour Forbes US – traduit par Lisa Deleforterie
À lire également : Hôtel de luxe : pourquoi le Fairmont Royal Palm change la donne à Marrakech

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits