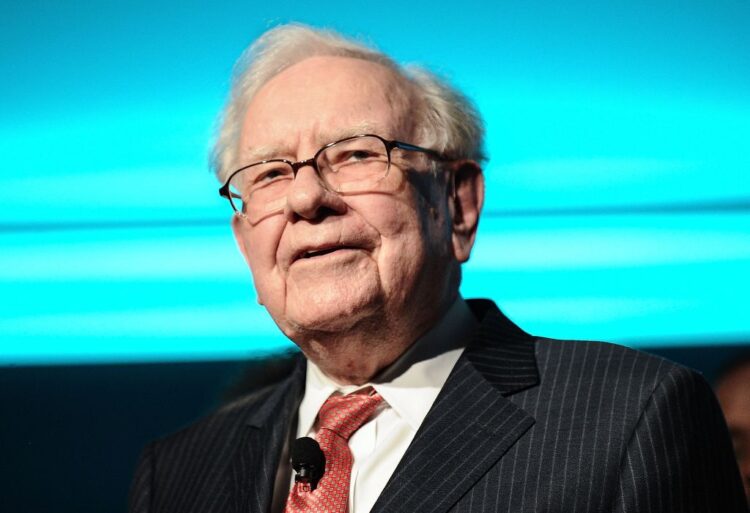Il y a dix ans, lorsque les investisseurs activistes ont commencé à faire la une des journaux à Tokyo, ils étaient perçus comme une curiosité étrangère : un style agressif d’actionnariat en décalage avec le monde des affaires japonais, fondé sur les relations, la stabilité, le consensus et la tradition. Peu auraient pu imaginer qu’en l’espace d’une décennie, l’investissement activiste passerait d’un phénomène marginal à une force influente, de plus en plus acceptée, capable de façonner la stratégie des entreprises nippones.
Depuis 2015, les investissements activistes au Japon ont progressé à un rythme annuel de 32 %, tandis que les propositions des actionnaires ont augmenté de 27 % par an. En juin dernier, le nombre de propositions d’actionnaires activistes a atteint un niveau record, selon Reuters. Ce qui n’était autrefois qu’une curiosité étrangère est désormais une force majeure qui transforme la gouvernance d’entreprise au Japon.
Lors d’un récent forum exécutif à Tokyo, des dirigeants de tous les secteurs ont débattu des implications de cette évolution. Leurs réactions témoignent de la relation souvent complexe entre direction et investisseurs activistes. Bien que l’investissement activiste se soit implanté au Japon dans des conditions particulières, son développement dans ce pays livre des enseignements dont la portée dépasse largement ses frontières.
Pourquoi le Japon, et pourquoi maintenant ?
Le Japon reste depuis longtemps un marché paradoxal pour les investisseurs internationaux. Si le pays abrite certaines des entreprises les plus innovantes au monde, il souffre toutefois d’une sous-évaluation persistante et d’un faible rendement des capitaux propres. En 2024, 41 % des sociétés japonaises cotées affichaient un rendement inférieur à 8 % et plus d’un tiers se négociaient sous leur valeur comptable. Un vaste réservoir de potentiel inexploité et d’inefficacité du capital s’y cache. Des améliorations opérationnelles, une restructuration du capital ou des réformes de gouvernance — le quotidien des investisseurs activistes — pourraient ainsi libérer une valeur actionnariale considérable.
À cela s’ajoutent une décennie de réformes réglementaires, allant de la restructuration du marché de la Bourse de Tokyo à l’élargissement des codes de gouvernance d’entreprise. Les agences gouvernementales, notamment l’Agence des services financiers et le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, ont intensifié leurs efforts pour renforcer la transparence, l’indépendance des conseils d’administration et une allocation plus efficace du capital.
Récemment, les opérations de capital-investissement et de croissance au Japon ont dépassé celles des États-Unis, de l’Europe et de la Chine. Une performance qui n’est pas passée inaperçue.
Une approche différente de l’activisme
Si les images de confrontations hostiles en salle de réunion dominent encore l’imaginaire collectif de l’activisme, le Japon offre un portrait plus nuancé. De nombreux investisseurs, nationaux comme étrangers, privilégient une approche collaborative et sur le long terme. Certains fonds d’engagement visent des changements durables sur plusieurs années, tandis que d’autres poussent à des actions plus rapides, comme la vente d’actifs, les rachats ou la simplification du portefeuille.
Tous sont attirés par des cours sous-évalués, des excédents de trésorerie, des actifs non essentiels et des signes de gouvernance faible : manque de diversité au conseil d’administration, mandats trop longs ou rareté d’administrateurs indépendants. L’extension de l’activisme à tous les secteurs — de l’industrie et des biens de consommation à la technologie et à la finance — indique que ce sont des inefficiences structurelles généralisées, plutôt que des dynamiques propres à un secteur, qui nourrissent ce marché.
Les dirigeants commencent à reconnaître la valeur que ces investisseurs peuvent offrir. « 99 % de ce que disent les activistes est en fait valable », confiait récemment un PDG. Le message peut être difficile à entendre, mais ces commentaires sans filtre servent souvent de « miroir brut » dont la direction et les conseils d’administration ont besoin. Ils génèrent une tension constructive et enrichissent la qualité des débats au sein du conseil.
Pourtant, des défis persistent. Si 90 % des dirigeants estiment disposer de mécanismes de dialogue avec le marché, beaucoup d’investisseurs ont le sentiment que leur voix n’influence pas réellement les décisions. Combler ce fossé exige plus qu’un engagement formel : il faut une écoute active et une réponse transparente.
La culture d’entreprise joue également un rôle. Certaines propositions activistes, même financièrement solides, négligent les contraintes de mise en œuvre ou les sensibilités des parties prenantes, et ne correspondent parfois pas aux priorités de l’entreprise.
Les dirigeants les plus efficaces savent transformer l’implication des activistes en catalyseur plutôt qu’en distraction : un levier pour traiter des enjeux longtemps identifiés mais non résolus, accélérer le changement, renforcer la gouvernance et libérer de la valeur.
Cela passe par une approche équilibrée : considérer les activistes non comme des adversaires, mais comme des partenaires d’une coalition plus large en faveur de la création de valeur durable, tout en conservant la discipline nécessaire pour dire non lorsque les propositions ne servent pas les intérêts à long terme.
Un appel à l’action
Le Japon attire aujourd’hui l’attention, mais l’activisme actionnarial n’est pas une mode passagère : il reflète une évolution structurelle des marchés financiers mondiaux. La vraie question n’est pas de savoir si les activistes frapperont à la porte, mais si les conseils d’administration et les équipes dirigeantes seront prêts lorsqu’ils le feront.
Trois questions clés que chaque PDG et chaque conseil devrait se poser dès maintenant :
- Quels aspects de notre entreprise un activiste ciblerait-il en priorité pour en libérer le « plein potentiel » ?
- Avons-nous la gouvernance nécessaire pour résister à un examen minutieux ?
- Écoutons-nous tous les actionnaires ou seulement ceux que nous connaissons le mieux ?
La dynamique observée au Japon illustre un mouvement mondial : l’examen des actionnaires devient plus sophistiqué, basé sur les données et résolument stratégique. De Francfort à Chicago, les dirigeants les plus performants adoptent un état d’esprit activiste : ils posent des questions difficiles, réévaluent le déploiement du capital et prennent des décisions audacieuses avant que quelqu’un d’autre ne les y oblige. Le Japon offre un aperçu frappant de ce qui attend les entreprises partout dans le monde.
Les activistes ne sont pas toujours des alliés faciles. Mais pour les dirigeants prêts à écouter, s’engager et agir, ils peuvent devenir de précieux alliés dans la réalisation du plein potentiel. Au Japon comme ailleurs, ils arrivent non seulement pour défier, mais aussi pour s’associer. Les entreprises qui prospéreront seront celles qui considéreront cette présence non comme une menace, mais comme un signal d’alarme.
Une contribution de David Michels pour Forbes US – traduit par Lisa Deleforterie
À lire également : Au-delà des mots : au Japon, un leadership qui ne s’affiche pas, mais qui s’incarne

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits