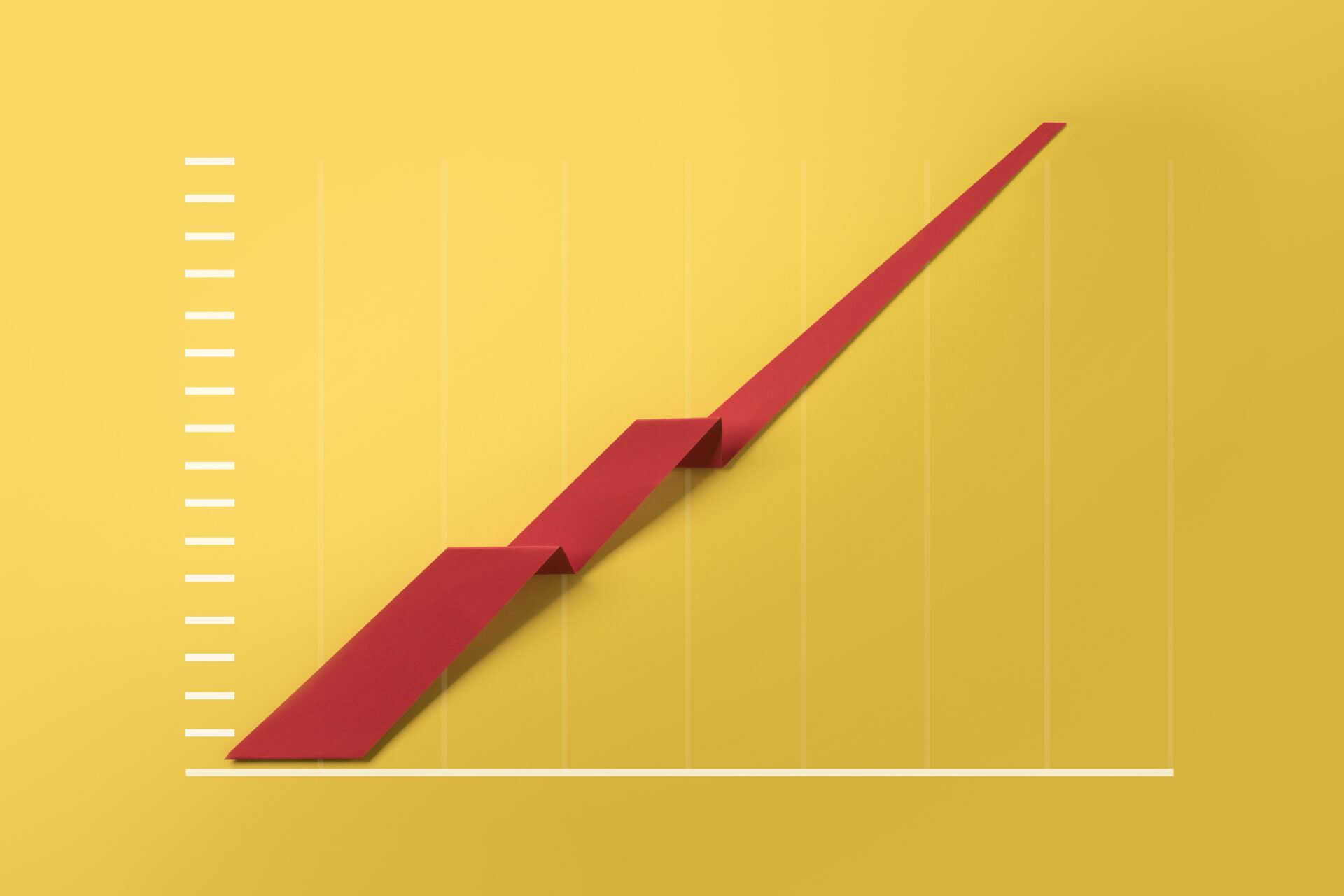Toujours plus haut. Selon l’Insee, la dette publique a atteint fin juin 3 416,3 milliards d’euros, soit 115,6 % du PIB. Il s’agit d’une hausse de 187 milliards sur un an. La France est désormais le cinquième pays au monde avec la dette la plus élevée en valeur absolue, et le premier au sein de l’Union européenne. Mais comment en est-on arrivé là ?
À la création de la Ve République en 1958, la dette publique oscillait entre 20 et 30 % du PIB (les chiffres varient selon les méthodes de calcul). Sous Charles de Gaulle, l’État finance par l’emprunt de grands programmes d’infrastructures – autoroutes, nucléaire civil. La forte croissance et l’inflation élevée permettent alors d’absorber aisément cette charge. Jusqu’au milieu des années 1960, les recettes de l’État dépassent même ses dépenses, et ce n’est qu’après 1968 que l’équilibre budgétaire commence à s’effriter légèrement.
Le véritable tournant intervient dans les années 1970. Valéry Giscard d’Estaing prend les rênes du pays au moment où les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 frappent l’économie mondiale. Croissance ralentie, chômage en hausse et inflation nourrissent une spirale déficitaire. Pour amortir le choc, l’État multiplie aides sectorielles et dépenses sociales. À partir de 1974, les dépenses dépassent durablement les recettes : la France entre dans une ère de déficits publics chroniques. À noter : en 1980, la dette reste toutefois limitée, autour de 20 % du PIB, soit environ 100 milliards d’euros.
Poids grandissant de la dépense publique
L’arrivée de François Mitterrand en 1981 accentue temporairement cette dérive. Son programme de relance – nationalisations, hausses des prestations sociales – creuse fortement le déficit. Le socialiste mise sur une politique de l’offre qui doit pousser à la consommation pour inverser la spirale de l’endettement. Mais la forte inflation qui touche l’occident contraint le président à changer son fusil d’épaule avant même que son plan porte ses fruits. Dès 1983, la France prend le virage de la rigueur. Les privatisations menées ensuite n’inversent pas la tendance : la dette progresse inexorablement. À l’aube du second millénaire, elle pèse 850 milliards d’euros (60% du PIB).
À partir des années 2000, deux nouvelles problématiques structurelles aggravent la situation : les baisses d’impôts non financées et le poids grandissant de la dépense publique. « Les recettes publiques représentaient 51,3 % du PIB et nous avions 52 % de dépense publique. En 2024, les recettes étaient toujours au même niveau (51,4 %) mais les dépenses ont grimpé à 57 % du PIB », souligne ainsi l’économiste Anthony Morlet-Lavidalie auprès de la Tribune.
Côté fiscalité, Nicolas Sarkozy engage en 2007 un « paquet fiscal » coûteux. La crise financière de 2008 impose un plan de relance et un soutien massif au secteur bancaire. Résultat : les recettes fiscales s’effondrent tandis que la dette bondit. À la fin de son quinquennat, elle dépasse 2 000 milliards d’euros.
Des baisses d’impôts non financées
Son successeur, François Hollande, mise également sur la politique de l’offre avec notamment le CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) introduit en 2013, qui coûte des dizaines de milliards chaque année. La dette poursuit sa trajectoire ascendante.
Sous Emmanuel Macron, la dynamique s’accélère encore. Selon la Cour des comptes (juillet 2024), la période 2018-2023 a été marquée par 62 milliards d’euros de baisses d’impôts (soit 2,2 points de PIB), dont 10 milliards de suppression d’impôts de production en plein « quoi qu’il en coûte ». « Le grand drame d’Emmanuel Macron est de ne pas avoir financé ses baisses d’impôts par des économies », résume Anthony Morlet-Lavidalie.
La stratégie du « quoi qu’il en coûte » face au Covid a coûté à elle seule 220 milliards d’euros. Or, l’État a tardé à couper certaines aides, continuant à distribuer par exemple des chèques énergie alors que les prix du pétrole retombaient. L’indexation des pensions de retraite sur l’inflation (15 milliards d’euros en 2024) est également jugée « une erreur monumentale », car elle n’a pas relancé la consommation : le taux d’épargne reste proche de 19 %, les plus de 65 ans représentant les deux tiers de cette hausse.
Aujourd’hui, la France fait face à un double héritage : une dette qui dépasse 110 % du PIB et une croissance qui devrait plafonner à 0,8 % en 2025. Depuis les années 1970, tous les présidents ont dû arbitrer entre soutien à l’économie et assainissement des finances publiques. Mais les chocs successifs (énergétiques, financiers, sanitaires) et des choix fiscaux souvent coûteux ont ancré la dette dans une dynamique ascendante.
Lire aussi : Long-format | Politique de l’offre et littérature : récit des sept années de Bruno le Maire à l’Economie

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits