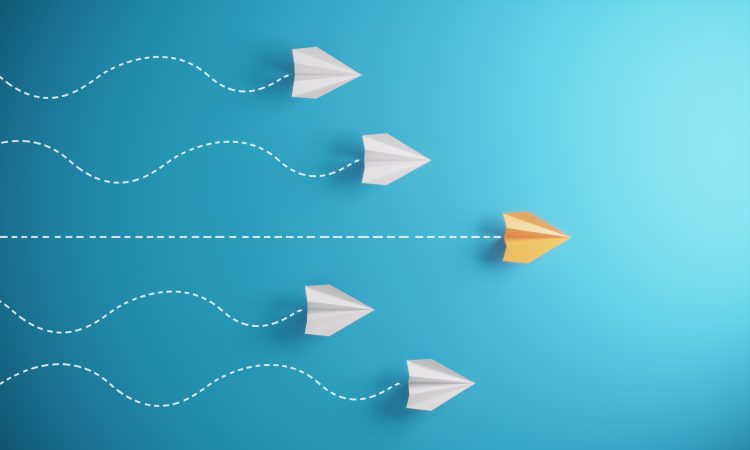Faut-il supprimer une semaine de congés payés pour relancer l’économie française ?
C’est l’une des intentions proposée par notre Premier ministre : monétiser les congés payés pour que les salariés travaillent plus. L’objectif annoncé serait d’augmenter les recettes fiscales, de stimuler la croissance et de soutenir le pouvoir d’achat.
Mais ce raisonnement, au-delà de son apparente logique arithmétique, soulève des contradictions majeures :
- Un salarié en congé est déjà rémunéré. Le faire revenir au travail ne crée ni revenu net supplémentaire, ni cotisations nouvelles, sauf si on lui verse une majoration significative (de +25 % à +100 %), comme c’est actuellement le cas avec le rachat des J.R.T.T.
- Mais dans ce cas, le coût pour l’entreprise augmente sans garantie que cette semaine produise une valeur équivalente ou supérieure.
- Si cette prime est fiscalisée, cela peut générer un peu plus de cotisations et d’impôts… mais ce sont des recettes marginales.
- Cette mesure, qui consiste à proposer aux Français de gagner plus d’argent va à l’encontre de la majorité d’entre eux qui désirent avoir plus de temps libre (Ipsos 2022)
Et surtout on confond ici plusieurs notions : produire, être productif, être performant, contribuer aux recettes publiques. Or il est fondamental de comprendre les différences :
- Produire, c’est accomplir une tâche : construire un mur, rédiger un contrat, livrer un colis. On peut produire beaucoup… sans pour autant que cela soit utile. Une équipe qui remplit des formulaires inutiles produit, mais n’apporte aucune valeur.
- Être productif, c’est produire plus dans le même temps ou avec moins de moyens. Si un salarié traite 20 demandes par jour au lieu de 15, il devient plus productif. Mais s’il traite mal ces demandes, la productivité n’apporte aucune valeur ajoutée.
- Être performant, c’est atteindre un résultat pertinent dans un contexte donné. Une infirmière qui prend en charge 8 patients avec calme, précision et humanité est plus performante qu’une autre qui en gère 12 de façon expéditive. La performance inclut la qualité, le sens et la justesse.
- Contribuer aux recettes publiques, par le biais de deux types de cotisations : directes (cotisations sociales, impôt sur les société) et indirectes (TVA). Si le versement de primes auront un impact sur les prélèvements sociaux, rien ne permet d’affirmer que cela augmentera les impôts indirects car il se peut que les salariés décident d’épargner ou de rembourser leurs dettes.
L’enjeu n’est donc pas d’être plus productif mais d’être plus performant.
Travailler plus pour être plus productif : une vieille croyance qui n’a plus de sens
Comment peut-on encore raisonner selon un mode de pensée industriel qui date de 1925 alors, qu’en 2025, 77 % des entreprises françaises évoluent désormais dans le secteur tertiaire ?
Dans ce contexte, la performance ne se mesure, ni au poids des efforts fournis, ni au volume d’heures travaillées, mais à la qualité du travail produit et à la création de nouvelles valeurs sur son marché.
L’argument des heures supplémentaires : un raisonnement trompeur
Certains responsables politiques avancent que cette mesure serait justifiée par le fait que les heures supplémentaires sont déjà largement pratiquées en France.
C’est factuellement vrai : selon la Dares (2023), plus de 50 % des salariés à plein temps en ont effectué au moins une au cours de l’année, mais les heures supplémentaires sont censées être une variable d’ajustement temporaire et rien ne dit que les salariés qui renonceront à une semaine de congés payés seront ceux qui font actuellement des heures supplémentaires.
Ce que coûterait une semaine de congés travaillée : une opération peu rentable
Voici une simulation basée sur le salaire moyen brut en France (3 613 €) : un salarié perçoit environ 861 € pour une semaine de travail. Pour qu’il accepte de travailler pendant ses congés, il faut lui proposer de lui racheter son jour de congé payés moyennant une majoration, comme cela est actuellement le cas pour le rachat des JRTT.
Trois hypothèses illustrent ce que cela impliquerait pour 5 jours ouvrés majorés (sans prise en considération des incidences fiscales) :
- À +25 % : l’entreprise débourse 1 268 €, le salarié perçoit 620 € net et l’État encaisse 648 €.
- À +50 % : l’entreprise débourse 1 521 €, le salarié perçoit 744 € net et l’État encaisse 778 €.
- À +100 % : l’entreprise débourse 2 028 €, le salarié perçoit 992 €, et l’État encaisse 1 037 €.
Si l’on met de côté le projet de supprimer deux jours fériés et qu’on se concentre sur l’idée de majorer le paiement de la semaine de 5 jours de congés payés, il faudrait, pour générer une recette publique d’un milliard d’euros que cela concerne :
- À +25 % : 1.281.312 de salariés.
- À +50 % : 1.067.760 de salariés.
- À +100 % : 800.820 de salariés.
Sachant que cela coûterait aux entreprises 1,96 milliards.
Ainsi, cette opération, même généreusement indemnisée, serait budgétairement marginale, voire économiquement et socialement risquée.
Les pays les plus performants travaillent moins que nous
Les comparaisons internationales battent en brèche le raisonnement simpliste selon lequel plus d’heures travaillées équivaut à plus de productivité.
Selon les données de l’OCDE (2023), la France affiche une productivité horaire de 74,6 USD, supérieure à celle des États-Unis (72,0 USD), alors que la durée annuelle de travail y est inférieure (1 490 h contre 1 810 h). En 2022, un salarié allemand travaillait en moyenne 1 349 heures par an, contre 1 490 pour un Français (Eurostat), tout en affichant une productivité horaire supérieure de 5 %. Le Danemark et les Pays-Bas, dont les durées annuelles de travail sont parmi les plus faibles d’Europe (<1 400 h/an), figurent également parmi les pays les plus productifs selon l’OCDE. À l’inverse, les pays où le temps de travail est très élevé, comme le Mexique ou la Colombie, avec plus de 2 200 heures par an, restent structurellement peu productifs.
Contrairement à une idée tenace, les Français ne sont ni paresseux, ni inefficaces et ce n’est certainement pas en travaillant plus qu’ils seront plus productifs.
Travailler plus diminue la productivité
Demander aux Français de renoncer à une semaine de travail pour réduire le déficit public pourrait bien avoir un coût bien plus important que le gain financier estimé : celui de rompre l’équilibre fondamental entre effort et récupération sur lequel repose le fonctionnement cognitif humain.
En effet, les recherches menées par le chercheur Van Dongen en 2003 ont démontré que la privation chronique de récupération, même légère, entraîne une baisse progressive de la vigilance, de la mémoire de travail et du jugement. Ce qui est vrai à l’échelle d’une semaine de sous-sommeil s’applique, par analogie, à une année professionnelle qui ne permet plus de recharger les ressources mentales.
En 2011, Daniel Kahneman, prix Nobel d’économie, a montré que la fatigue pousse le cerveau à court-circuiter la réflexion approfondie : au lieu d’activer le raisonnement lent et lucide (Système 2), il se replie sur des automatismes rapides et moins fiables (Système 1). En réduisant le temps de repos annuel on augmente le risque de décisions précipitées, d’erreurs de jugement et de baisse de vigilance.
La logique du « travailler plus pour produire plus » fait peut-être sens pour des métiers dont les activités sont algorithmiques ( activités routinières, répétitives, codifiées : Système 1), mais elle perd toute sa pertinence pour des activités heuristiques (activités qui exigent de l’adaptation, du jugement, de l’expérimentation : Système 2 ), qui concernent la majorité des emplois du tertiaire.
Diminuer le nombre de jours de récupération sur une année reviendrait donc à augmenter la charge mentale des salariés, ce qui provoquerait, si l’on se base sur les travaux de Baumeister et Tierney, une détérioration de la capacité à arbitrer, innover, mais aussi à coopérer.
Les entreprises les plus performantes ne sont pas celles où on travaille le plus mais celles où l’on respecte le mieux l’équilibre entre temps de repos et temps de production.
C’est en travaillant moins de jours par an qu’on augmente la performance
Si l’on peut parfaitement comprendre la volonté du Chef de Gouvernement de faire davantage cotiser les Français dans le cadre de sa stratégie de redressement des comptes publics, il est pour autant essentiel de ne pas confondre « logique budgétaire » et « logique de performance ».
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, travailler moins augmenterait la performance. C’est ce que révèlent les résultats des entreprises qui ont adopté la semaine de 4 jours, qui consiste, pour mémoire, à offrir 47 jours de repos supplémentaires par an, à salaire égal.
- Carabreizh, PME agroalimentaire en Bretagne, a augmenté sa productivité de 25 % en optimisant ses processus.
- MPCC, fabricant de mobilier professionnel, a vu son chiffre d’affaires passer de 1,1 à 3 millions d’euros après le passage à la semaine de 4 jours, avec un maintien de la qualité de service et des délais de production constants.
Non seulement les entreprises qui ont adopté la semaine de 4 jours affichent une amélioration très significative de leurs performances, mais les collaborateurs se déclarent moins stressés, moins fatigués, avec une motivation et une énergie supérieure.
Ces résultats peuvent sembler irrationnels pour les personnes qui raisonnent de manière arithmétique mais ils peuvent parfaitement s’expliquer lorsqu’on les appréhendent de manière systémique (meilleur usage du temps, réorganisation…).
Il ne s’agit donc pas de travailler plus pour augmenter la productivité, mais de travailler moins, et surtout mieux.
Sans doute vaudrait-il mieux, comme l’ont fait d’autres pays (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne…), lancer une expérimentation de la semaine de 4 jours pour augmenter la productivité, le bien-être des salariés et les impôts indirects que de demander aux citoyens de travailler plus, ce qui ne va d’ailleurs pas dans le sens de l’histoire.
Sources citées :
- DARES (2023). « Les heures supplémentaires rémunérées : quels salariés, quelles entreprises ? », Dares Résultats n° 30, avril 2023.
- INSEE (2023). « Les entreprises en France – Édition 2023 », Insee Références, chapitre 1, tableau de répartition par secteur d’activité.
- OCDE (2023). « PIB par heure travaillée », Base de données sur la productivité, septembre 2023.
- INRS (2022). « Stress au travail : données générales », Institut National de Recherche et de Sécurité.
- Malakoff Humanis (2024). « Baromètre santé et qualité de vie au travail », édition 2024.
- Service-public.fr. « Heures supplémentaires : majoration et exonération fiscale », fiche pratique mise à jour 2024.
- DITP (2019). « Travailler mieux : les apports des sciences comportementales », Direction Interministérielle de la Transformation Publique.
- Laborey, T. & Boyer, F. (2023). « La semaine de 4 jours, sans perte de salaire, ça marche ! », Eyrolles.
À lire également : Le syndrome du super-héros : quand l’excellence tourne à la dépendance

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits