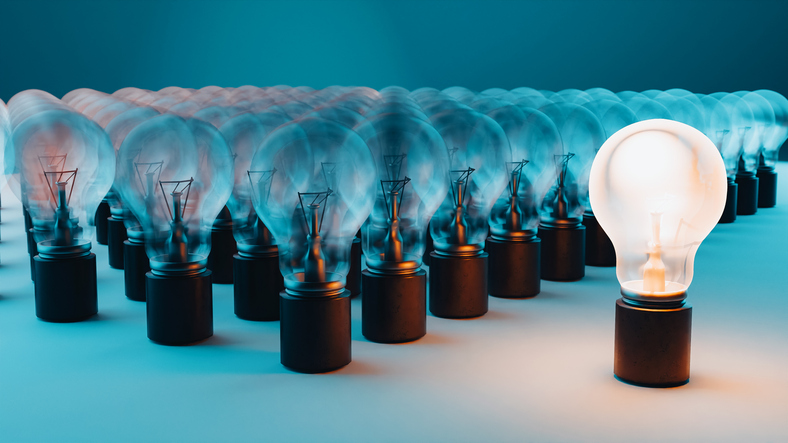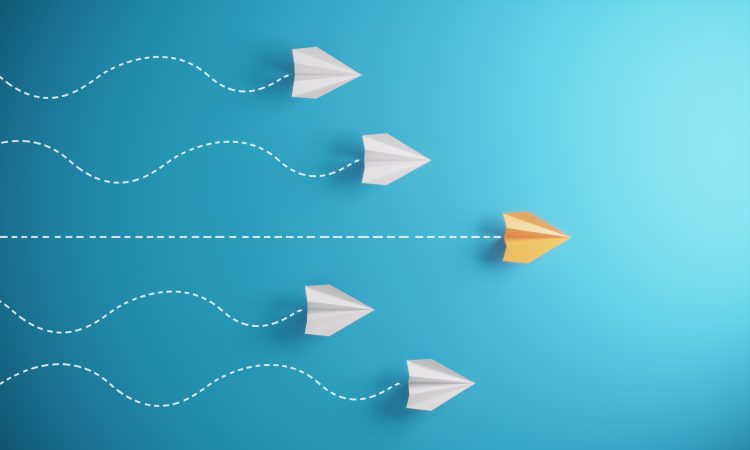Ils s’imposent dans toutes les réunions stratégiques : inclusion, agilité, sécurité psychologique, résilience… À l’origine, ces concepts répondaient à de vrais enjeux. Mais à force d’être répétés sans être vraiment appliqués, ils ont perdu leur sens. Et vos équipes ? Elles n’ignorent pas ces idées par indifférence, mais parce qu’elles ne correspondent plus à la réalité du terrain.
Ce qui débute comme un concept prometteur au sommet de la hiérarchie finit souvent par prendre de l’ampleur simplement parce qu’il est trop répété. Les dirigeants l’évoquent dans leurs discours, les consultants l’intègrent aux cadres de travail, et il devient rapidement un symbole de vertu stratégique. C’est ce que j’appelle « l’inflation des concepts » : une idée de leadership qui, en gagnant en importance symbolique, perd sa précision et son impact concret. Elle paraît plus puissante, mais s’éloigne de la réalité.
Puis survient le déclin. À mesure que ce concept amplifié se propage au sein de l’organisation, confronté aux filtres de la communication, aux interprétations erronées et à la lassitude, son impact s’affaiblit. Sa clarté s’efface peu à peu, tout comme son influence. Lorsqu’il parvient enfin aux acteurs qui doivent s’en saisir, il n’a plus la force d’entraînement nécessaire. Ce qui était un engagement culturel se vide de sens. Un concept autrefois porteur de promesses ne signifie plus rien, et ne produit plus aucun effet.
C’est un peu comme un chef d’orchestre qui, levant sa baguette pour lancer la symphonie, se rend compte que les musiciens n’ont pas la même partition. Tout le monde joue, mais la mélodie se perd, le rythme déraille, et ce qui devait créer une harmonie se transforme en un simple vacarme.
De l’urgence à la vacuité
Ces concepts de leadership ne sont pas apparus par hasard. Ils proviennent d’une recherche sérieuse, d’une expérience concrète et d’un besoin impérieux. Par exemple, Amy Edmondson a développé le concept de sécurité psychologique à partir d’études de terrain sur l’apprentissage collectif et la gestion des erreurs. Dans un récent article publié dans la Harvard Business Review, elle rappelle une idée souvent mal comprise : la sécurité psychologique ne signifie pas confort, mais la possibilité de prendre des risques interpersonnels sans craindre de représailles. Pourtant, bien que ce concept soit omniprésent dans les discussions sur la culture d’entreprise, Gallup révèle que seulement un salarié sur quatre dans le monde estime que son avis compte réellement au travail.
L’agilité n’est pas un simple effet de mode. Elle a été conçue dans des contextes exigeants : de la planification militaire à la production allégée, en passant par les équipes produit confrontées au changement. L’agilité, c’est bien plus que la rapidité : c’est une capacité d’action fondée sur la clarté, la responsabilité et l’adaptation continue.
Résilience, état d’esprit de croissance, leadership inclusif… Ces notions n’ont pas été inventées pour décorer des slides. Ce sont des outils essentiels dans des environnements difficiles, où les cultures organisationnelles vacillent, où le burn-out guette et où la stratégie patine. Pourtant, avec le temps, ces concepts ont été vidés de leur substance, réduits à des slogans creux.
Les employés reconnaissent ces mots, mais en perçoivent rarement le sens profond. Ce qui semblait autrefois porteur d’humanité et de progrès est devenu un langage décoratif, noble en apparence, mais dépourvu de poids réel.
C’est ainsi qu’une idée prometteuse finit par devenir creuse. Non pas parce que le concept est défaillant, mais parce que son application s’est éloignée de ses principes fondamentaux.
De la performance à la confusion
Imaginez un manager chargé d’instaurer l’agilité au sein de son équipe. Le message venu de la direction est clair et ambitieux : « Soyez rapides. Restez agiles. Adaptez-vous au changement. » Pourtant, aucune marge de décision ne lui est réellement accordée. Les priorités changent sans cesse, sans concertation ni explication. L’équipe réagit en mode urgence, mais n’est pas agile. Il n’y a ni temps pour la réflexion, ni espace pour ajuster. Rapidement, « agilité » devient synonyme d’épuisement.
Autre exemple : un dirigeant lance une réunion en déclarant : « Ici, c’est un espace sûr, parlez librement. » Quelqu’un ose alors remettre en question un processus bien ancré. Le responsable acquiesce poliment, félicite le retour, puis enchaîne avec l’ordre du jour. L’idée a été entendue, mais pas prise en compte. Pas de débat, pas de suivi, pas d’action. Le silence retombe. Quand le système ne soutient pas le message, les mots perdent leur portée.
Le manager, tampon entre culture et changement
Les études de Gallup révèlent que les managers d’aujourd’hui jouent un rôle clé d’amortisseurs culturels et de facilitateurs du changement. On attend d’eux qu’ils soient performants, engagés, capables de fidéliser, d’accompagner, d’adapter, de communiquer, et désormais de concrétiser les valeurs et les cadres fixés par l’entreprise.
Pourtant, ils manquent souvent de temps, d’autorité et de clarté pour relever pleinement ce défi.
Imaginez un manager de terrain confronté à une équipe épuisée, des effectifs réduits et des pressions croisées. Ajoutez à cela une nouvelle exigence venue de la direction : « Favoriser la résilience ». Une intention louable, certes. Mais sans moyens concrets, sans pouvoir réorganiser les processus ou alléger les points de tension, cette « résilience » se résume vite à un appel à tenir coûte que coûte.
C’est dans ces conditions que l’exagération des concepts fait place à leur déflation. Les mots peuvent sembler forts, mais s’ils ne s’incarnent pas dans le quotidien, ils s’effacent. Ce qui devait être un levier stratégique se transforme en simple bruit. Et sans actions concrètes, ce qui devait renforcer s’efface peu à peu.
Comment détecter les concepts devenus superficiels
Vous savez qu’un concept est simplement affiché, et non appliqué, lorsque tout semble bien en surface, mais que le suivi se fait silencieux. Voici quelques signes :
- Le terme est répété à l’envi, mais jamais traduit en comportements concrets.
- Les boucles de feedback s’ouvrent, sans jamais se refermer.
- Les dirigeants affichent les valeurs, mais les exemples concrets se font rares.
- Les responsables en parlent, mais leurs actions contredisent leurs paroles.
- Les propositions du terrain sont reconnues, mais restent sans suite.
- Les mêmes décideurs restent aux commandes, malgré un discours vantant le « leadership inclusif ».
Ce qui devait créer de l’unité tourne vite au spectacle vide de sens. L’alignement initial cède la place à la division.
L’approche des dirigeants vraiment engagés
Les meilleurs leaders ne se contentent pas de déclamer de grandes idées pour embellir la stratégie : ils les incarnent.
Ils ne se contentent pas de dire que la sécurité psychologique compte. Ils passent à l’action. Ils reconnaissent leurs erreurs en premier, invitant ainsi les autres à oser s’exprimer. Ils soutiennent activement ceux qui les défient, au-delà d’une simple tolérance du débat.
Ils ne réduisent pas l’agilité à la rapidité. Pour eux, c’est avant tout la capacité à s’adapter. Cela signifie prendre le temps de réfléchir entre deux phases d’action, donner aux équipes l’autorité de changer de direction, et privilégier l’apprentissage plutôt que l’apparence de performance.
Ils ne se limitent pas à organiser des panels ou des sessions d’écoute pour faire de l’inclusion. Ils réforment les processus de décision, recrutent autrement, repensent le mentorat et réinventent les réunions. Ils redistribuent le pouvoir, au lieu de simplement célébrer la diversité de présence.
Enfin, ils ne voient pas la résilience comme une simple capacité à tenir bon. Ils l’abordent comme un défi systémique : dans quelles situations faisons-nous supporter aux personnes des tensions que nous évitons de régler ?
Faites vivre le concept dans le système, pas seulement sur une diapositive
Ces idées ne doivent pas rester de simples mots affichés. Elles doivent s’ancrer profondément dans le fonctionnement de l’organisation. Sans évolution du système, ces concepts ne sont que des illusions.
Par exemple, si une équipe dirigeante veut vraiment adopter un état d’esprit de croissance, elle ne se contente pas de répéter le terme : elle revoit les évaluations de performance pour valoriser les objectifs d’apprentissage, met en lumière les projets qui ont échoué mais apporté des enseignements, et s’interroge ouvertement entre collègues : « Quelles idées avez-vous remises en question ce trimestre ? »
Pour l’inclusion, un leader peut réorganiser les réunions afin qu’un membre différent, souvent un nouveau, prenne régulièrement la parole. Ce n’est pas un simple geste symbolique, mais un véritable changement dans la répartition des responsabilités.
Ces actions peuvent paraître modestes, mais elles ont un impact réel et durable. Car ce qui est mis en pratique dès le départ devient un reflet constant, non pas sous forme de règles imposées ou de modèles superficiels, mais intégré dans le quotidien de chaque collaborateur.
Accordez-vous avant de diriger
Le leadership, ce n’est pas une question de performance, mais de compréhension partagée.
Pour que votre équipe joue en harmonie, ne vous contentez pas de répéter le message ; assurez-vous qu’elle connaît la partition et qu’elle est accordée sur la même tonalité. Car un message noble, sans rythme partagé, ne se perd pas parce qu’on ne veut pas écouter, mais parce qu’on ne peut pas suivre. La culture ne s’effondre pas en un instant. Elle se délite doucement, à force de signaux ignorés, de silences répétés, de concepts proclamés sans être incarnés, de valeurs énoncées sans être renforcées.
Avant votre prochaine conférence, prenez un moment pour réfléchir. Pas pour peaufiner votre discours, mais pour vous poser ces questions essentielles :
- Ce concept a-t-il été tellement amplifié qu’il en devient flou ?
- A-t-il perdu son impact avant même de s’enraciner ?
- Où cette valeur est-elle déjà présente, sans être clairement identifiée ?
- Que faudrait-il faire pour la rendre tangible, reproductible et visible ?
Vos équipes n’ont pas besoin d’une nouvelle déclaration bien intentionnée. Elles ont besoin de clarté, pour pouvoir agir ; de cohérence, pour pouvoir faire confiance ; et d’une culture qui s’aligne vraiment entre paroles et actes.
Cet alignement ne naît pas de la répétition des mots à la mode ou du langage stratégique creux, mais de dirigeants qui ajustent le système, au-delà de simplement fixer le ton. Quand le leadership se vit avec rythme et constance, le message ne s’efface pas en chemin : il s’ancre, résonne et oriente.
Une contribution de Vibhas Ratanjee pour Forbes US – traduit par Lisa Deleforterie
À lire également : 3 preuves scientifiques que le doute est une force essentielle au leadership

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits