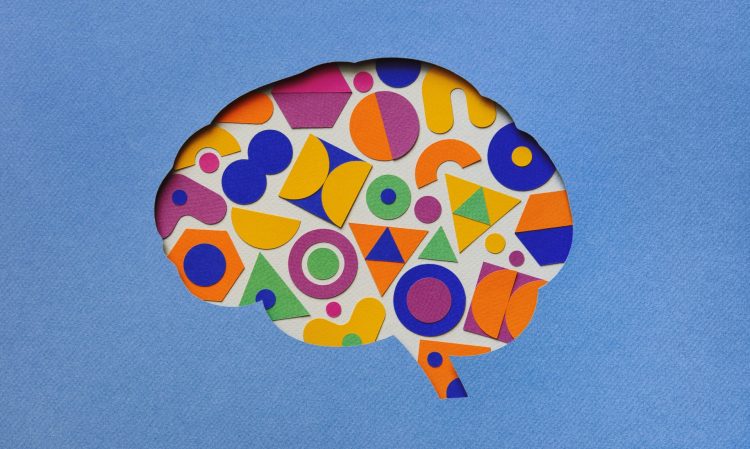Alors que la gestion de nos données informatiques s’est structurée autour d’exigences d’interopérabilité, de souveraineté et de performance, un autre type de données appelle aujourd’hui la même attention stratégique : les données biologiques. Longtemps cantonnées et silotées au sein des laboratoires ou des centres hospitaliers, elles entrent dans une nouvelle ère : celle des biobanques. Ces infrastructures, méconnues et discrètes, pourtant fondamentales, révolutionnent en silence notre rapport au vivant.
Une contribution d’Olivier Lartigue, Président de Cryopal
Biobanques et données numériques : mêmes promesses, mêmes défis
L’analogie est puissante, mais légitime. Les biobanques sont aux sciences de la vie ce que les data centers sont au numérique : des centres de stockage, de conservation et de traitement d’informations à très haute valeur. À ceci près que, parmi ces innombrables données, la vie elle-même est conservée, analysée, et mobilisée pour anticiper les diagnostics, modéliser les pathologies, ou guider les innovations thérapeutiques. ADN, embryons, cellules souches, tissus, plasma… Chaque échantillon est un fragment unique de notre patrimoine biologique. Mais leur utilité dépend de leur accessibilité, de leur traçabilité, de leur standardisation.
Comme pour les données informatiques, la valeur ne réside pas seulement dans le volume, mais dans l’organisation. Ce qui compte, c’est la capacité à agréger, sécuriser, indexer, et surtout à partager, dans un cadre éthique rigoureux. Car les biobanques n’ont de sens que si elles servent la recherche, la médecine personnalisée, la prévention, ou la fertilité.
Quand la donnée biologique devient vulnérable
Mais à mesure que ces données deviennent interopérables, standardisées, exploitables, elles deviennent aussi vulnérables. Car toute infrastructure attire les convoitises, et la biobanque n’échappe pas à la règle. Ce qui fut un don, un geste intime, un espoir médical, peut devenir un actif technique, déplacé de main en main, dissocié de son origine humaine.
Nous ne sommes pas à l’abri d’un renversement du sens : que la matière vivante devient objet marchand, que le soin laisse place à la spéculation, que la finalité médicale soit diluée dans la logique de valorisation.
Ce n’est pas de science-fiction qu’il s’agit. Des brevets sur le génome existent déjà. Des plateformes privées proposent de monétiser les profils génétiques. Et l’exploitation algorithmique de ces données pose des questions inédites de consentement, de représentativité, d’exclusion.
Derrière chaque échantillon, il y a une personne. Derrière chaque personne, une confiance. Et derrière cette confiance, la responsabilité collective de ne pas réduire le vivant à un actif froid.
Structurer, réguler, partager, oui. Mais toujours dans un cadre qui rappelle que la donnée biologique n’est pas un simple code : c’est une mémoire vivante, un potentiel de soin, une relation de confiance entre l’individu et la société.
Une opportunité collective à structurer
Car en effet, leur potentiel économique est considérable. Selon une étude publiée par Spherical Insights, le marché mondial des biobanques est estimé à près de 66 milliards de dollars en 2023, et devrait dépasser 165,1 milliards d’ici 2033, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAC) de **8,59 %**¹. Ce développement rapide s’accompagne de mutations profondes : automatisation, numérisation, convergence avec les plateformes de données cliniques et génétiques.
Mais au-delà des chiffres, c’est une vision stratégique qui s’impose. La consolidation des biobanques, mutualisation, normalisation, interopérabilité, est la clé pour passer d’un stockage passif à une infrastructure vivante, intelligente, maîtrisée et surtout utile à l’ensemble de l’écosystème santé
Cette dynamique est déjà à l’œuvre. En France, le programme FrBioNet, lancé en janvier 2025 dans le cadre de France Santé 2030, ambitionne de structurer l’ensemble des biobanques nationales sur cinq ans. L’objectif : valoriser les collections biologiques, lever les freins administratifs et opérationnels, harmoniser les pratiques. Ce type d’initiative montre bien que l’enjeu dépasse la technique : il engage des choix politiques, des arbitrages éthiques, une gouvernance de long terme.
Les biobanques posent une question de souveraineté, de justice et de confiance. Elles touchent au cœur de ce qui relie la science, le soin et la société. Et dans cette équation, aucun acteur, public ou privé, ne peut rester en marge.
Car derrière chaque échantillon, il y a un patient. Derrière chaque biobanque, il y a un enjeu de société.
Sources
- Étude publiée par Spherical Insights.
- Inserm / Ministère de la Santé (2025), Lancement de FrBioNet dans le cadre du plan France Santé 2030
À lire également : Intelligence artificielle et longévité : vers une humanité retrouvée

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits